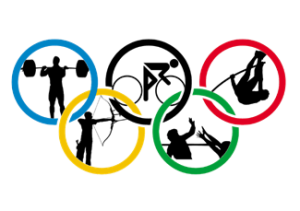Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de taille
 Les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : une échéance des plus importantes pour Paris, dont le dossier de candidature a été entériné par le Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre 2017. Cet évènement est un enjeu de taille tant bien pour la marque Olympique que pour les marques partenaires dont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence permettront la protection.
Les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : une échéance des plus importantes pour Paris, dont le dossier de candidature a été entériné par le Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre 2017. Cet évènement est un enjeu de taille tant bien pour la marque Olympique que pour les marques partenaires dont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence permettront la protection.
Des enjeux pour la protection de la marque Olympique et sa notoriété
Les Jeux Olympiques ont une diffusion et notoriété mondiale dont les risques de parasitisme et contrefaçon sont élevés pour la marque qu’il convient de protéger.
Le droit de la propriété intellectuelle a alors toute son importance. Le droit des marques permet de protéger les signes distinctifs enregistrés tel que le nom officiel de l’évènement, le logos, ; l’hymne… De même le Code du sport français prévoit déjà en son article L141-5 que Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiades ». Tout dépôt à titre de marque, imitation, reproduction, apposition, suppression ou modification de ces signes sont punissables des peines prévues par le Code français de la Propriété Intellectuelle formant, dès lors, des contrefaçons.
Au-delà de ces dispositions, il est fréquent que les Etats hôtes des jeux mettent en place des législations ad hoc, contraignantes et parfois dérogatoires du droit commun, pour pouvoir assurer la préparation optimale de l’évènement et honorer les engagements pris lors de la période de candidature. C’est là tout l’objet pour la France de la loi n°2018-202 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 promulguée le 26 mars 2018.
La loi, en son article 3 vient préciser et renforcer les droits sur les signes protégés. A ce titre elle modifie les termes du Code français du sport et ajoute certains signes à la protection. Le CNOSF est, dès lors, propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaires du drapeau, de la devise, des emblèmes, de l’hymne, du logo, du slogan et des affiches des jeux olympiques, de la mascotte, des termes « olympiques », « jeux olympiques », « olympiade », « olympienne » et « olympien », « JO » et du millésime « ville+année ». Toute utilisation à titre commercial ou promotionnel de ces signes ou pouvant entrainer un risque de confusion dans l’esprit du public laissant penser à un lien avec les Jeux Olympiques est punissable au titre des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, constituant des contrefaçons. Seule l’utilisation dans le langage courant est tolérée.
Enfin, la Convention Internationale de Paris du 20 mars 1883 « pour la protection de la propriété industrielle », en son article 6bis, prévoit d’engager la responsabilité civile de toute personne qui porte atteinte à l’image d’une marque notoirement connue. Il est incontestable que la marque Olympique jouit, à ce titre, de cette protection particulière. En 2006, une affaire avait opposé le CNOSF au groupement d’achat des magasins Leclerc qui avait intitulé sa campagne promotionnelle « Olymprix » et déposé cette marque pour ses produits. Les juridictions françaises ont mis en évidence la dégradation de l’image des marques « Olympique » et « Jeux Olympiques » et des actes de parasitisme, condamnant ainsi Leclerc.
Des enjeux pour les marques sponsors
Derrière l’euphorie que représente cet évènement mondial, se trame de gros intérêts financiers. Un milliard et demi d’euros viendront financer cet évènement. Un financement apporté par les 15 grandes entreprises partenaires, parmi lesquelles figurent LVMH, Suez, BNP Paribas, en contrepartie de quoi elles seront mises en avant lors de l’évènement et pourront utiliser les signes protégés des jeux. En cela, la protection accrue des emblèmes olympiques par les législations citées précédemment et notamment la législation ad hoc est finalement au cœur du bon fonctionnement des jeux. Seules les entreprises partenaires peuvent user des signes olympiques pour mener à bien leur stratégie marketing durant l’évènement, ce qui représente une contrepartie importante de leurs financements. Sans protection, pas d’investissement, sans investissement pas d’évènement. « Les garanties les plus fortes doivent être apportées au CNOSF afin de protéger les termes dont il est dépositaire. En effet, leur protection est essentielle à l’équilibre économique des Jeux. Il est donc impératif que les partenaires sachent leur investissement garanti et leurs droits protégés.» expliquait Laura Flessel, ministre français des sports, lors de la séance en hémicycle du 20 décembre 2017 à 15h.
Ceci lance un défi de taille aux entreprises non partenaires souhaitant tirer parti de cet évènement mondial et fortement médiatisé dans leurs stratégies marketing. Certains critiquent les mesures de la loi ad hoc au titre de l’atteinte à la liberté d’expression, ou encore de la liberté du commerce et de l’industrie. Des dispositions sévères qui, par ailleurs, vont au-delà de la protection du droit des marques en le détournant de sa fonction essentielle de distinctivité. Si le droit des marques ne permet la protection que de signes distinctifs, cette loi ad hoc protège des termes dépourvus de distinctivité ; mais ceci dans l’optique de protéger les investissements des marques partenaires, pour notamment les stimuler.
Par ailleurs, les marques partenaires doivent encore faire face à l’Ambush-marketing (marketing en embuscade). Cette pratique consiste en ce que les marques, non agréées, se rendent visibles lors des Jeux Olympiques sans pour autant avoir apporté les investissements en contrepartie. Le Tribunal de grande instance de Paris, le 30 mai 2008, a condamné ce genre de pratiques au titre de la responsabilité civile délictuelle et du parasitisme dans une affaire opposant la Fédération Française de Tennis à la société UNIBET. Il énonce que « UNIBET se place délibérément dans le sillage du Tournoi pour assurer à moindre frais la promotion et le développement de ses activités, ce qui caractérise un comportement parasitaire qui engage sa responsabilité civile délictuelle ».
Le déroulement de cet évènement à rayonnement mondial pose donc des enjeux tant pour la marque notoire que représente la marque Olympique, que pour les marques partenaires donc la protection est primordiale. La France entend bien protéger le patrimoine que constitue la marque Olympique et sa notoriété.