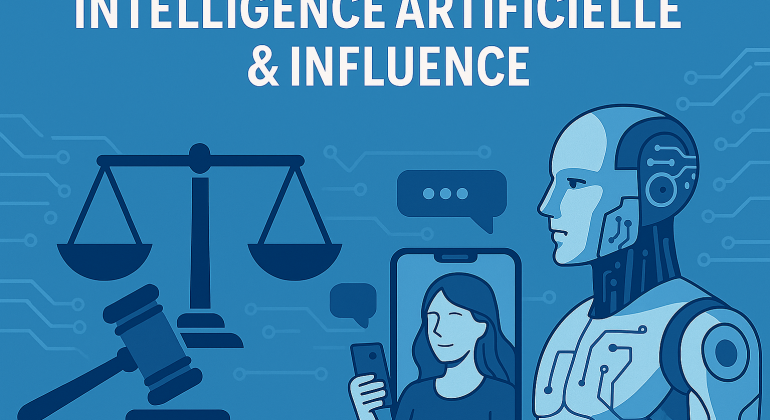Sommaire
Introduction
L’intelligence artificielle (IA) s’impose aujourd’hui comme un outil incontournable dans la communication et la publicité. Capable de rédiger des textes, de générer des visuels, d’imiter des voix ou de créer des personnages virtuels, elle bouleverse la manière dont les entreprises conçoivent leurs campagnes et interagissent avec leur public. Dans le secteur du marketing d’influence, ces technologies démultiplient les possibilités créatives : recommandations automatisées, personnalisation des messages, avatars d’influenceurs virtuels, scénarios de diffusion adaptés à chaque profil d’utilisateur.
Mais cette révolution technologique s’accompagne d’une multiplication des risques juridiques. À qui appartiennent les droits d’auteur d’une création générée par IA ? Comment garantir la transparence et l’authenticité d’une publicité conçue sans intervention humaine ? Quelles obligations s’imposent aux marques et aux influenceurs face aux nouvelles règles encadrant la communication numérique ?
Les défis juridiques de la création publicitaire générée ou assistée par IA
La question de la titularité des droits d’auteur
En droit français, la protection d’une œuvre par le droit d’auteur repose sur son originalité et sur l’empreinte de la personnalité de son auteur. La directive 2001/29/CE et le Code de la propriété intellectuelle (articles L111-1 et suivants) consacrent cette approche. Lorsqu’un contenu est généré entièrement par une intelligence artificielle, cette condition fait défaut : l’IA ne dispose pas de personnalité juridique et ne peut revendiquer de droits.
Le problème se complique lorsque l’humain intervient partiellement, par exemple en paramétrant le prompt, en sélectionnant un modèle ou en retouchant le résultat. La doctrine majoritaire considère que lorsque l’intervention humaine présente un caractère véritablement significatif, celle-ci peut justifier la protection de l’œuvre au titre du droit d’auteur. La part de créativité humaine détermine alors si l’œuvre peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Pour en savoir plus concernant les implications entre droit d’auteur et IA, nous vous invitons à consulter nos articles précédemment publiés sur la création par l’IA et les risques juridiques qu’ils en résultent.
Les risques de contrefaçon et d’atteinte à l’image
Les IA génératives se nourrissent de vastes bases de données, souvent composées d’œuvres déjà protégées au titre du droit d’auteur. Leur utilisation peut conduire à des reproductions partielles d’éléments existants sans autorisation. Une publicité exploitant une image ou un style issu de ces données pourrait ainsi constituer une contrefaçon.
De même, si une IA génère un visage, une voix ou un corps inspiré de personnes réelles, le risque d’atteinte au droit à l’image ou à la vie privée est réel. Dans le cadre du marketing d’influence, où la personnalité de l’auteur est au cœur de la communication, ces dérives peuvent gravement affecter la réputation de la marque et la confiance du public.
Le rôle de l’AI Act européen : un cadre structurant pour la publicité numérique
Un texte pionnier pour encadrer l’IA dans l’Union européenne
L’AI Act, adopté en 2024 et dont l’entrée en vigueur progressive se terminera en 2026, constitue la première législation mondiale visant à réguler l’intelligence artificielle selon un principe de risque proportionné. Il établit quatre niveaux de risque : inacceptable, élevé, limité et minimal, et impose des obligations spécifiques selon la finalité du système d’IA.
L’impact direct sur la création publicitaire et les influenceurs
Les systèmes d’IA générative utilisés pour produire des contenus publicitaires entrent dans la catégorie des systèmes à risque limité, mais sont soumis à des exigences de transparence renforcées. Ainsi, les fournisseurs et les utilisateurs devront, notamment selon l’article 50 de l’AI Act :
- Indiquer de manière claire qu’un contenu est généré par intelligence artificielle ;
- Mentionner toute retouche ou altération significative des contenus réels utilisés (voix, image, vidéo) ;
- Mettre en place des garde-fous contre la désinformation et la manipulation d’opinion ;
- Tenir à disposition la documentation sur les sources d’entraînement du modèle d’intelligence artificielle utilisé.
Les influenceurs et annonceurs devront donc adapter leurs pratiques à ce nouveau cadre, en intégrant ces obligations dans leurs processus de production et leurs politiques internes de conformité.
Vers une responsabilisation accrue des acteurs
L’AI Act prévoit également un régime de responsabilité partagée (article 25) entre les concepteurs, les fournisseurs et les utilisateurs d’IA. Dans la publicité, cela implique une traçabilité accrue : savoir quel outil a été utilisé, dans quel contexte, avec quelles données et sous quelle supervision humaine.
Cette obligation rejoint la logique du RGPD et renforce la nécessité d’une gouvernance juridique solide de l’IA dans la communication commerciale.
Les obligations légales des titulaires de marques et influenceurs à l’ère de l’IA
Transparence et identification des contenus publicitaires
Les obligations de transparence demeurent au cœur du droit français et européen. La législation française, plus précisément suite à l’introduction de l’article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, impose que toute communication commerciale soit clairement identifiable comme telle. Ainsi, désormais, toute publicité doit être clairement identifiable comme telle et indiquer, le cas échéant, lorsqu’elle résulte d’un contenu généré par IA. Les campagnes qui omettent de le préciser peuvent être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses (article L 121-2 et suivants du Code de la consommation), engageant la responsabilité des influenceurs et des annonceurs.
Les titulaires de marques et publicitaires doivent donc instaurer une politique de transparence : mention visible l’utilisation d’intelligence artificielle, distinction claire entre communication humaine et virtuelle, et respect de la loyauté du message publicitaire.
Protection des données et profilage publicitaire
Les outils d’intelligence artificielle utilisés à des fins publicitaires reposent souvent sur le traitement massif de données personnelles : historique de navigation, localisation, centres d’intérêt, comportements d’achat. Ce traitement doit être conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Les publicitaires doivent donc veiller à :
- Obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour l’utilisation de leurs données personnelles ;
- Limiter la collecte aux données strictement nécessaires ;
- Informer clairement sur les finalités du traitement de leurs données ;
- Encadrer le recours à des décisions automatisées fondées sur le profilage.
Toute campagne exploitant une IA pour personnaliser la publicité doit donc intégrer la conformité RGPD dès sa conception.
Conclusion
L’intelligence artificielle redéfinit la création publicitaire et le marketing d’influence, mais elle entraîne un ensemble complexe de responsabilités juridiques. Les enjeux principaux concernent la propriété intellectuelle, la transparence publicitaire, la protection des données et la conformité à l’AI Act.
Les entreprises doivent donc adopter une approche préventive dès aujourd’hui afin d’éviter les risques de contentieux et de préserver la confiance du public. Ce n’est qu’à cette condition que l’IA pourra devenir un atout maîtrisé et non un risque juridique.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1. Les publicités générées par IA doivent-elles faire l’objet d’un contrôle avant diffusion ?
Oui. Il est recommandé de procéder à un audit juridique systématique avant toute publication : vérification du respect des droits de tiers, de la conformité RGPD, de la mention obligatoire du recours à l’intelligence artificielle, et de la non-reproduction d’éléments protégés (logos, marques, œuvres de l’esprit).
2. L’utilisation d’une image de personne créée par IA peut-elle violer le droit à l’image ?
Oui, dès lors que l’image générée évoque ou imite de manière reconnaissable une personne réelle sans son autorisation. Ce type d’utilisation peut être qualifié d’atteinte au droit à l’image et à la vie privée, voire de dénigrement ou parasitisme si la ressemblance profite commercialement à une entreprise.
3. Quels sont les risques juridiques d’une publicité utilisant l’IA non déclarée ?
Le principal risque est la qualification de pratique commerciale trompeuse, susceptible d’entraîner des sanctions civiles voir pénales.
4. Comment les entreprises peuvent-elles encadrer l’usage de l’IA par leurs partenaires ?
En intégrant des clauses spécifiques dans leurs contrats : répartition des droits, responsabilité, conformité RGPD, mentions obligatoires, processus de validation.
5. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à l’entrée en vigueur du AI Act ?
Elles doivent dès maintenant :
- Recenser les outils d’IA utilisés dans leurs campagnes ;
- Documenter leurs usages (finalité, fournisseurs, paramètres) ;
- Prévoir des mentions explicites dans leurs contenus publicitaires ;
- Mettre en place une gouvernance interne et une veille réglementaire.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.