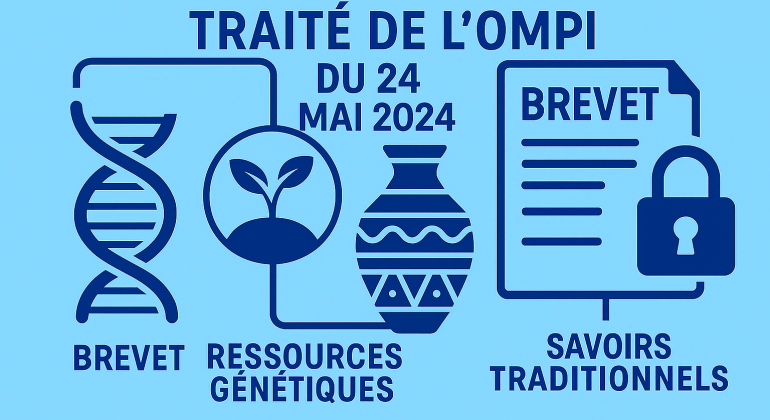Sommaire
Introduction
Dans un contexte où la biodiversité et les savoirs traditionnels occupent une place centrale dans l’innovation scientifique et technologique, la question du droit des brevets appliqué aux ressources génétiques et aux connaissances autochtones suscite un débat juridique et éthique majeur.
La question de l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels est régie par plusieurs conventions internationales. Le Protocole de Nagoya de 2010, qui constitue le protocole d’application de la Convention sur la biodiversité biologique (CDB) de 1992, est l’un des textes clés. Ce protocole impose aux États parties de garantir que l’accès aux ressources génétiques se fasse dans le respect du consentement préalable des communautés locales et autochtones et que les bénéfices tirés de leur exploitation soient partagés de manière équitable. L’Union européenne et la France ont pleinement ratifié ces instruments internationaux.
La récente adoption, le 24 mai 2024, du Traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, marque une avancée historique. En effet, elle est la première règlementation internationale à encadrer la question de l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels avec le droit des brevets.
Cet article vise à éclairer les professionnels, entreprises et institutions sur les interactions entre le droit des brevets, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, en analysant les implications juridiques et stratégiques de ce nouveau paradigme.
Cadre conceptuel et terminologie essentielle
Les « ressources génétiques » et les « savoirs traditionnels »
Il convient tout d’abord de définir clairement les notions de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Selon l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique de 1992, les ressources génétiques recouvrent « le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle » c’est-à-dire « le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ». Les savoirs traditionnels associés désignent les connaissances, innovations et pratiques héritées de communautés autochtones ou locales, en lien avec les caractéristiques ou l’usage des ressources génétiques. Un exemple emblématique est celui du curcuma (Curcuma longa), une plante utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle indienne pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. La racine de curcuma constitue une ressource génétique, tandis que les connaissances médicinales transmises au sein des communautés locales relèvent des savoirs traditionnels associés.
La coexistence de ces deux notions pose un défi juridique : elles combinent des intérêts économiques (recherche, innovation, brevets) et des enjeux éthiques, culturels et sociaux (droits des communautés, accès aux ressources, partage des avantages tirés de l’utilisation des ressources et des savoirs).
Le rôle du droit des brevets dans ce contexte
Le droit des brevets encourage l’innovation en conférant un monopole temporaire d’exploitation à l’inventeur. Cependant, lorsqu’une invention est fondée sensiblement ou directement sur une ressource génétique ou un savoir traditionnel associé, le système des brevets se heurte à plusieurs difficultés :
- La question de l’antériorité : le savoir traditionnel peut constituer de facto une antériorité « non documentée » voire orale, ce qui complique l’évaluation de la nouveauté ou de l’activité inventive.
- La transparence de l’origine : si la source de la ressource génétique ou de la connaissance n’est pas divulguée, une demande de brevet peut être contestée pour défaut de divulgation.
- La question du partage équitable des avantages : encadrée notamment par le Protocole de Nagoya (2010) entre l’inventeur et notamment les communautés autochtones ou locales.
Ainsi, pour un déposant de brevet, il est impératif d’intégrer ces enjeux au commencement du processus d’invention. Une gestion adéquate nécessite souvent le recours à un cabinet spécialisé pour assurer sa conformité juridique.
Les enjeux stratégiques et juridiques pour les titulaires de brevets
Risques de « biopiraterie » et mécanismes de défense pour les communautés autochtones
Le phénomène qualifié de biopiraterie désigne la prise de contrôle ou l’appropriation non-autorisée de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels pour en tirer des avantages commerciaux sans reconnaissance ou contrepartie. Certains biopirates vont même jusqu’à déposer des brevets.
À titre d’exemple, certains peuples autochtones ont vu des brevets délivrés pour des produits issus de plantes médicinales ou d’autres ressources biologiques sur lesquelles ils disposaient d’un savoir ancien. Ce type de situation repose sur :
- Un manque de consentement préalable de la communauté concernée ;
- L’absence de partage des bénéfices (« benefit-sharing ») pourtant prévu par la Convention sur la diversité biologique (1992) et le Protocole de Nagoya (2010).
Pour le titulaire de brevet, ignorer ces aspects peut entraîner non seulement un risque de litige mais aussi un risque réputationnel. Malgré plusieurs règlementations, la biopiraterie persiste. L’OMPI a alors pris des mesures pour encadrer ce phénomène en adoptant un traité qui renforce la protection des communautés autochtones et favorise un accès équitable aux ressources génétiques.
Obligation de divulgation de l’origine : le nouveau traité de l’OMPI
Après plus de vingt ans de discussion, l’OMPI a adopté le 24 mai 2024 le premier traité international visant explicitement à encadrer la relation entre propriété intellectuelle, ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Parmi ses dispositions phares :
- L’exigence de divulgation, dans la demande de brevet, de l’origine ou de la source de la ressource génétique utilisée dans l’invention ;
- L’obligation d’indiquer, dans la demande de brevet, la ou les communautés autochtones ou locales à l’origine du savoir traditionnel exploité ;
- La mise en place d’un système d’information (base de données) accessible aux offices de propriété intellectuelle afin de vérifier la conformité des demandes.
Pour un déposant, cela signifie que toute stratégie de brevet doit intégrer dès l’origine la vérification de la provenance, le consentement clair des communautés concernées, et la documentation de l’accès aux ressources. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner un refus d’enregistrement de brevet ou encore des obligations de compensation financière.
Le Traité de l’OMPI adopté en mai 2024 n’est cependant pas encore en vigueur : il n’entrera en application qu’après sa ratification par au moins quinze États. À ce jour, seuls le Malawi et l’Ouganda l’ont ratifié.
Comment adapter sa stratégie de brevet aux enjeux liés aux ressources génétiques et savoirs traditionnels ?
Afin de sécuriser la validité d’un brevet et d’éviter des contentieux ultérieurs, plusieurs étapes essentielles doivent être prises en compte dans le cadre de l’exploitation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels.
Tout d’abord, il est impératif de documenter l’origine exacte de la ressource génétique, en précisant notamment le pays d’origine, la communauté autochtone ou locale, et l’échantillon utilisé. Cette démarche permet d’établir une traçabilité claire et transparente, répondant ainsi aux exigences légales. Ensuite, il est crucial de vérifier que l’accès à la ressource et aux savoirs traditionnels a été effectué en conformité avec les obligations nationales et internationales (telles que les autorisations de prélèvement ou permis d’accès).
Dans ce contexte, l’obtention d’un consentement libre, préalable et informé de la communauté détentrice du savoir est également une étape indispensable, lorsque cela s’applique. Ce consentement doit être formalisé pour garantir le respect des droits des communautés. Par ailleurs, il est essentiel de prévoir un accord contractuel organisant le partage équitable des avantages, qu’ils soient financiers ou non-financiers, au bénéfice des communautés concernées, afin de respecter les principes d’équité.
Afin de répondre aux nouvelles obligations imposées par le traité de l’OMPI, il est également recommandé d’inclure dans la demande de brevet une déclaration sur la provenance des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels afin de garantir une transparence complète. Enfin, il convient de réaliser une recherche d’antériorité spécifique ciblant les savoirs traditionnels, les bases de données locales et les publications non-scientifiques, afin de limiter les risques de contestation concernant la nouveauté de l’invention.
En intégrant ces étapes dans la stratégie de dépôt de brevet, les entreprises renforcent non seulement la robustesse juridique de leur brevet, mais elles s’assurent également du respect des obligations éthiques et légales émergentes dans ce domaine complexe.
Conclusion
En définitive, l’intégration des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans le cadre du droit des brevets s’affirme comme un domaine de plus en plus structuré sur le plan juridique : le traité de l’OMPI du 24 mai 2024 en témoigne. Pour toute entreprise ou inventeur, il convient d’intégrer dès la phase de conception une vérification renforcée, une transparence de provenance et un partage équitable des bénéfices. Pour les détenteurs de savoirs traditionnels, il s’agit de structurer leur protection et d’engager des partenariats équilibrés.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1. Le traité de l’OMPI de 2024 s’applique-t-il également aux autres droits de propriété intellectuelle ?
Non. Le traité de l’OMPI adopté en 2024 ne concerne que le droit des brevets et n’instaure aucune obligation particulière en matière de droit d’auteur, de marques ou de dessins et modèles. Les membres du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI poursuivent leurs réflexions sur la protection des expressions culturelles traditionnelles et des œuvres issues des savoirs autochtones dans le cadre du droit d’auteur. Cela pourrait conduire, à terme, à l’adoption d’instruments internationaux complémentaires destinés à mieux encadrer l’utilisation et la préservation de ces créations traditionnelles.
2. Qu’entend-on par « divulgation de l’origine » dans le cadre d’une demande de brevet ?
Dans le contexte du traité de l’OMPI, cela signifie que le déposant doit indiquer dans la demande de brevet le pays ou la source de la ressource génétique utilisée, ainsi que l’identité de la communauté locale ou autochtone à l’origine du savoir traditionnel associé.
3. Le fait de disposer d’un savoir traditionnel empêche-t-il la délivrance d’un brevet ?
Non, mais ce savoir peut constituer une antériorité, ce qui peut détruire la nouveauté ou l’activité inventive de l’invention. Il convient donc de réaliser une recherche approfondie sur les savoirs traditionnels et d’anticiper l’impact sur la stratégie de brevet.
4. Comment le Protocole de Nagoya s’articule-t-il avec le droit des brevets ?
Le Protocole de Nagoya fixe des obligations en matière d’accès aux ressources génétiques et de partage équitable des avantages. Bien qu’il ne cible pas expressément les brevets, les offices de brevets et les déposants doivent être attentifs à ce que l’accès ait été autorisé et que le partage des avantages soit prévu.
5. Quel est l’impact pour une entreprise qui ne respecte pas ces obligations ?
L’entreprise s’expose à la potentielle contestation de son brevet, à des contentieux avec les communautés concernées, à des sanctions et à un risque réputationnel. Il est donc essentiel d’intégrer cette dimension dans sa stratégie PI.
Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.