Quelle adaptation des décisions en cas de soupçon d’usurpation d’identité ?



Constantin Film, une société de distribution de films allemande, a remarqué que certains films qu’elle distribuait avaient été mis en ligne, sans son autorisation, sur YouTube. Elle s’est donc adressée à la plateforme en question pour obtenir les adresses e-mail et IP des utilisateurs ayant mis en ligne ce contenu.
YouTube et Google (YouTube appartient à Google) refusant de transmettre les données demandées, l’affaire prit la direction des tribunaux allemands.
L’article 8 de la directive de l’Union européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de demander auprès des contrevenants et/ou des personnes leur ayant fourni des services, ici YouTube, des informations sur « l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle » et notamment les « noms et adresses » des personnes impliquées.
La Cour fédérale allemande s’est interrogée sur l’assimilation, des adresses e-mails et IP au terme d’« adresse » figurant dans la directive. Décidant de sursoir à statuer, la Cour allemande a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si de telles informations relevaient de la notion d’ « adresse » au sens de la directive.
La réponse de la CJUE est claire et s’inscrit dans l’ère du temps, qui vise à mettre au premier plan le respect de la vie privée : le droit de l’UE n’assimile pas à la notion d’adresse les adresses IP et les adresses e-mail.
La notion d’adresse figurant dans l’article précité doit être entendue au sens d’adresse postale.
Dans son communiqué de presse n°88/20 du 9 juillet 2020, elle précise : « s’agissant du sens habituel du terme ‘adresse’, celui-ci ne vise que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d’une personne déterminée » dès lors qu’il est utilisé sans autre précision.
Néanmoins, la CJUE vient rappeler que les Etats membres peuvent accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, un droit d’information plus étendu.
Dans le communiqué susmentionné, la Cour indique justement, à propos de l’article 8 de la directive 2004/48 que « cette disposition vise à concilier le respect de différents droits, notamment le droit d’information des titulaires et le droit à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs ».
Cette décision limite le champ d’action des titulaires de droit, pour lesquels il est de plus en plus ardu d’identifier les personnes portant atteinte à leurs actifs. Outre cette question des adresses IP et e-mails qui n’entrent pas dans le champ de ce qui est entendu par « adresse », rappelons que le Règlement pour la Protection des Données, dit RGPD, du 27 avril 2016, a également compliqué la défense des droits sur Internet, le respect de la vie privée ayant été accru et donc les informations sur les réservataires de noms de domaine, par exemple, largement masquées
Entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables, des biotechnologies, dans le traitement de l’eau et des déchets ou encore Start – up œuvrant pour la transition énergétique, votre propriété intellectuelle doit être protégée !
Prenez les bonnes dispositions et les précautions appropriées pour vous protéger et mettez en place une stratégie de défense !
Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à mettre en place les stratégies liées à la propriété intellectuelle et plus particulièrement au droit des marques et au droit des logiciels.
Greentech et propriété intellectuelle : quelles sont les spécificités ? Comment obtenir une marque de garantie et quel est l’impact du décret du 9 décembre 2019 ? Que doit contenir un règlement d’usage ? Quelles sont les bonnes pratiques en matière de label ? Comment établir sa stratégie de propriété intellectuelle tant dans le monde réel que dans le monde digital ? Comment se défendre dans un secteur d’activité très concurrentiel et en plein développement ? La protection de votre innovation est cruciale !
Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.
A très vite !
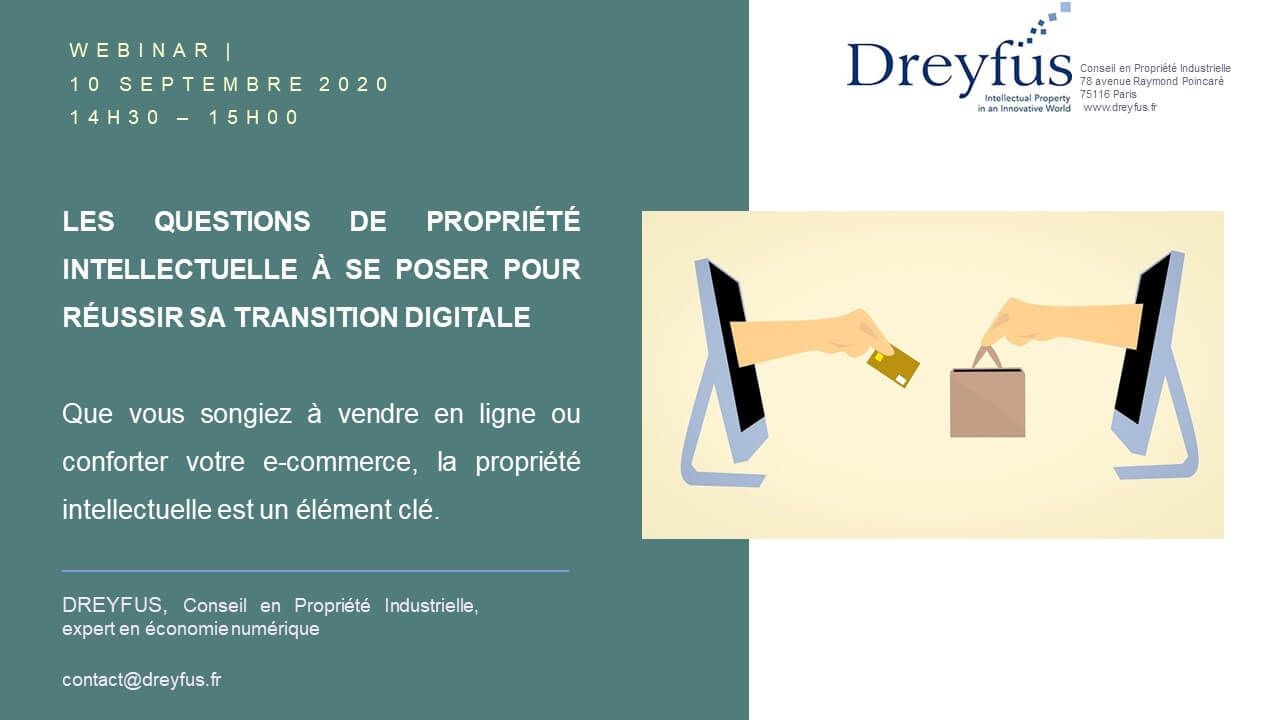
Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale
Comment sécuriser et optimiser son site internet ? Quelles précautions prendre ? Comment défendre ses droits de propriété intellectuelle sur Internet ?
Lorsque l’on veut réussir sa transition digitale, il faut se poser certaines questions.
Que vous songiez à vendre en ligne ou conforter votre e-commerce, la propriété intellectuelle est un élément clé.

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.
« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.
Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.
Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.
Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.
La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3]. Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.
Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.
Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité – « safe harbour » – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).
Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.
Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.
La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.
Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.
Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.
Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.
A suivre !
Sources :
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf
[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH
[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG
[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.
[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.
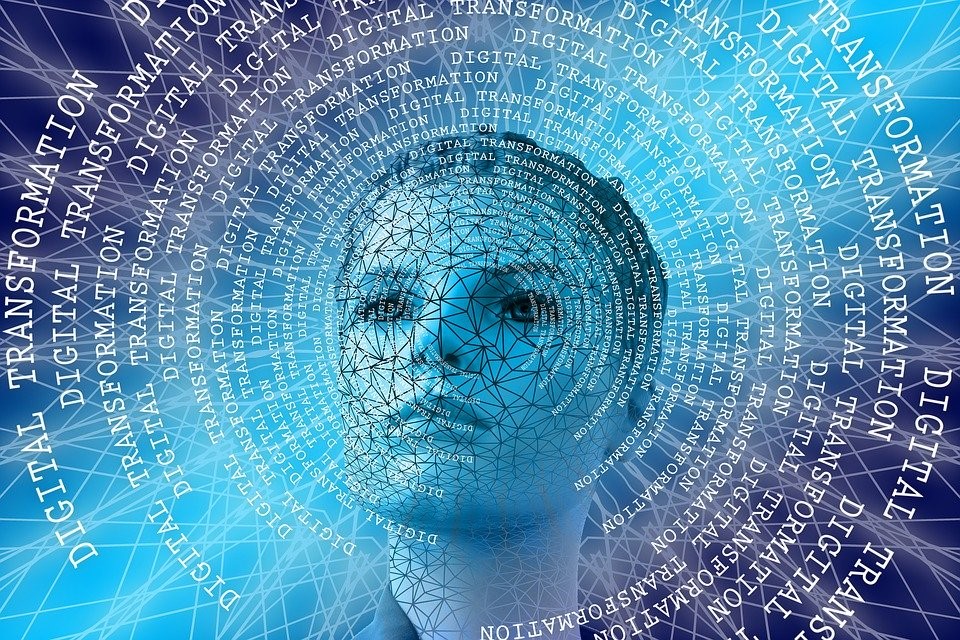 Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles. Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.
Quels défis pour le responsable de traitement ? Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles : – gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ; – communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ; – suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions. Quelles méthodes de gestion des risques ? Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données. Quid des cookies ? Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données. En résumé, il existe 3 types de cookies : – cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ; – cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ; – cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021) Comment récolter du consentement en ligne ? Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD). Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière. Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ? Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus. Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels. Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ? Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple). Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ? Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées). Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ? Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS. Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.
|

De nombreux obtenteurs souhaitent aussi s’exporter à l’international mais protéger ses obtentions végétales à l’étranger s’avère souvent complexe.
Les législations européennes mais aussi internationales sont harmonisées en raison de l’application de la Convention UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) qui compte 76 membres.
En vertu de cette Convention, le droit de l’obtenteur est accordé lorsque la variété remplit plusieurs conditions : la nouveauté, la distinctivité, l’homogénéité et la stabilité. Enfin, la variété devra être désignée par une dénomination appropriée.
La protection dans l’Union européenne :
Le dépôt de la demande :
Il existe depuis 1995 un titre communautaire unitaire : le certificat d’obtention végétale communautaire. Ce titre produit les mêmes effets qu’un titre national dans chaque Etat membre.
Cependant, il est important de savoir que ce titre n’est pas cumulable avec les titres nationaux. Avant d’effectuer une demande, l’obtenteur devra donc faire un choix pour protéger sa nouvelle variété.
La demande de protection devra être déposée auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). L’obtenteur français peut déposer sa demande directement devant l’OCVV mais aussi auprès de l’INOV (Instance Nationale des Obtentions Végétales) qui transmettra la demande à l’OCVV.
De plus, il existe certaines exigences relatives au contenu de la demande. Il faudra par exemple faire figurer :
• Les noms de l’obtenteur et du mandataire de la procédure s’il y en a un,
• Les informations concernant le taxon botanique (groupe d’organismes),
• La désignation provisoire donnée à la variété,
• Les informations relatives à la commercialisation antérieure de la variété,
• Les informations sur les demandes antérieures concernant la variété,
• Les délais relatifs à la priorité,
• La preuve du paiement.
Il convient également de remplir un questionnaire technique et un formulaire de désignation d’un représentant procédural (si le demandeur n’est pas ressortissant de l’Union européenne).
Le critère de nouveauté :
Afin de remplir le critère de nouveauté, les variétés ne devront pas avoir été commercialisées depuis plus d’un an au sein de l’Union européenne et depuis plus de 4 à 6 ans (selon la variété) en dehors de l’Union européenne. Au-de
là de cette période (nommée « délai de grâce »), la variété ne sera plus considérée comme nouvelle.
La protection lors du Brexit :
Le titulaire français d’un titre d’obtention végétale communautaire ne cessera pas d’être protégé au Royaume- Uni en raison du Brexit. En effet, le Royaume Uni a annoncé la création automatique de titres d’obtention végétale britanniques qui seront équivalents pour tous les titres communautaires enregistrés avant la date du Brexit.
Etendue de la protection :
L’étendue de la protection de l’Union européenne est similaire à celle conférée par de la législation française. Ainsi seront soumis à l’autorisation du titulaire : la production et la reproduction, le conditionnement en vue de la multiplication, l’offre à la vente, la vente ou autre commercialisation, l’exportation à partir de l’Union européenne, l’importation au sein de l’Union européenne et le stockage à l’une des fins susmentionnées.
La protection est applicable également aux produits de la récolte obtenus sans le consentement de l’obtenteur à moins que ce dernier n’ait eu une possibilité raisonnable d’exercer son droit et enfin, elle s’applique aussi aux variétés essentiellement dérivées.
Protection pendant la période provisoire :
Durant la période provisoire (période comprise entre le dépôt de la demande et l’octroi du droit) l’obtenteur pourra faire valoir ses droits exclusifs contre tous les actes qui auraient nécessité son autorisation après l’octroi du droit.
Cependant, l’obtenteur ne pourra obtenir qu’une « rémunération équitable ».
Prévention de la contrefaçon :
Enfin, à propos de la surveillance douanière aux fins de se prémunir contre la contrefaçon, les titres d’obtentions végétales sont inclus dans les droits de propriété intellectuelle soumis au Règlement européen 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.
La protection internationale :
Au niveau international, la législation est largement unifiée par la Convention de l’UPOV.
Cependant, la Convention offre la possibilité aux législateurs nationaux de tenir compte des circonstances nationales. L’obtenteur devra donc s’informer au préalable des spécificités nationales éventuelles afin d’assurer la protection de ses titres dans les meilleures conditions.
Attention, certains pays ne sont pas membres de l’UPOV !
Le dépôt de la demande :
Lors du dépôt de la demande, deux possibilités s’offrent à l’obtenteur :
• Le dépôt de sa demande dans chacun des offices nationaux ;
• Le dépôt de sa demande à l’aide du système multilatéral de dépôt prioritaire UPOV PRISMA. Cet outil en ligne permet de déposer, par l’intermédiaire d’un système unique, toutes ses demandes auprès des services de protection des obtentions végétales participants. Il faut cependant être vigilent car certains pays ne font pas partie de ce système UPOV PRISMA comme la Corée du Sud, le Japon ou encore la Chine (uniquement pour les laitues).
L’obtenteur devra également prendre en compte les délais de la procédure d’examen qui sont en moyenne d’une durée de 1 à 2 ans. Mais ces délais peuvent s’avérer beaucoup plus longs dans certains pays (parfois plus de 5 ans pour le Japon ou encore la Russie pour certains arbres fruitiers).
La protection pendant la durée provisoire :
Pendant cette période provisoire, l’obtenteur sera également protégé, comme pour le titre communautaire, contre les actes nécessitant son autorisation et aura le droit de réclamer une rémunération équitable.
Le critère de la nouveauté :
Dans la Convention UPOV, le délai de grâce concernant le critère de la nouveauté, comme pour les titres communautaires, sera d’un an au sein du pays dans lequel la protection est demandée, et de 4 à 6 ans à l’extérieur de ce pays. Attention tout de même à vérifier le délai de grâce prévu dans chacun des pays visés.
L’étendue de la protection :
Enfin, l’étendue de la protection des titres d’obtention végétale est la même que celle pour le titre communautaire dans les pays membres de l’UPOV en raison de l’application de la Convention ; sous réserve de certaines particularités nationales.
Si la Convention de l’UPOV a permis depuis 1961 d’harmoniser et d’instaurer une législation protectrice des obtentions végétales dans de nombreux pays, l’obtenteur, désireux de se développer à l’international, devra rester attentif aux législations nationales et à leurs spécificités.
Pour en savoir plus sur le conflit entre les marques et les variétés végétales.
Uncle Ben’s, Eskimo Pie, Quaker Oats… Outre le fait d’appartenir au secteur de l’alimentaire, ces marques ont un point commun : pendant longtemps, elles n’ont pas semblé poser problème et pourtant, l’actualité, le mouvement #BlackLivesMatter et l’évolution de la société a, à juste titre, fait ressortir le côté raciste de leur nom, logo ou slogan. Ces entreprises ont pris la décision de faire évoluer leur image et de modifier les marques qu’elles exploitent.
Pour faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI, une marque doit impérativement remplir une condition de licéité : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De ce fait, un dessin obscène, un insigne nazi, un slogan raciste seront évidemment déclarés irrecevables au moment de leurs examens par les services de l’INPI suite à leurs dépôts.
L’appréciation indépendante de la spécialité
En droit des marques, c’est le signe lui-même que l’on prend en considération. Ainsi, la licéité des produits ou services qu’elle couvre n’est pas pertinent pour évaluer la conformité à l’ordre public d’un signe. Lorsque l’on apprécie la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs du signe, la nature du produit sur lequel la marque est apposée ou du service qu’elle désigne ne rentre pas en compte.
A l’inverse, une marque jugée raciste le demeure quelle que soit la nature des produits ou services qu’elle désigne. La marque d’emballages « Paki » aurait pu échapper à la qualification de « contraire à l’ordre public », au regard des produits qu’elle désigne. En effet, le nom de la marque n’a probablement pas vocation à revendiquer une idée raciste, puisqu’il s’agit d’un dérivé du verbe « To Pack » signifiant « emballer ». Cependant, le terme « Paki » étant également utilisé pour désigner de façon péjorative les pakistanais, l’enregistrement de cette marque aurait contrevenu au principe de respect de l’ordre public et des bonnes mœurs à cause de la référence raciste à laquelle la marque fait échos.
L’appréciation en fonction du public pertinent
La conformité à l’ordre public d’une marque et par extension, son caractère raciste, se déterminent par rapport à sa susceptibilité de choquer ou non le public auquel elle sera confrontée. Par « public », on entend évidemment les consommateurs ciblés mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne. A cet égard, la marque « Paki » refusée au Royaume-Uni, où le terme raciste y est très courant, n’aurait sans doute pas provoqué le même malaise dans un pays où cette insulte raciste n’est pas utilisée.
Cela pourrait également expliquer pourquoi des marques comme Uncle Ben’s ou Quaker Oats n’ont pas, au moment de leur enregistrement et durant des années, été considérées comme racistes. Destinées à un public majoritairement occidental et distribuées dans des pays où le racisme ordinaire a longtemps été normalisé, le public auquel elles étaient confrontées ne se retrouvait pas « choqué » par leur image.
Cette situation n’est pas sans rappeler l’affaire Banania, marque qui arborait comme slogan « Y’a bon Banania », prononcé par un tirailleur sénégalais. Le slogan, signifiant « C’est bon » dans un français approximatif, perpétrait, selon les associations de lutte contre le racisme telles que le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), le stéréotype raciste et dénigrant selon lequel une personne noire n’était pas capable de parler dans un français correct. Jusque dans les années 70, le slogan était couramment utilisé par la marque. Le 19 mai 2011, la Cour d’appel de Versailles a donné raison au MRAP en rendant une décision dans laquelle elle exigeait que Nutrimaine, société titulaire de la marque Banania, cesse la vente de tout produit portant le slogan.
Les entreprises détenant les marques Uncle Ben’s, Quaker’s Oats et Eskimo pie ont annoncé qu’elles allaient faire disparaître ou modifier leur identité visuelle qui perpétue des stéréotypes raciaux. Du côté du droit des marques, l’appréciation du caractère raciste par les offices se veut de plus en plus minutieuse.


Cette loi, transposant la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques » stipule une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »).
Auparavant seul le tribunal judiciaire était compétent pour les demandes en nullité de marque. Désormais, cette compétence est partagée avec l’INPI.
Cette procédure administrative devant l’INPI permet d’obtenir une décision dans des délais plus courts (entre 6 et 10 mois) et à moindre coût.
Une demande en nullité peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’une marque internationale désignant la France.
Une marque pourra être déclarée nulle si elle est entachée d’un défaut correspondant à un motif de nullité absolue. C’est par exemple le cas si elle est :
Si elle porte atteinte aux droits d’un tiers, on parle de motif de nullité relative.
Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement. Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir. Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.
La répartition des actions entre le juge judiciaire et l’INPI est déterminée par les articles L716-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dorénavant, l’INPI a compétence exclusive pour certaines demandes, notamment :
– les actions en nullité fondées sur une marque antérieure (marque française, marque communautaire, marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire ou demande de marque sur ces territoires)
– les actions en nullité fondées sur un nom de domaine (à condition que sa portée ne soit pas seulement locale et qu’il y ait un risque de confusion), ou encore
– les actions en nullité de marques déposées par l’agent ou le représentant du propriétaire de la marque sans son consentement
C’est le cas pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur un ou plusieurs motifs absolus (comme le caractère trompeur) mais aussi pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur des motifs relatifs (comme l’atteinte à certains droits antérieurs, tels que la marque ou la dénomination sociale). Toutefois, les actions en nullité fondées sur les droits d’auteur ou les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé resteront de la compétence exclusive des tribunaux.
Lorsque le demandeur saisit la mauvaise instance, l’action sera simplement déclarée irrecevable.
Il y a tout d’abord une phase de pré-instruction d’un mois. Pendant cet examen de recevabilité, l’INPI vérifie que la demande contient bien l’ensemble des pièces et des mentions requises : il s’agit de l’exposé des moyens fondant chacune des prétentions.
Puis vient la phase d’instruction pouvant s’écouler sur une période de six mois et durant laquelle auront lieu les échanges écrits entre les Parties, qui exposeront chacune leurs arguments en respectant le principe du contradictoire.
A l’issue de cette phase d’instruction interviendra la phase de décision d’une période de trois mois.
Il sera possible de limiter l’action en cours de procédure : en limitant la demande soit à certains produits et services visés par la marque contestée, soit à seulement certaines des marques contestées. Si l’INPI conclut à la nullité de la marque, celle-ci sera prononcée dans un délai de trois mois, par une décision du Directeur général de l’INPI, et prendra effet à partir de la date de son dépôt. La nullité a donc un effet rétroactif et absolu. Cette décision est inscrite au Registre national des marques et elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant. Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité. Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son entier. Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.
Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.