Tesla et l’EUIPO mettent un coup d’arrêt au « trolling » des marques !
Dans une décision récente, la division d’annulation de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a déclaré la marque européenne « TESLA », détenue depuis 2022 par Capella Eood, invalide pour cause de mauvaise foi. Cette décision marque une victoire majeure pour le constructeur automobile Tesla dans sa lutte contre les pratiques abusives de certains détenteurs de marques, souvent qualifiés de « trolls des marques ». Retour sur les éléments clés de cette affaire emblématique.
Contexte et enjeux de l’affaire
En 2022, Tesla a déposé une demande d’annulation de la marque « TESLA » enregistrée auprès de l’EUIPO par Capella Eood, une société associée à un individu connu pour ses pratiques de « trolling » en matière de marques. La demande d’annulation était fondée sur l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui permet d’invalider une marque si elle a été déposée de mauvaise foi.
Tesla a argué que Capella Eood utilisait des stratégies spéculatives pour enregistrer des marques dans le but de bloquer les opérations d’autres entreprises et d’extorquer des accords financiers. Les preuves fournies incluaient des exemples de sociétés fictives, des retards dans les procédures d’opposition et des transferts stratégiques de droits de marque.
De son côté, le détenteur de la marque a nié les accusations de mauvaise foi, qualifiant les arguments de Tesla de diffamatoires et prétendant que la marque avait été inspirée par des sources indépendantes et non liées aux activités de Tesla.
Critères analysés par l’EUIPO pour établir la mauvaise foi
Selon l’article 59(1)(b) RMUE, l’évaluation de la mauvaise foi repose sur l’intention du demandeur au moment du dépôt de la marque, en tenant compte des pratiques commerciales honnêtes. L’EUIPO a examiné cette intention à travers plusieurs critères clés, inspirés notamment des jurisprudences Sky and Others (C-371/18) et Koton (C-104/18 P).
- Motivations et contexte du dépôt
Le dépôt de la marque contestée a eu lieu peu de temps après que Tesla ait acquis une reconnaissance internationale, en particulier suite au succès de la Tesla Roadster. Cette proximité temporelle a indiqué que le détenteur de la marque était conscient de la notoriété croissante de Tesla. Les affirmations selon lesquelles la marque avait été inspirée par un article de journal ou un CD ont été jugées non crédibles, surtout étant donné que les produits ciblés – véhicules et accessoires – correspondaient directement à ceux de Tesla.
- Historique de pratiques spéculatives
Des preuves ont montré que le détenteur de la marque avait un historique de dépôts systématiques via des sociétés écrans dans différentes juridictions. Ces marques étaient souvent abandonnées ou retirées, révélant une stratégie d’exploitation abusive du système des marques de l’UE pour créer des positions de blocage à des fins financières.
- Tactiques dilatoires et absence d’utilisation effective
L’EUIPO a relevé des démarches dilatoires, comme des modifications incohérentes des descriptions de produits et services, visant à retarder les procédures d’opposition pendant près de 15 ans. Le détenteur n’a présenté aucune preuve d’une activité commerciale véritable associée à la marque, renforçant l’idée d’une stratégie purement obstructive.
- Connaissance des activités de Tesla
Les produits Tesla étaient déjà largement couverts par les médias en Autriche et ailleurs avant le dépôt de la marque contestée. Cette couverture médiatique, combinée aux autres preuves, a démontré que le détenteur de la marque était conscient des opérations de Tesla et cherchait à tirer parti de son succès prévu sur le marché européen.
- Violation des pratiques équitables
En concluant que la marque avait été déposée sans intention d’usage véritable et dans le but d’obstruer les dépôts légitimes, l’EUIPO a établi que les actions du détenteur étaient contraires aux principes de bonne foi et d’équité.
Répercussions de cette décision
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence croissante visant à réprimer le trolling des marques et à protéger la concurrence loyale. Elle renforce également les principes établis par les arrêts Sky and Others et Koton, qui définissent la mauvaise foi comme une intention contraire aux pratiques honnêtes au moment du dépôt.
Pour les entreprises, cette affaire souligne l’importance de surveiller les dépôts de marques susceptibles de bloquer leurs activités et d’agir rapidement pour contester les enregistrements abusifs. Elle met également en évidence le rôle essentiel des preuves – comme l’historique des dépôts et les comportements dilatoires – dans la démonstration de la mauvaise foi.
Conclusion
La décision de l’EUIPO dans l’affaire TESLA constitue une victoire importante pour la lutte contre les abus systématiques dans le domaine des marques. Elle rappelle que les pratiques commerciales doivent rester équitables et honnêtes, et que le système des marques ne doit pas être exploité à des fins spéculatives. Pour les entreprises comme Tesla, ces décisions permettent de protéger leurs investissements et leur réputation sur le marché européen. Les professionnels du droit des marques, comme le Cabinet Dreyfus, restent mobilisés pour accompagner leurs clients face à de telles pratiques.
Le cabinet Dreyfus collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !




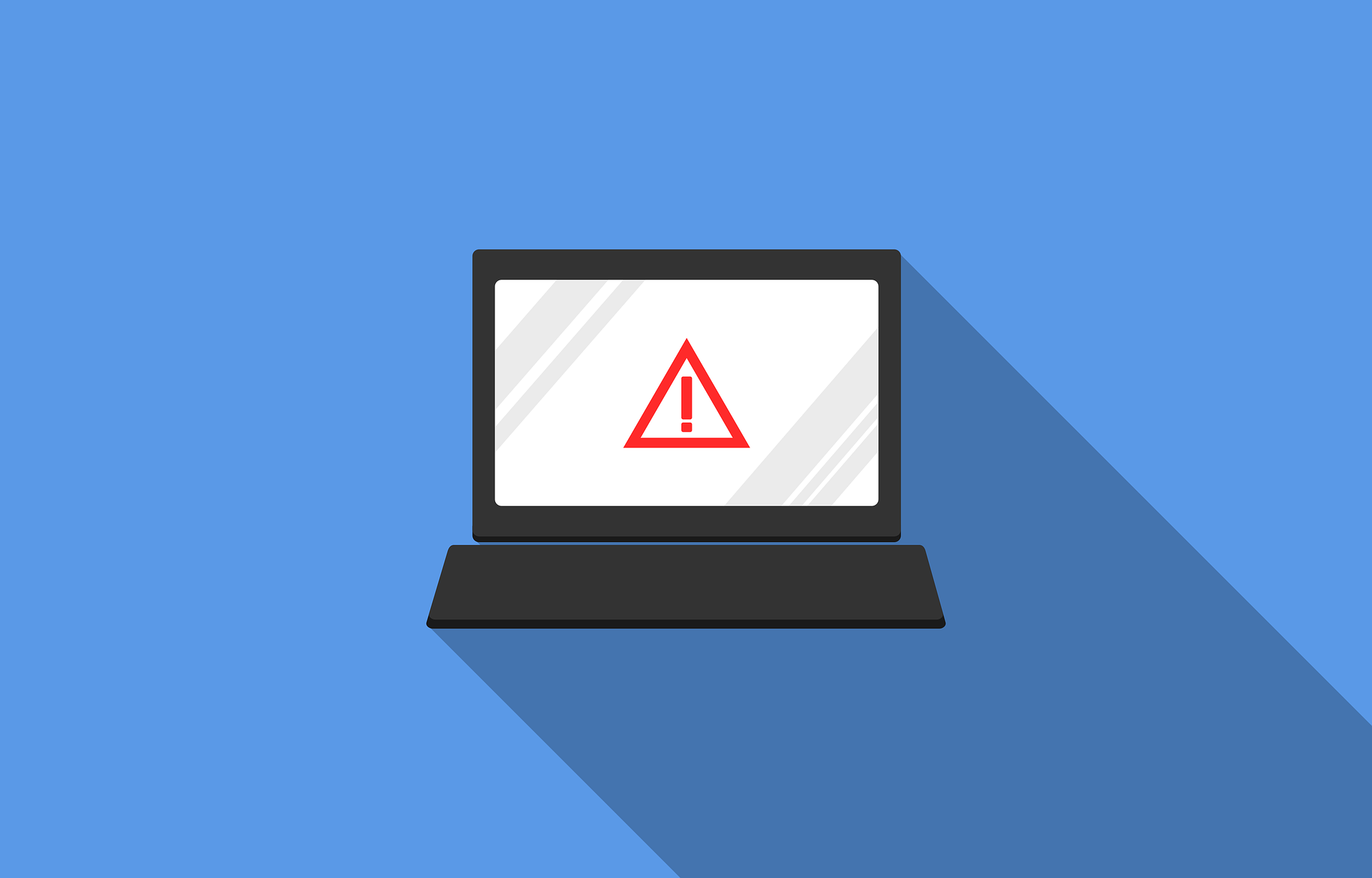



 Dans l’
Dans l’
