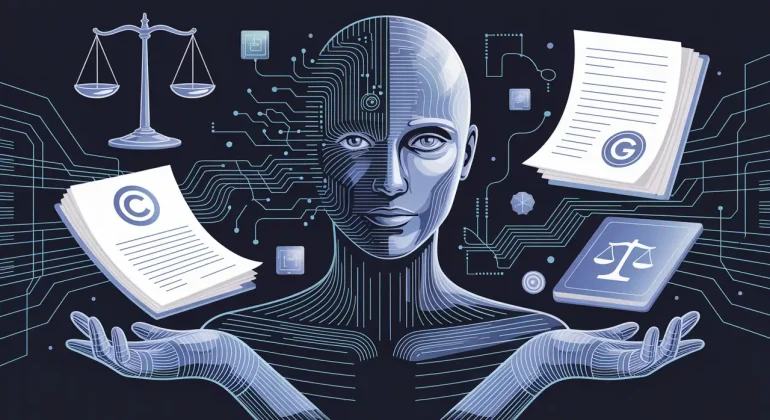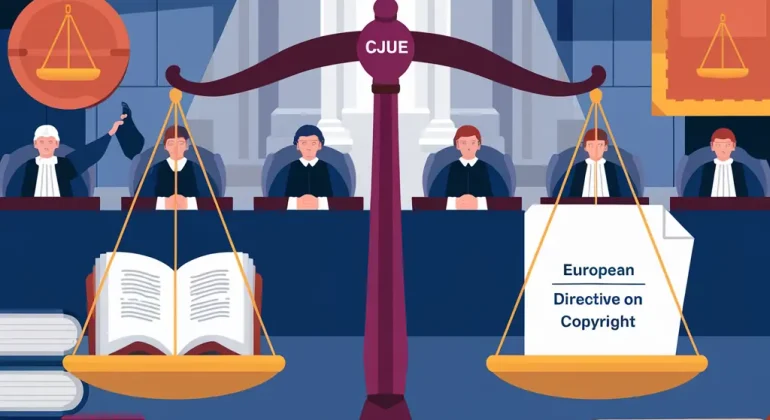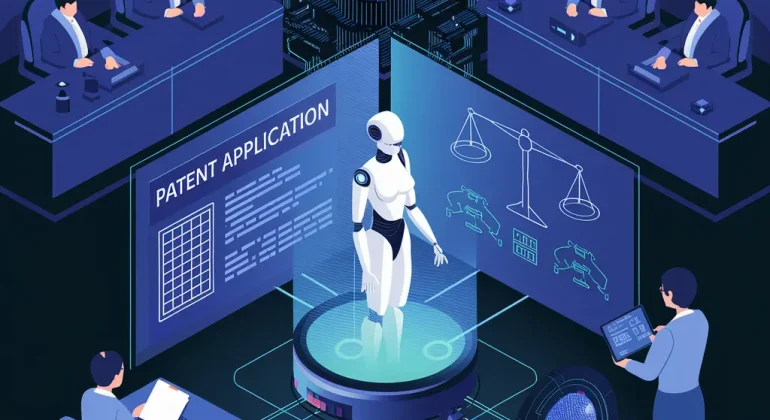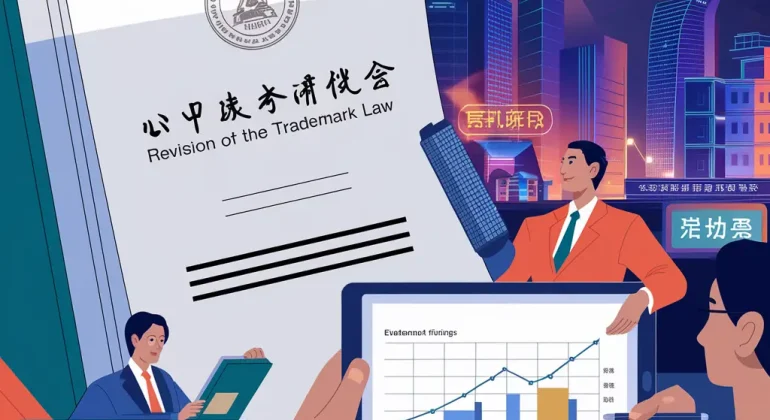Intelligence artificielle et propriété intellectuelle : comment protéger ses créations et éviter les litiges ?
Une révolution technologique, un vide juridique
L’intelligence artificielle (IA) bouleverse déjà nos modes de création et d’innovation. En quelques secondes, un logiciel peut générer une image, composer une musique, écrire un texte ou contribuer à une découverte scientifique.
Mais une question persiste : à qui appartiennent ces créations ?
Le droit de la propriété intellectuelle, façonné à une époque où l’auteur ou l’inventeur était nécessairement humain, se retrouve confronté à des zones grises. L’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni multiplient les clarifications, mais les règles diffèrent selon les juridictions.
Depuis plus de 20 ans, le cabinet Dreyfus accompagne entreprises, laboratoires, créateurs et startups dans la protection et la valorisation de leurs innovations. Cet article fait le point sur le cadre juridique actuel et propose des solutions pratiques pour sécuriser vos créations issues de l’IA.
IA et droit d’auteur – qui est le véritable auteur ?
L’originalité, critère central en droit européen
En droit de l’Union européenne, une œuvre est protégée si elle est originale, c’est-à-dire si elle reflète la personnalité de son auteur (directive 2001/29/CE, dite Infosoc).
Une création produite uniquement par un algorithme, sans intervention humaine significative, ne répond pas à ce critère.
Exemple : une IA génère un logo en réponse à un prompt simple (“dessine-moi un vinyle rouge avec un cercle noir”). Ce visuel brut n’a pas de protection juridique autonome. En revanche, si un designer combine plusieurs outputs, fait des choix créatifs et retouche l’œuvre, l’apport humain peut justifier une protection par le droit d’auteur.
Les premiers litiges
Aux États-Unis, le Copyright Office a refusé en 2023 l’enregistrement d’œuvres 100 % générées par IA. En Europe, des actions en justice ont été engagées par des photographes et illustrateurs dénonçant l’utilisation de leurs images dans des datasets d’entraînement sans autorisation.
Marques et intelligence artificielle – opportunités et risques
Marques générées par IA : une fausse bonne idée
De nombreuses entreprises testent l’IA pour générer des noms ou logos de marques. Mais ces créations posent deux problèmes :
- Les noms proposés sont souvent trop descriptifs ou génériques (ex : “EcoWine”).
- Les logos peuvent reproduire, même involontairement, des formes proches de créations existantes.
Résultat : risque de refus par l’EUIPO ou l’INPI, voire de litige pour contrefaçon.
L’IA comme outil de protection
L’IA peut aussi devenir un allié stratégique. Certains cabinets utilisent déjà des algorithmes pour surveiller les dépôts de marques et détecter des imitations (variations orthographiques, logos similaires). Dreyfus s’appuie sur ces technologies, mais ajoute l’expertise juridique indispensable à toute décision.
Brevets et IA – qui est l’inventeur ?
Le cas DABUS
L’affaire DABUS a marqué un tournant : une IA avait généré deux inventions. Son concepteur, Stephen Thaler, a tenté de déposer des brevets en désignant l’IA comme inventeur.
- L’USPTO (États-Unis), l’EPO (Europe) et l’INPI (France) ont refusé.
- En 2023, la Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé que seul un être humain peut être inventeur.
Conséquences pour les entreprises
Les inventions “assistées par IA” restent brevetables, mais un inventeur humain doit être désigné.
Pour sécuriser vos brevets, documentez l’apport inventif humain (cahiers de laboratoire, contributions identifiées).
Les risques juridiques majeurs liés à l’IA
Violation des droits d’auteur dans les datasets
La directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (DSM) a introduit des exceptions pour la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM). Mais elle permet aux titulaires de droits de s’y opposer via un opt-out technique lisible par machine.
Si une IA est entraînée sur des œuvres protégées sans respect de cet opt-out, un risque de contentieux existe.
Contrefaçon involontaire
Une IA peut générer un logo ou un visuel proche d’une œuvre protégée. Si ce contenu est exploité commercialement, l’entreprise peut être poursuivie, même de bonne foi.
Responsabilité contractuelle
Qui est responsable en cas de litige ? L’éditeur de l’IA, l’utilisateur ou l’entreprise qui exploite l’output ?
Les réponses varient selon les juridictions, mais une chose est sûre : les contrats doivent préciser ces responsabilités.
Cartographie internationale – UE, USA, UK
Union européenne
- Directive Infosoc 2001/29/CE : impose l’originalité humaine.
- Directive DSM 2019/790 : encadre le TDM avec possibilité d’opt-out.
- AI Act (2024) : premier règlement européen sur l’IA. Il classe les systèmes par niveau de risque et impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général (GPAI) de publier un résumé des données d’entraînement.
États-Unis
- Copyright Office : œuvres générées sans apport humain refusées.
- USPTO : guidance 2024, contribution humaine “significative” obligatoire pour les brevets.
Royaume-Uni
- Cour suprême 2023 : une IA ne peut pas être inventeur.
- Débats en cours sur le droit d’auteur, mais aucune reconnaissance juridique autonome des œuvres IA.
Matrice de risques IA
| Usage | Risque | Recommandation |
| Création marketing (textes, images) | Moyen | Vérifier les similarités avant diffusion, documenter la part humaine. |
| Logos et chartes graphiques | Élevé | Recherche d’antériorités avant dépôt, audit visuel. |
| R&D et brevets | Moyen | Documenter l’apport humain dans les dossiers. |
| Fine-tuning sur données tierces | Élevé | Vérifier droits sur datasets, opt-out TDM, licences. |
Clauses contractuelles essentielles
- Propriété des outputs : cession des droits sur les contributions humaines, clarifiant la non-protection possible des outputs purement IA.
- Garanties et indemnités : engagement du prestataire à limiter le risque de contrefaçon et indemniser en cas de litige.
- Dataset et TDM : déclaration de conformité aux exceptions de la directive DSM et respect des opt-out.
- Inventorship : documentation de l’apport humain dans tout dépôt de brevet.
Roadmap de conformité en 90 jours
- Semaine 1-2 : cartographie des usages IA.
- Semaine 3-4 : audit PI (droits d’auteur, marques, brevets).
- Semaine 5-6 : rédaction de la charte IA interne.
- Semaine 7-8 : mise en place de contrôles de similarité et d’un registre datasets.
- Semaine 9-12 : dépôts stratégiques, veille internationale, formation équipes.
Checklist d’audit datasets
- Origine licite des sources.
- Respect des opt-out TDM (directive DSM).
- Licences compatibles avec l’usage commercial.
- Conservation des preuves et logs techniques.
- Publication d’un résumé des datasets pour conformité à l’AI Act.
Chiffres clés et tendances – IA & propriété intellectuelle
- Marché de l’IA : l’Union européenne estime que le marché mondial de l’IA atteindra plus de 300 milliards € d’ici 2030, avec une croissance annuelle de près de 20 % (Commission européenne, 2024).
- Contentieux : selon l’OMPI (WIPO), les procédures de litiges liés aux noms de domaine ont augmenté de plus de 20 % en 2023, notamment à cause du cybersquatting autour de termes liés à l’IA.
- Droit d’auteur : aux États-Unis, plus de 50 demandes d’enregistrement d’œuvres générées par IA ont déjà été rejetées par le Copyright Office entre 2022 et 2024.
- Brevets : l’Office européen des brevets (OEB) a constaté une hausse de 7 % des dépôts de brevets liés à l’IA en 2023, en particulier dans la santé, la chimie et les télécoms.
- Confiance des entreprises : un sondage de la Commission européenne (2024) révèle que 62 % des dirigeants européens considèrent le manque de clarté juridique comme le principal frein à l’adoption de l’IA.
L’approche Dreyfus
Le cabinet Dreyfus se positionne comme pionnier dans l’accompagnement des entreprises face aux défis de l’IA :
- Analyse juridique : audit des pratiques et identification des risques.
- Stratégie PI : dépôts ciblés, contrats, chartes internes.
- Contentieux : expertise en litiges complexes, en France et à l’international.
- Veille réglementaire : suivi constant des évolutions (AI Act, jurisprudence DABUS, directives européennes).
Conclusion – Anticiper pour innover sereinement
L’IA est une formidable opportunité, mais elle impose une vigilance juridique accrue. Entre droit d’auteur, marques, brevets, datasets et nouvelles obligations de l’AI Act, les entreprises doivent s’armer de solutions solides.
Avec le cabinet Dreyfus, transformez la complexité juridique en avantage compétitif durable.
Audit flash IA x PI : en 10 jours, nous identifions vos risques, rédigeons vos clauses et priorisons vos dépôts.
FAQ – IA et propriété intellectuelle
Une œuvre générée par IA est-elle protégée en Europe ?
Non, sauf si une intervention humaine significative la rend originale (directive Infosoc).
Puis-je déposer un logo généré par IA comme marque ?
Oui, mais uniquement après un audit de distinctivité et de similarités.
Une invention IA peut-elle être brevetée ?
Oui, si un inventeur humain est désigné, conformément aux pratiques de l’USPTO, de l’EPO et de l’INPI.
Qu’est-ce que l’opt-out TDM de la directive DSM ?
C’est la possibilité pour un auteur de s’opposer à l’extraction de ses œuvres par des IA via un signal technique lisible par machine.
Quelles sont les obligations de l’AI Act ?
Les modèles GPAI devront publier un résumé des datasets utilisés et respecter des obligations de transparence.
Qui est responsable en cas de contrefaçon générée par IA ?
Sans clause contractuelle claire, l’entreprise exploitante peut être tenue responsable.
Une charte interne IA est-elle obligatoire ?
Pas légalement, mais elle est fortement recommandée pour réduire les risques.
Combien coûte une action UDRP pour récupérer un nom de domaine IA ?
En moyenne 1 500 à 4 000 €, selon le prestataire et la complexité du litige.
Les offices reconnaissent-ils l’IA comme inventeur ?
Non. Tous les offices exigent un inventeur humain.
Comment intégrer l’IA dans une stratégie PI ?
Par des dépôts ciblés, des contrats solides et une veille active sur les outputs et datasets.