Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas
Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.
Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :
-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire
à
-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas
au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.
Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.
Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni – une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.
D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.
D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.
Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.
Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?
-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?
La CJUE apporte les réponses suivantes :
-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;
* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;
*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;
-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.
En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment au Royaume-Uni.
Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.
Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.


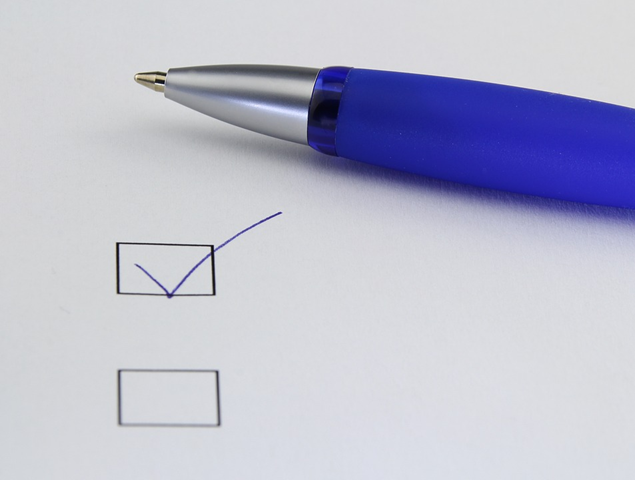


 Avec le développement des réseaux sociaux, la créativité sur Internet s’est déployée au point qu’il devient presque impossible pour un artiste ou
Avec le développement des réseaux sociaux, la créativité sur Internet s’est déployée au point qu’il devient presque impossible pour un artiste ou 
 En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.
En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.

 Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.
Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.
 Source :
Source : 
 Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.
Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.
 Avec la publication du
Avec la publication du