Comprendre la Déclaration d’Usage dans le droit des marques en Argentine : Notre guide complet
En Argentine, la protection robuste des droits de propriété intellectuelle, notamment des marques, repose largement sur le respect des procédures. L’une des exigences procédurales est le dépôt d’une Déclaration d’Usage, qui joue un rôle central dans le cycle de vie d’une marque.
Ce guide explore les subtilités de cette exigence, ses implications pour les détenteurs de marques, et les processus juridiques et administratifs associés.
L’impératif légal de la Déclaration d’Usage
Selon le droit des marques argentin, chaque détenteur de marque est obligé de déposer une déclaration d’usage à mi-parcours, connue sous le nom de Déclaration d’Usage, entre le cinquième et le sixième anniversaire de l’enregistrement de sa marque. Cette déclaration sert de point de contrôle clé pour assurer que les marques enregistrées dans le pays sont activement utilisées dans le commerce.
Le non-respect de cette exigence a des répercussions significatives. Principalement, l’Office des Marques n’approuvera aucune demande de renouvellement pour la marque tant que la Déclaration d’Usage n’aura pas été correctement déposée pour la période d’enregistrement concernée. Ce mécanisme garantit que seules les marques activement utilisées continuent de bénéficier des protections légales offertes par l’enregistrement.
Contenu et dépôt de la Déclaration
La Déclaration d’Usage implique de soumettre une déclaration écrite qui liste les produits et/ou services pour lesquels la marque a été activement utilisée au cours des cinq dernières années. Cette liste doit englober tous les produits ou services qui relèvent de la portée de protection de la marque, pouvant s’étendre à des produits ou services connexes même dans différentes classes ou utilisés comme désignation commerciale.
Il est crucial de noter qu’au moment de ce dépôt, l’Office des Marques n’exige pas de preuve de d’usage réelle. L’objectif principal est de recevoir une déclaration formelle du détenteur de la marque. Cependant, si la déclaration n’est pas soumise en temps opportun, cela déclenche une présomption réfutable de non-utilisation. Cela ne mène pas automatiquement à l’annulation de l’enregistrement mais rend la marque vulnérable à des actions en annulation. Ces actions peuvent être initiées par des tiers démontrant un intérêt légitime ou par le PTO lui-même.
Concomitance avec le renouvellement et sanctions potentielles
La Déclaration peut également être déposée en même temps que la demande de renouvellement de la marque. Dans ces cas, elle doit être soumise immédiatement avant la demande de renouvellement et via un processus spécifique adapté à chaque classe concernée. Si la déclaration accompagne un renouvellement, des frais officiels annuels supplémentaires sont imposés.
Soyez conscient que le dépôt d’une fausse déclaration, que ce soit par erreur ou fraude, peut précipiter des procédures d’annulation. Ces procédures peuvent être initiées par tout tiers ayant un intérêt légitime et sont jugées à travers un processus judiciaire, soulignant l’importance de l’exactitude et de l’honnêteté dans le dépôt.
Frais et détails administratifs
Le coût du dépôt de la Déclaration d’Usage est relativement modeste. Le tarif s’entend par marque et par classe. Un dépôt tardif pendant la période de grâce est également possible.
Exigences documentaires
Pour déposer la Déclaration d’Usage, certains documents sont essentiels :
- Pouvoir (PoA) : Un pouvoir dûment signé par un représentant autorisé doit être notariée et légalisée soit via une Apostille, soit directement au consulat argentin. Bien qu’une copie scannée du PoA suffise pour respecter les délais initiaux, l’original devrait être disponible sur demande de l’Office.
- Liste des produits/services : Une liste détaillée des produits et/ou services associés à l’utilisation de la marque au cours des cinq dernières années doit être fournie. Cette documentation doit couvrir de manière exhaustive la portée de protection de la marque et les usages commerciaux connexes.
Conclusion
La Déclaration d’Usage est un élément fondamental du droit des marques en Argentine, garantissant que les marques ne sont pas simplement enregistrées mais activement employées dans le commerce. En adhérant à ces exigences, les détenteurs de marque peuvent sauvegarder leurs droits et maintenir l’intégrité de leurs marques sur le marché argentin.
Chez Dreyfus, nous comprenons les complexités du droit des marques en Argentine. Notre équipe expérimentée offre un soutien juridique complet pour assurer que votre Déclaration d’Usage soit déposée avec précision et dans les délais, protégeant ainsi vos précieux droits de marque. Faites-nous confiance pour naviguer dans les subtilités du droit des marques en Argentine, garantissant la protection effective de vos actifs de propriété intellectuelle.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !







 Chez Dreyfus, nous savons combien il est crucial de protéger et de valoriser les actifs immatériels de votre entreprise. C’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement sur mesure avec le Diagnostic Stratégie PI, une initiative soutenue par Bpifrance.
Chez Dreyfus, nous savons combien il est crucial de protéger et de valoriser les actifs immatériels de votre entreprise. C’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement sur mesure avec le Diagnostic Stratégie PI, une initiative soutenue par Bpifrance.










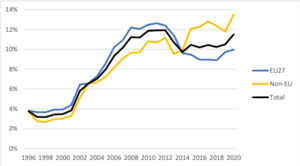

 L’effervescence autour de l’imminence des Jeux Olympiques de Paris démontre les liens entre les marques et les sportifs. Dans un environnement médiatique où l’authenticité et la visibilité sont cruciales pour le succès commercial, les partenariats avec des athlètes olympiques et paralympiques représentent des opportunités exceptionnelles de visibilité pour les marques. Cependant, ces collaborations doivent être méticuleusement gérées dans le cadre d’une législation précise, pour prévenir toute transgression comme le marketing d’embuscade ou la violation des droits de
L’effervescence autour de l’imminence des Jeux Olympiques de Paris démontre les liens entre les marques et les sportifs. Dans un environnement médiatique où l’authenticité et la visibilité sont cruciales pour le succès commercial, les partenariats avec des athlètes olympiques et paralympiques représentent des opportunités exceptionnelles de visibilité pour les marques. Cependant, ces collaborations doivent être méticuleusement gérées dans le cadre d’une législation précise, pour prévenir toute transgression comme le marketing d’embuscade ou la violation des droits de