L’opposition est une procédure déterminante pour assurer la protection du droit de marque. Elle permet de résoudre un potentiel contentieux le plus tôt possible, de façon simple et dans des coûts et délais raisonnables.
Suite à la transposition du « Paquet Marques » en droit français, les modifications apportées à la procédure d’opposition assurent désormais aux titulaires de droits une protection étendue face aux demandes d’enregistrement de marques leur portant atteinte.
Le premier changement important est l’élargissement des droits antérieurs pouvant servir de fondement à l’opposition auprès de l’INPI. Jusqu’à présent, il était possible de former une opposition uniquement sur le fondement d’une seule marque antérieure déposée, enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris ; une appellation d’origine ou une indication géographique protégée ; le nom, la réputation ou l’image d’une collectivité territoriale.
Désormais, l’article L712-4 du CPI, tel que modifié par l’ordonnance du 13 novembre 2019, permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque sur les fondements suivants:
– une marque antérieure (française, de l’Union européenne, ou internationale désignant la France ou l’Union européenne ; notoire ; jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne, sous certaines conditions).
– une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l’esprit du public,
– un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
– une appellation d’origine ou une indication géographique,
– le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunal,
– le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette nouvelle disposition ouvre également la possibilité à l’opposant d’invoquer, le cas échéant, plusieurs droits lors de la formation de l’opposition.
La seconde modification importante concerne le déroulement de l’opposition.
Tout comme dans l’ancienne procédure, l’opposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse pour former son opposition. Toutefois, il dispose désormais d’un mois supplémentaire pour présenter l’exposé des moyens ainsi que les pièces justificatives relatives à l’existence et à la portée de ses droits. On parlera alors, dans un premier temps, d’opposition « formelle » comme ce peut être le cas auprès de l’EUIPO, jusqu’à ce que le mémoire au fond soit déposé, dans un second temps, dans l’hypothèse où les Parties n’auraient pas solutionné leur litige à l’amiable dans l’intervalle.
S’ouvre ensuite la phase contradictoire de l’opposition, durant laquelle les Parties échangent des pièces et arguments de façon écrites. A l’occasion de ces observations écrites, elles peuvent demander la tenue d’une audience orale. Par respect du principe du contradictoire, aucun nouveau moyen ni de nouvelles pièces ne peuvent être présentés pendant l’audience.
Selon le nombre d’échanges entre les Parties, cette première phase d’instruction peut durer entre 6 mois et 1 an. A l’issue de ce délai, le directeur de l’INPI doit rendre une décision dans les 3 mois qui suivent.
Les modifications apportées par la transposition de la directive européenne en droit français apporte une protection accrue aux titulaires de droits. Cette nouvelle procédure est plus précise car elle a été limitée par la définition de délais courts et non extensibles. Elle permet également de fonder l’opposition sur un nombre plus important de droits antérieurs, mettant ainsi la protection des titulaires au premier rang des enjeux de cette procédure.
Cette nouvelle procédure d’opposition s’applique pour toutes les demandes d’enregistrement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019.
Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde et vous accompagner dans vos procédures d’opposition. N’hésitez pas à nous contacter.
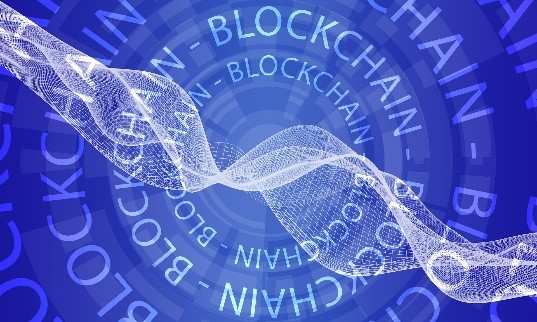
La Blockchain est une base de données (une liste croissante d’enregistrements, appelés « blocs ») qui sont reliés par cryptographie. Chaque bloc contient un hachage cryptographique du bloc précédent, un horodatage et des données de transactions.
Il s’agit d’un registre fiable et transparent auquel chacun peut accéder et contenant l’historique des échanges effectués entre les utilisateurs. Toutefois, une fois enregistrées, les données d’un bloc ne peuvent être modifiées rétroactivement sans modification de tous les blocs suivants, ce qui requiert le consensus des opérateurs du réseau. Ce système décentralisé et sécurisé permet d’économiser du matériel pendant une durée illimitée.
La blockchain présente une grande utilité pratique en matière de traçabilité de vos droits de propriété intellectuelle.
D’une part, en raison de son faible coût et de sa rapidité. La baisse des coûts s’explique par le contournement des intermédiaires. Concernant sa rapidité, il suffit seulement d’ouvrir un compte et de télécharger le document qui correspondra aux informations de votre création.
D’autre part, toutes les étapes concernant vos créations sont enregistrées ; que ce soit la date de première demande d’enregistrement, de première utilisation dans le commerce ou d’une cession etc. De même, des opérations telles que les fusions ou acquisitions sont effectuées de manière plus aisée, pouvant être opérées directement via la base de données.
Le document contenant les informations relatives à votre création n’est pas conservé dans la blockchain, mais seulement son empreinte numérique. Par conséquent, il est impossible pour les tiers d’avoir accès à son contenu, vous êtes le seul à pouvoir y accéder. Vous pouvez donc rester serein quant à la préservation de vos données.
Grâce à la blockchain, la preuve de la création est facilitée et la procédure accélérée, la Blockchain permettant de donner heure et date certaines d’enregistrement de la création. Elle permet également de tracer l’exploitation sur le web des œuvres numériques.
Néanmoins, pour acquérir force incontestable de preuve, il convient de faire constater les preuves concernés par un constat d’huissier de justice. L’huissier de justice est en mesure d’établir une preuve incontestable de paternité et d’antériorité devant un juge.
La blockchain est un registre infalsifiable, apportant la preuve de l’authenticité de vos créations et limitant donc les possibilités de contrefaçon. Ce système indique qui est l’auteur de la création et donc un élément de preuve non négligeable pour constater la date réelle de la création.
La blockchain comporte de nombreux avantages en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Que ce soit la sécurité, la transparence, le coût inférieur, la rapidité, la facilité de preuve, la confidentialité ou encore la certitude de l’authenticité : ses atouts sont multiples et favorables à la protection de vos créations.
Avec le service de Blockchain Dreyfus, nous proposons une protection simple, efficace et sécurisée pour vos créations.

Cette année la conférence portera sur le thème suivant : « La propriété intellectuelle, moteur de l’innovation et de la croissance économique« . Lors de ce forum de trois jours seront évoqués les récents développements en matière de propriété intellectuelle et leur synchronisation avec les objectifs commerciaux.
Nathalie Dreyfus interviendra le 8 novembre de 13h30 à 15h sur le panel intitulé « Comment les technologies émergentes peuvent-elles être adoptées dans le système actuel du droit de la propriété intellectuelle ? ».
Pour rappel, World Intellectual Property Forum est l’occasion d’assister à de nombreuses conférences dirigées par des spécialistes de la propriété intellectuelle. Ils partageront les dernières tendances, idées et stratégies en matière d’obtention de brevets, de litiges, de marques et autres questions d’actualité liées à la propriété intellectuelle. Ce forum offre également aux participants de multiples moments de rencontre avec des entrepreneurs visionnaires et des experts de l’industrie partout dans le monde.
Plus d’information sur l’événement : https://www.worldipforum.com/
Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.
Federal Bar Association
La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.
Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.
Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.
*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.
Informations
Où : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris
Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

Parmi les précisions apportées, la Cour Suprême russe a notamment décidé que les tribunaux de commerce étaient compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux signes distinctifs (à l’exception toutefois des appellations d’origine), que la partie concernée soit une personne individuelle, un entrepreneur privé ou une société. Auparavant, les tribunaux de commerce et les tribunaux de droit commun étaient compétents en fonction de l’identité des titulaires des droits de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, s’agissant de l’obtention des informations relatives à l’identité des réservataires de noms de domaine russes, il est de plus en plus difficile de récupérer ces informations.
En effet, bien qu’effectuer une demande de divulgation de l’identité des réservataires de noms de domaine auprès des bureaux d’enregistrement soit possible, obtenir les informations escomptées est devenu de plus en plus compliqué sans une action judiciaire puisque beaucoup de bureaux d’enregistrement refusent de dévoiler ces informations en se réfugiant derrière la législation applicable ou en demandant des documents supplémentaires.
La Résolution n° 10/2019 précise que ces informations peuvent être obtenues par le biais d’un tribunal en déposant une demande de divulgation des données personnelles lors d’une action judiciaire. Cependant, cela est compliqué quand l’identité des réservataires des noms de domaine est inconnue. Une des solutions serait d’engager une action judiciaire à l’encontre des bureaux d’enregistrement et de déposer par la suite une demande de divulgation des données personnelles. Il serait alors possible de substituer le défendeur.
En outre, en ce qui concerne les violations des droits de marques par la réservation et l’usage d’un nom de domaine, la Cour Suprême russe a déclaré que la violation d’une marque était caractérisée en cas d’utilisation d’un nom de domaine pour des produits et services similaires à ceux désignés par la marque en question, et dans certains cas encore, par la réservation du nom de domaine uniquement. Il faut tenir compte des fins de la réservation du nom de domaine afin de juger si une atteinte à une marque est caractérisée.
Enfin, la Cour Suprême russe apporte diverses précisions supplémentaires. Par exemple, une réclamation pécuniaire peut être déposée contre l’utilisateur actuel d’un nom de domaine. En outre, il est possible de demander des mesures provisoires en matière de noms de domaine. Enfin, elle a aussi affirmé que pour les affaires concernant des noms de domaine, sont recevables les preuves consistant en des captures d’écran imprimées de sites Internet dans lesquelles sont clairement affichées l’adresse des sites Internet en question, l’heure à laquelle les captures d’écran ont été réalisées et si elles ont été vérifiées par les parties à la procédure.
Ces précisions sont les bienvenues. Nous vous informerons de tout développement ultérieur à ce sujet. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des noms de domaines et peut trouver des solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter.
L’évolution des exigences techniques de l’univers numérique tend à rendre le WHOIS obsolète. En effet, cet outil, fourni par les registrars, se révèle notamment incapable de travailler avec l’encodage et ne prend pas en charge les polices non latines. C’est pourquoi depuis 2015, l’ICANN, épaulé par le groupe de travail d’ingénierie Internet (l’IEFT), travaille à la création du RDAP (Registration Data Access Protocol) ayant vocation à remplacer le WHOIS, dans le respect des Temporary Specifications et du RGPD.
À l’instar du WHOIS, le RDAP fournit des données d’enregistrement ; la différence réside cependant dans sa mise en œuvre, permettant la normalisation et la sécurisation des formats d’accès aux données et de réponses aux requêtes. Grâce au RDAP, il sera possible d’effectuer des recherches parmi toutes les données d’enregistrement disponibles chez les différents registrars, quand le WHOIS se limite à la base de données interrogée. Le RDAP prend aussi en compte l’internationalisation des noms de domaine.
La possibilité d’un accès différencié aux données d’enregistrement est également envisagée. Par exemple, un accès limité serait accordé aux utilisateurs anonymes alors que les utilisateurs authentifiés pourraient visualiser l’ensemble des données.
Si certains points sont encore à définir, les registrars sont tenus de mettre en œuvre un service de RDAP avant le 26 août 2019.
Cette brève a été publiée dans la Revue propriété industrielle de juillet-août 2019.

A de nombreuses occasions, nous avons remarqué que même les demandeurs représentés dans les procédures UDRP auraient pu être mieux informés de la nature et de l’étendue des droits sur lesquels le défendeur pouvait se fonder. Une recherche approfondie est un prérequis essentiel au dépôt d’une plainte, faute de quoi le succès de la plainte est compromis.
Le 7 janvier 2019, la société française Pharnext, ayant pour activité principale l’industrie pharmaceutique, a déposé une plainte UDRP demandant le transfert du nom de domaine <pharnext.com>, enregistré par une société chinoise.
La demanderesse a soutenu qu’elle détenait des droits sur la marque PHARNEXT, dès lors qu’elle était propriétaire du logo PHARNEXT, protégé par une marque internationale depuis 2013 et utilisé sur son site www.pharnext.com.
La demanderesse soutient que le défendeur devait avoir connaissance de la marque PHARNEXT lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, dès lors qu’en mai 2017, son partenariat avec une des sociétés pharmaceutiques les plus connues de Chine, Tasly, avait été annoncé. La demanderesse a également déclaré qu’il n’y avait pas de justification plausible à l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur. Elle a également prétendu avoir réalisé des perquisitions n’ayant rapporté aucune preuve que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l’égard de ce nom.
Cependant, le défendeur Xian Rong (Shanghai), a d’une part prouvé qu’il bénéficiait d’une licence sur la marque PHARNEXT pour des services financiers, et d’autre part, a précisé qu’il l’utilisait depuis décembre 2017. Bien que la propriété d’une marque ne confère pas automatiquement un intérêt légitime ou des droits au défendeur, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve à l’occasion de la plainte.
En l’espèce, l’experte était « convaincue que la marque PHARNEXT avait été enregistrée de bonne foi ». Elle a en outre relevé que le nom de domaine était utilisé, avant le dépôt de la plainte, en lien avec une véritable offre de produits et services. Ainsi, bien que le nom de domaine soit similaire à la marque de la demanderesse crée un risque de confusion, la plainte n’a pas été acceptée.
L’experte a souligné que « ses conclusions sont faites dans la limites de la plainte UDRP ; toute question ne relevant pas du champ d’application de la politique UDRP peut être traitée par les parties devant une juridiction compétente ». Simplement, la demanderesse n’a pas prouvé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré and utilisé de bonne foi.
Cette décision reflète une fois de plus qu’il est essentiel d’effectuer des recherches préliminaires sur tous les aspects de la plainte ; y compris sur le défendeur et sur le signe à l’origine duquel la nom de domaine contesté a été obtenu. Par exemple, la recherche du signe PHARNEXT sur les bases de données chinoises auraient permis à la demanderesse de connaître l’existence de la marque verbale PHARNEXT. Cela l’aurait alertée quant à une potentielle faiblesse et lui aurait permis d’envisager une stratégie différente. Il apparaît essentiel d’envisager tous les moyens de défense possibles qu’un défendeur pourrait invoquer afin de se préparer à les contredire.

L’une des premières étapes pour les entreprises étrangères est de décider d’un nom approprié pour le marché chinois. Les principaux textes législatifs régissant cette question sont le Règlement sur l’enregistrement et la gestion des dénominations sociales et les mesures d’application relatives à l’enregistrement et à l’administration des dénominations sociales, qui précisent comment le nom des sociétés chinoises devrait être structuré et quelles informations doivent être incluses.
En Chine, les noms d’entreprises doivent être composés, conformément à la réglementation susmentionnée, dans un format spécifique, qui est le suivant : i) Division administrative, ii) Nom commercial, iii) Industrie et iv) Forme organisationnelle, sauf exception prévue par la loi.
D’autres règlementations limitent le contenu des noms, interdisant l’utilisation de contenus susceptibles d’induire les consommateurs en erreur ou de compromettre la libre concurrence, de porter atteinte ou de contredire l’unité nationale, la politique, l’éthique sociale, la culture ou la religion. Les caractères spéciaux, tels que les chiffres arabes, les symboles ou alphabets étrangers, ne sont pas autorisés, et certains mots tels que « Chine », « chinois », « national », « État » ou « international » ne peuvent être utilisés qu’en de rares occasions.
Si certaines conditions sont remplies, une société peut utiliser une dénomination sociale sans inclure la division administrative. Ces conditions comprennent, entre autres, l’approbation par le Conseil d’État ou que la valeur du capital social soit supérieur à 50 millions de yuans. Si tel est le cas, l’autorisation peut être accordée par l’Administration d’Etat pour la régulation du marché.
Par conséquent, il semble clair que la caractéristique la plus importante dans le choix d’un nom d’entreprise en Chine est le nom commercial. Au vu du schéma établi précédemment, certains noms d’entreprises similaires pourraient coexister, sans pour autant poser de problème, à moins que la même marque n’ait déjà été enregistrée auparavant. Dans un tel cas, une contestation du nom commercial pourrait être tentée par le propriétaire de la marque.
L’affaire JINGKE illustre les conflits qui peuvent survenir entre les noms commerciaux et les marques de commerce. Le 29 novembre 2010, la société Shanghai Precision & Scientific Instrument Co, Ltd. (PI) a intenté une action contre les sociétés Shanghai Jingxue Scientific Instrument Co, Ltd. (Jingxue) et Chengdu Kexi Complete Sets of Instruments Co, Ltd. (Kexi) devant le Tribunal populaire de Shanghai Pudong. Elle reprochait aux défendeurs d’avoir enregistré et utilisé sa dénomination sociale sous la forme abrégée « 精科 » (JINGKE en chinois).
Celle-ci étant une marque de renommée, bien connue dans l’industrie, son usage par les défendeurs était alors constitutive de faits de concurrence déloyale causant de graves préjudices aux intérêts légitimes du demandeur.
La société demanderesse réclamait alors des interdictions et des mesures compensatoires à l’encontre des défendeurs.
Les défendeurs soutenaient que Kexi était propriétaire de la marque JINGKE, et que son usage était protégé par la loi. En outre, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle contre le demandeur pour contrefaçon de la marque SHANGHAI JINGKE en relation avec ses produits et emballages.
Le tribunal conclut qu’avant la demande d’enregistrement de la marque JINGKE, « Shanghai Jingke » et « Jingke » avaient été utilisés en tant que dénomination sociale abrégée. Ils méritaient donc une protection à ce titre ;
Le tribunal a estimé que :
D’une part, le défendeur Kexi dispose de droits sur l’enregistrement de la marque ; et d’autre part, que le défendeur Jingxue a utilisé la marque JINGKE avec la permission du défendeur Kexi. Dès lors, ces deux usages constituent toutes deux une violation de la dénomination sociale du demandeur et les défendeurs sont donc coupables de faits de concurrence déloyale.
Le tribunal a ainsi condamné les défendeurs pour concurrence déloyale et a accordé des dommages-intérêts.
Les défendeurs ont fait appel devant le Tribunal populaire intermédiaire no 1 de Shanghai. La Cour d’appel a estimé que les dénominations sociales abrégées peuvent être considérées comme des dénominations sociales, dès lors qu’elles ont acquis une certaine notoriété sur le marché, sont devenues connues des secteurs pertinents et ont été utilisées comme dénominations sociales.
Lorsque, par la suite, des tiers utilisent des dénominations sociales abrégées ayant acquises une telle renommée, sans autorisation, ils sont susceptibles de créer une confusion sur le marché pertinent, comme le prévoit l’Art.5, Cl. 3 de la loi sur la concurrence déloyale régissant la protection des dénominations sociales. Pour cette raison, l’appel a été rejeté et le jugement ci-dessous confirmé.
Un cas plus récent, montrant les conflits susmentionnés, est survenu entre Chengdu Huamei et Shanghai Huamei. En 2017, Chengdu Huamei a agi contre Shanghai Huamei, au motif que : (1) Shanghai Huamei avait utilisé le nom commercial « Huamei » sans l’autorisation de Chengdu Huamei, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale ; et (2) Shanghai Huamei avait violé les droits de marque de Chengdu Huamei en utilisant fréquemment et de manière visible des expressions telles que « Huamei », « Shanghai Huamei », « Huamei dentaire » et « Huamei plastique » dans ses locaux professionnels.
La décision de première instance, confirmée en appel par la suite, l’a confirmé :
« Le simple fait d’avoir une dénomination sociale identique ne permettrait pas de conclure que Shanghai Huamei a commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Par ailleurs, la plupart des utilisations de « Huamei » ou de « Shanghai Huamei » à des fins publicitaires relevaient de l’usage loyal de la marque de Shanghai Huamei. Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation des signes contenant « Huamei Dental », « Huamei Plastics » et « Shanghai Huamei » qui étaient similaires aux marques en cause, le tribunal a estimé qu’elle pouvait facilement créer une confusion parmi le public et constituait donc une contrefaçon de marque ».
Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.
Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection
des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.
D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.
D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.
Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.
Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :
Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.
Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.
Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.
A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).
Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.
Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.
Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.