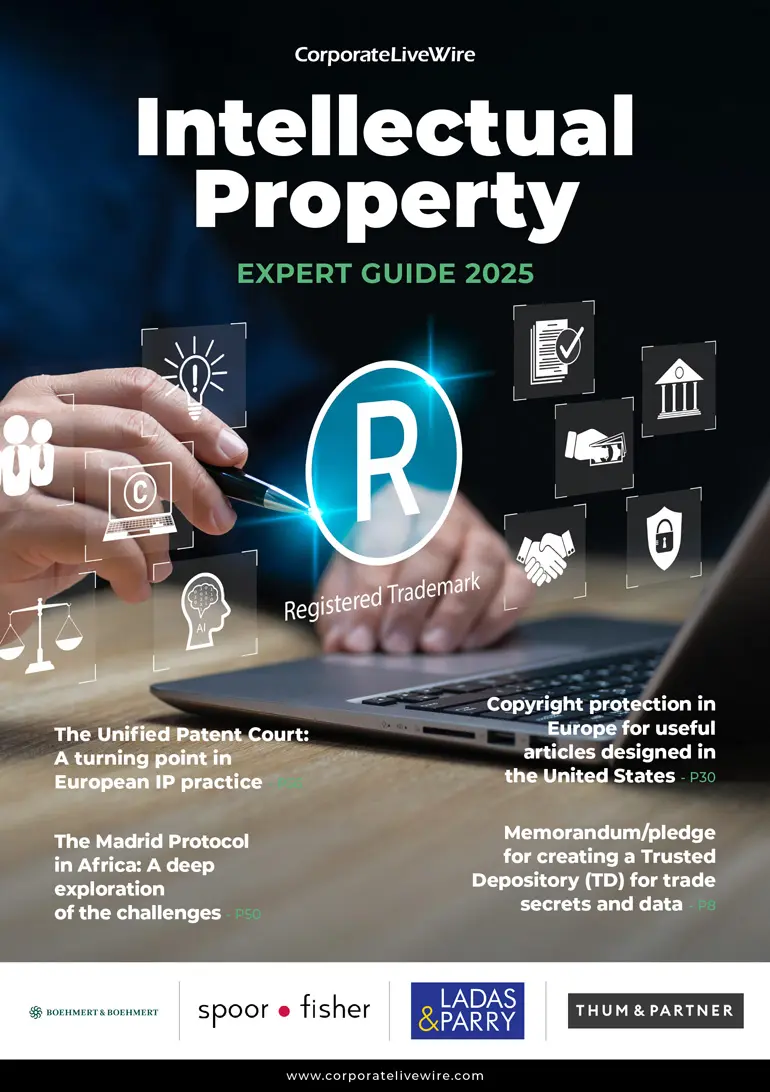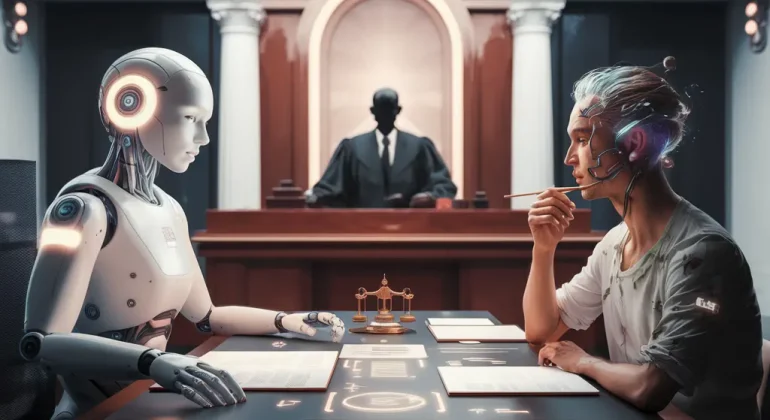DeepSeek : L’émergence d’un nouveau géant de l’IA en Chine
Dans un paysage en constante évolution, l’intelligence artificielle (IA) voit régulièrement émerger de nouveaux acteurs capables de bouleverser les paradigmes existants. L’un de ces nouveaux entrants est DeepSeek, une startup chinoise spécialisée dans l’IA qui attire l’attention grâce à ses approches innovantes et à ses performances compétitives. Alors que de nombreuses entreprises envisagent d’intégrer DeepSeek à leurs opérations, il est essentiel de bien comprendre non seulement ses capacités, mais aussi les implications juridiques, les risques liés à la confidentialité des données et les enjeux en matière de propriété intellectuelle qui en découlent.
I – Présentation de DeepSeek
A – Développement et lancement
DeepSeek, officiellement connu sous le nom de Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., a dévoilé son modèle open-source R1 le 27 janvier 2025. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions dans le secteur technologique américain, notamment après que des rapports ont révélé que DeepSeek avait atteint des performances comparables à celles de modèles établis comme o1-mini d’OpenAI, mais pour environ 5 % des coûts de développement. Ce développement remet en question l’idée selon laquelle l’avancement des modèles de langage de grande taille (LLM) nécessite des ressources financières et informatiques considérables.
B – Fonctionnalités clés et performances
Le modèle R1 de DeepSeek est conçu pour gérer une large gamme de tâches complexes avec une efficacité remarquable. Son caractère open-source permet aux utilisateurs de télécharger et d’exécuter le modèle localement, sans nécessiter de stockage de données sur les plateformes cloud contrôlées par DeepSeek. Cette flexibilité a attiré un grand nombre de développeurs explorant DeepSeek comme une alternative viable aux modèles existants.
II – Considérations juridiques pour les entreprises
A – Propriété des données et droits d’utilisation
Les entreprises doivent être prudentes lorsqu’elles utilisent les plateformes en ligne de DeepSeek, telles que ses applications iOS, Android ou ses interfaces web. La politique de confidentialité de DeepSeek accorde à l’entreprise des droits étendus sur l’exploitation des données des utilisateurs collectées via les interactions et les appareils. Cela comprend :
- La surveillance des interactions,
- L’analyse des modèles d’utilisation,
- L’utilisation des données pour entraîner et améliorer la technologie de DeepSeek.
DeepSeek se réserve également le droit de partager ces informations avec des partenaires publicitaires, des sociétés d’analyse et des tiers impliqués dans des transactions d’entreprise.
B – Conformité aux lois internationales
Le stockage de toutes les données personnelles sur des serveurs situés en Chine soulève des problématiques de conformité avec les lois internationales sur le commerce et la protection des données, qui peuvent restreindre ou interdire les transferts de données vers certains pays étrangers, y compris la Chine. Les entreprises doivent donc examiner attentivement les conditions de confidentialité de DeepSeek afin de garantir la conformité avec leurs propres politiques de sécurité et leurs engagements envers leurs clients.
III – Confidentialité et sécurité des données
A – Stockage et transfert des données
La pratique de DeepSeek consistant à stocker les données des utilisateurs sur des serveurs situés en République populaire de Chine (RPC) soulève d’importantes préoccupations en matière de confidentialité. L’environnement réglementaire chinois diffère considérablement de cadres comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne ou le California Consumer Privacy Act (CCPA) des États-Unis. Les utilisateurs doivent être conscients que leurs données peuvent être accessibles aux autorités chinoises sans les garanties strictes existant dans d’autres juridictions.
B – Risques potentiels pour les entreprises
Pour les entreprises manipulant des informations sensibles ou confidentielles, l’utilisation des plateformes en ligne de DeepSeek pourrait représenter un risque en termes de confidentialité. Les droits d’utilisation étendus revendiqués par DeepSeek pourraient être en contradiction avec les obligations légales des entreprises visant à protéger les données clients ou les secrets commerciaux. Il est donc essentiel d’évaluer ces risques et d’envisager l’exécution locale du modèle afin de conserver un contrôle total sur les données.
IV – Enjeux liés à la propriété intellectuelle
A – Accusations d’utilisation non autorisée
Des rapports récents indiquent qu’OpenAI accuse DeepSeek d’avoir utilisé illégalement ses modèles d’IA, soulevant d’importantes préoccupations juridiques et éthiques. OpenAI affirme qu’il existe des preuves suggérant que DeepSeek a utilisé illicitement ses modèles pour améliorer ses propres systèmes d’IA.
B – Implications pour le développement de l’IA
Si ces accusations sont confirmées, elles pourraient avoir des répercussions majeures sur l’industrie de l’IA, en particulier en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle et le développement éthique des technologies d’intelligence artificielle. Les entreprises doivent suivre ces évolutions de près, car elles pourraient influencer le cadre juridique entourant l’utilisation et le développement des outils d’IA.
V – DeepSeek AI : préoccupations en matière de confidentialité et actions réglementaires en Europe
Contrairement à d’autres modèles d’IA, DeepSeek est open-source et entièrement gratuit. Cependant, son utilisation soulève des préoccupations majeures en matière de protection des données et de conformité avec le RGPD.
Les autorités européennes de protection des données ont exprimé leurs inquiétudes quant aux pratiques de collecte et de traitement des données de DeepSeek. Par exemple, la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) du Luxembourg a mis en garde contre les risques liés à DeepSeek, soulignant que les entrées des utilisateurs pourraient être enregistrées, transférées et analysées sans cadre de protection des données clair.
En réponse, certaines autorités réglementaires ont pris des mesures concrètes :
- L’Autorité italienne de protection des données (Garante) a bloqué l’application DeepSeek en Italie, l’entreprise n’ayant pas fourni les informations demandées concernant sa politique de confidentialité et ses pratiques de traitement des données.
Ces actions illustrent les défis posés par l’émergence rapide de modèles d’IA comme DeepSeek, notamment en matière de conformité avec les réglementations européennes sur la protection des données.
Conclusion
DeepSeek représente une avancée significative dans le domaine de l’IA, offrant des capacités prometteuses pour de nombreuses applications professionnelles. Toutefois, son utilisation s’accompagne de risques potentiels, notamment sur le plan juridique, de la protection des données et de la propriété intellectuelle. Une due diligence approfondie et des consultations avec des experts en protection des données et en propriété intellectuelle sont essentielles avant d’intégrer DeepSeek dans les opérations commerciales.
Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !
Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle afin d’offrir des solutions juridiques sur mesure dans le domaine en constante évolution de l’IA et du droit d’auteur.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
FAQ
1 – Quel est le lien entre l’intelligence artificielle et les données personnelles ?
L’intelligence artificielle (IA) repose sur le traitement et l’analyse de vastes ensembles de données pour apprendre, identifier des tendances et faire des prédictions. Lorsqu’une IA traite des informations permettant d’identifier une personne (nom, adresse, historique de navigation, empreintes biométriques, etc.), ces données sont considérées comme personnelles et sont soumises à des réglementations strictes, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.
2 – Comment l’intelligence artificielle traite les données ?
Les systèmes d’IA traitent les données via des algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) ou d’apprentissage profond (deep learning). Ces modèles sont entraînés sur de grandes quantités de données pour reconnaître des schémas et améliorer leurs prédictions. Le traitement peut inclure : • La collecte et le stockage de données • Le nettoyage et la structuration des informations • L’analyse et la modélisation des tendances • La prise de décision automatisée basée sur les résultats de l’analyse Dans un cadre conforme aux réglementations, les données doivent être utilisées de manière transparente, minimisée et sécurisée.
3 – Quel est le cadre juridique de l’IA ?
L’IA est régulée par plusieurs cadres juridiques à l’échelle nationale et internationale. En Europe, elle est principalement encadrée par : • Le RGPD, qui impose des obligations strictes sur la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles. • La proposition de Règlement européen sur l’IA (AI Act), qui vise à classer les systèmes d’IA selon leur niveau de risque et à imposer des obligations spécifiques aux développeurs et utilisateurs. • D’autres réglementations sectorielles, comme celles relatives à la protection des consommateurs, la cybersécurité et la responsabilité en cas d’erreurs ou de dommages causés par une IA.
4 – L’IA prend-elle vos informations personnelles ?
Une IA peut traiter des informations personnelles si elle est conçue pour analyser des données d’utilisateurs (ex. reconnaissance faciale, recommandations personnalisées, assistants virtuels). Toutefois, les entreprises et organisations qui exploitent ces technologies doivent respecter les principes de transparence, minimisation des données et consentement des utilisateurs. Les systèmes d’IA responsables doivent intégrer des mécanismes de protection des données, comme l’anonymisation, le chiffrement et le contrôle des accès, afin d’éviter tout usage abusif ou non conforme aux réglementations.
5 – Le RGPD s’applique-t-il à l’IA ?
Oui, le RGPD s’applique à toute IA qui traite des données personnelles, indépendamment du type de technologie utilisée. Les obligations clés incluent : • L’obtention du consentement explicite de l’utilisateur pour la collecte et l’utilisation de ses données. • Le respect du principe de minimisation des données, c’est-à-dire limiter la collecte aux seules informations strictement nécessaires. • La mise en place de mesures de sécurité pour protéger les données traitées par l’IA. • Le droit à l’explication, qui permet aux individus d’obtenir des informations sur le fonctionnement des décisions automatisées. • Le droit à l’effacement des données personnelles sur demande. Ainsi, toute organisation utilisant l’IA doit s’assurer que ses systèmes sont conformes aux exigences du RGPD et aux autres législations en vigueur.