La Marque de Motif Birkenstock : entre tradition et distinctivité en propriété intellectuelle

Ces chaussures ont connu une popularité croissante en Allemagne et la marque s’est étendue à l’international dans les années 1960.
Depuis lors, la marque a évolué pour devenir synonyme de confort et de bien-être pour les pieds. Le modèle de sandale Birkenstock, avec sa semelle en liège et latex, adaptée à la forme du pied, est devenu une icône de la mode et du confort.
Le motif de semelle Birkenstock est au cœur de plusieurs décisions des tribunaux Allemand et Européen.
Ce motif composé de vagues est devenu emblématique pour la marque, et Birkenstock a cherché à le protéger en tant que marque.
Contexte :
En 2016, la société Birkenstock a obtenu la protection d’une marque de position en Allemagne pour un motif distinctif sur la semelle de leurs chaussures (numéro d’enregistrement 3020150531693).
- Une marque de position est un type de marque qui se distingue par son emplacement spécifique sur un produit ou son emballage, plutôt que par des éléments verbaux ou figuratifs traditionnels.
Un tiers a déposé une demande d’annulation de la marque auprès de l’Office allemand des brevets et des marques, alléguant que la marque manquait de distinctivité et de clarté pour les produits qui n’avaient pas de semelle.
- La distinctivité se réfère à la capacité d’une marque à se démarquer des produits ou services similaires sur le marché.
L’Office allemand des brevets et des marques a déclaré la marque de Birkenstock invalide en raison de son manque de distinctivité.
Birkenstock a donc fait appel de cette décision devant le Tribunal allemand des brevets et des marques (case no. 28 W (pat) 24/18).
Le Tribunal allemand des brevets et des marques a rejeté l’appel de Birkenstock en se basant sur la jurisprudence existante concernant les marques de motif. Le tribunal a confirmé que la marque manquait de distinctivité pour les produits ayant ou faisant partie d’une semelle et pour les produits qui n’avaient aucune relation avec les semelles.
- En effet, rappelons qu’une marque doit être suffisamment unique pour permettre aux consommateurs de l’associer à une source commerciale particulière. C’est cette distinctivité qui confère à une marque sa valeur et sa protection légale.
En parallèle de ces procédures en Allemagne, une décision similaire avait été rendue au niveau de l’Union européenne, où la Cour générale de l’Union européenne avait confirmé l’annulation de la marque de Birkenstock pour l’ensemble de l’Union européenne (affaire T-365/20).
En fin de compte, la marque de position de Birkenstock a été déclarée non distinctive pour les produits concernés, que ce soit en Allemagne ou au niveau de l’Union européenne.
Cependant, si la chaussure orthopédique de Birkenstock ne fait pas l’unanimité, elle reste une icône de la mode susceptible de protection au titre du droit d’auteur, protection obtenue pour son modèle « Madrid. » Il reste donc une alternative pour protéger ses actifs de propriété intellectuelle.
Pourquoi la demande de marque de motif de Birkenstock a-t-elle été rejetée ?
La question de la distinctivité de cette marque a été examinée par le Tribunal allemand des brevets et des marques, qui a confirmé que la marque manquait de distinctivité.
Lors de l’évaluation de la distinctivité, la Cour a réitéré la jurisprudence constante sur les marques de motifs : les critères d’évaluation du caractère distinctif sont les mêmes pour tous les types de marques.
Toutefois, l’Office Allemand précise que les signes constitués uniquement par la forme ou une représentation tridimensionnelle des produits ne sont pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les marques verbales ou figuratives traditionnelles, qui sont indépendantes de l’apparence des produits marqués.
En l’absence d’éléments figuratifs ou verbaux, les consommateurs moyens n’infèrent généralement pas l’origine commerciale à partir de la forme des produits ou de leur emballage. Par conséquent, une telle marque de commerce n’a un caractère distinctif inhérent que si elle s’écarte de manière significative des normes ou des usages dans le secteur concerné et remplit ainsi sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale.
Par ailleurs, lors de l’évaluation de la question de savoir si le public considère un design de produit comme courant, l’accent doit principalement être mis sur le secteur concerné. Les designs provenant de secteurs voisins peuvent également être pris en compte si, en raison de circonstances particulières, le public concerné peut être amené à transférer sa perception vers le secteur concerné.
La Cour a appliqué ces critères à la marque de Birkenstock.
Les juges ont constaté que les semelles ont souvent un profil pour une meilleure adhérence, qu’elles soient destinées au travail, aux loisirs ou au sport. Le tribunal s’est référé à divers modèles de semelles disponibles avant la date de dépôt. Sur la base de ces antériorités, le Tribunal a considéré que la marque contestée n’est qu’une variante de semelles avec des lignes croisées et ondulées.
Birkenstock a fait valoir que son motif créait une impression d’os. Le Tribunal a rejeté cet argument parce que le public concerné ne percevrait pas le motif comme ressemblant à un os.
Par conséquent, la marque a été jugée non distinctive pour des produits qui ont ou qui sont (une partie d’) une semelle.
L’exemple de Birkenstock souligne la difficulté d’obtenir une protection de marque pour l’apparence des produits en Europe. Les motifs constituant une marque doivent être exceptionnels, uniques, pour être considérés comme distinctifs, ou bien avoir acquis une notoriété grâce à une utilisation extensive.
À mesure que les marques de motif gagnent en popularité et que les entreprises cherchent à les protéger, les tribunaux pourraient être amenés à préciser les critères de distinctivité pour ces types de marques. La décision de la CJUE concernant Birkenstock pourrait avoir des répercussions sur la manière dont d’autres marques de motif sont évaluées.







 Introduction
Introduction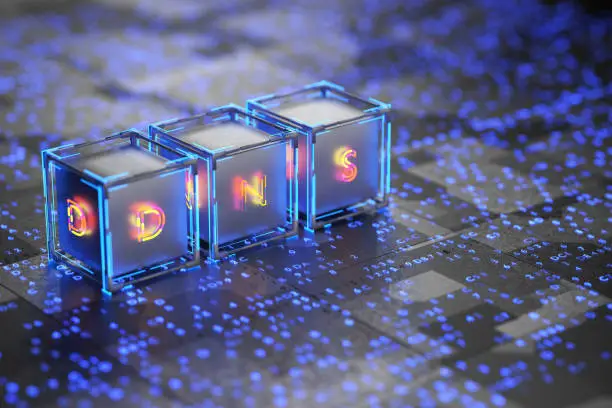
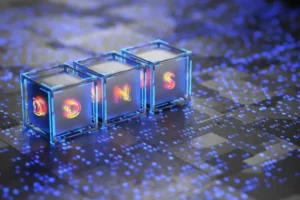



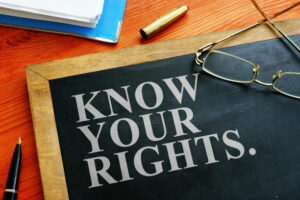 Une marque notoire ne fait pas échec à l’utilisation d’un terme de manière descriptive
Une marque notoire ne fait pas échec à l’utilisation d’un terme de manière descriptive
 L’UDRP n’est pas un forum approprié pour résoudre les cas de diffamation éventuelle
L’UDRP n’est pas un forum approprié pour résoudre les cas de diffamation éventuelle
 Les demandes de marque ne suffisent pas à démontrer des droits antérieurs
Les demandes de marque ne suffisent pas à démontrer des droits antérieurs
 VeriSign : Augmentation des dépôts d’enregistrement malgré l’épidémie de pandémie
VeriSign : Augmentation des dépôts d’enregistrement malgré l’épidémie de pandémie