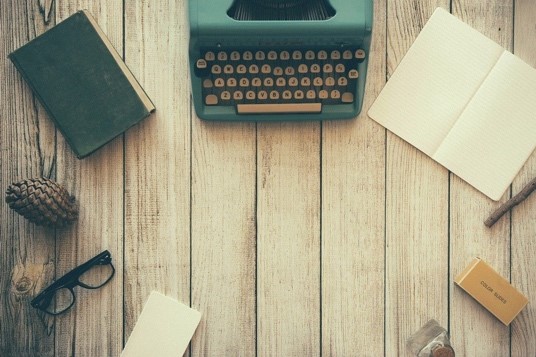Transposition de la directive SMA en France : quel impact sur l’audiovisuel ?

La redéfinition des notions essentielles de la directive européenne de 2010
L’ordonnance aborde des notions essentielles qu’il convient tout d’abord de préciser afin de bien en comprendre les enjeux. Tout d’abord, que sont les services de médias audiovisuels (SMA) ? Il en existe deux types :
- Les services linéaires de télévision (les services classiques) ;
- Les services non-linéaires, que sont les services de contenu audiovisuel à la demande ou services de médias à la demande (SMAD). Ces SMAD permettent à l’utilisateur de choisir aussi bien le moment de visionnage, que le contenu.
L’ordonnance remet aussi certains principes en cause, comme le vieux principe de chronologie des médias issu d’une législation de 1960. Il avait été instauré pour organiser la diffusion des films après leur sortie dans les salles de cinéma, afin d’optimiser la rentabilité des films.
Modernisation et adaptation des règles à la transformation des services audiovisuels
L’ordonnance transposant la directive a mis en place des mesures qui permettent tant d’assurer la contribution effective de certains acteurs du secteur que de protéger les mineurs et le public.
Le système de financement de la création cinématographique et audiovisuelle nationale a en effet été complètement revu par la directive. Désormais, le principe du pays d’origine s’applique : chaque Etat membre de l’Union européenne peut appliquer son propre régime de contribution à la production aux chaînes et plateformes de VOD (Video On Demand) étrangères proposant un service sur le territoire de cet Etat Membre.
Si ce principe est un point majeur de la réforme opérée, la directive SMA prend également acte de la profonde mutation du multimédia et de l’audiovisuel, en étendant la régulation audiovisuelle aux plateformes de partage de vidéos, aux réseaux sociaux et aux plateformes de vidéos en direct. Par ce biais, Bruxelles souhaite protéger notamment les mineurs contre certains contenus nuisibles et harmoniser le cadre juridique du secteur audiovisuel européen.
Réforme de la loi de 1986 et préservation de l’exception culturelle française
La France souhaitait transposer la directive et collaborer au projet européen, tout en défendant l’exception culturelle française.
Elle s’attache à renforcer les règles de transparence dirigeant les éditeurs de services et à établir des objectifs plus aboutis, comme notamment l’inscription du système de financement de la production (notamment indépendante) dans le temps, mais également la garantie que les diffuseurs français et les plateformes mondiales dansent sur un pied d’équité.
L’article 19 de l’ordonnance oblige désormais les « éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français » « lorsqu’ils ne sont pas établis en France et qu’ils ne relèvent pas de la compétence de la France », à la même contribution financière que les éditeurs français.
L’article 28 quant à lui, réforme en profondeur le principe de chronologie des médias et permet désormais aux acteurs du secteur, dans les 6 mois, de négocier un accord avec les organisations professionnelles pour réduire les délais de diffusion.
Extension des pouvoirs du CSA et protection des mineurs
Les plateformes faisant désormais partie du paysage règlementaire, le CSA a vu ses compétences et pouvoirs s’élargir. Il s’est notamment vu affecter deux nouvelles missions essentielles : l’accessibilité des programmes de SMA, et la protection en particulier des mineurs, contre des contenus violents, incitant à la haine ou constituant une infraction pénale. Le CSA aura alors compétence si le siège social ou une filiale de la plateforme est établi en France.
D’autre part, le CSA est également en charge de veiller à ce que les éditeurs aient adopté des codes de bonne conduite (notamment en matière de publicité alimentaire auxquelles les mineurs pourraient être exposés), et de mettre en avant les services audiovisuels d’intérêt général sur les nouvelles plateformes audiovisuelles.
Par ailleurs, l’ordonnance complète l’article 15 de la loi de 1986 en interdisant dans les programmes non seulement les incitations à la haine et à la violence, mais également la provocation à la commission d’actes de terrorisme, tout en confiant le soin au CSA de veiller au respect de ces dispositions.
Si l’ordonnance est déjà une belle avancée, les décrets d’application sont tout aussi importants. Le 23 juin 2021, a été publié au Journal Officiel le décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (ou décret SMAD n°2010-1379 du 12 novembre 2010) qui représente probablement la plus importante des étapes du projet de modernisation du financement du service audiovisuel français et européen. Les SMAD devront, entre autres, consacrer au moins 20% du chiffre d’affaires réalisé en France au financement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.
Enfin, des négociations sont ouvertes entre les chaines de télévision et les représentants des producteurs sur la révision d’un second décret dit « TNT » (décret n° 2010-747 du 2 juillet 2020), qui définit les obligations de production des chaînes de télévision. Les points abordés concernent notamment le partage des droits d’auteur sur les œuvres entre les producteurs et les chaine ou encore sur la durée de ces droits.
Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.
A découvrir sur le même sujet …
♦ En quoi le DSA va modifier le cadre juridique des services sur internet?