Quelles sont les possibilités d’action pour préserver sa E-réputation ?

A présent, il est essentiel de savoir comment traiter ces critiques et parfois médisances.
Il y a déjà huit ans, la Cour Européenne des droits de l’Homme (« CEDH ») affirmait que « les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité, et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information » (Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, CEDH 2012).
Toutefois, « dans le même temps, les communications en ligne et leur contenu risquent assurément bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée » (Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05 CEDH 2011).
La Cour a récemment rappelé [1] que « le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, de l’article 8 de la Convention » faisant écho à de précédentes affaires relatives à des déclarations diffamatoires parues dans la presse (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, 15 novembre 2007, et Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, 21 septembre 2010).
Cependant, bien qu’il existe de nombreuses actions pour se défendre en cas de découverte de contenus « illicites » – diffamation, dénigrement ou toute forme d’abus à la liberté d’expression – quelles actions envisager face à la diffusion de contenus en ligne qui ne sont pas illicites mais qui sont des propos portant tout de même atteinte à votre réputation, comme des avis négatifs où encore des articles de journaux en ligne relatant des faits divers sur vos expériences ?
Précisions sur les données personnelles, au droit d’opposition et au droit à l’oubli
Une donnée à caractère personnel est définie comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (…)[2]» selon la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité administrative qui a notamment pour vocation de veiller au respect des données personnelles.
Partant, vos nom et prénom sont des données personnelles, et eu égard au traitement de ces données, vous disposez de certains droits, tel que le droit d’opposition ou le droit à l’effacement (également droit à l’oubli).
- Le droit d’opposition
Vous pouvez vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel, en expliquant vos raisons, basées sur des motifs légitimes.
En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse à votre demande, il est possible de saisir la CNIL.
Vous avez le droit d’obtenir de la personne, l’autorité publique, la société ou l’organisme qui traite vos données (appelé plus couramment le « responsable de traitement ») l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel vous concernant, notamment lorsque qu’il n’existe pas de motif légitime impérieux pour leur traitement[1]. Cela inclut notamment le droit au déréférencement de liens contenus sur les moteurs de recherche.
L’exploitant d’un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel relatives à des procédures ou condamnations pénales[2].
Les demandes de déréférencement auprès des moteurs de recherche peuvent se faire directement en ligne, via un outil dédié. Toutefois, il est souvent nécessaire de procéder à l’envoi d’un courrier officiel aux exploitants des sites internet diffusant des articles préjudiciables.
Il faudra alors argumenter, par exemple en démontrant le préjudice que vous subissez à cause de ces articles – l’annulation d’un rendez-vous professionnel suite à la recherche de vos nom et prénom pourrait en être un ! – ou en expliquant qu’une page web fait état d’une étape d’une procédure judiciaire ne correspondant plus à votre situation judiciaire actuelle.
Toutefois, ce droit à l’oubli est mis en balance avec la nécessité du traitement, notamment lorsque celui-ci poursuit un intérêt légitime, tel que l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information[3].
Votre demande peut donc être rejetée si l’accès à une telle information vous concernant est considérée comme strictement nécessaire à l’information du public. En effet, selon l’article 17 du RGPD, certaines situations font obstacles à la mise en œuvre du droit à l’oubli, notamment si le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information[4].
Pour cela, le responsable de traitement ou l’autorité saisie doit notamment tenir compte de critères variés, notamment la nature des données en cause, leur contenu, leur exactitude, les répercussions que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée, la notoriété de cette personne, etc.
[1] Article 51 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dans les conditions prévues à l’article 17 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
[2] A cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré, par son arrêt du 24 septembre 2019 , que les dispositions de l’ancienne Directive 95/46/CE concernant l’interdiction ou les restrictions au traitement de données à caractère personnel relatives à des procédures pénales s’appliquent également, sous réserve des exceptions prévues, à l’exploitant d’un moteur de recherche en tant que responsable du traitement effectué dans le cadre de son activité, à l’occasion d’une vérification opérée par cet exploitant, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, à la suite d’une demande introduite par la personne concernée
En cas de refus de déréférencement ou d’absence de réponse de la part du moteur de recherche, des solutions judiciaires sont envisageables.
Il convient donc de maîtriser les fondements juridiques et de bien cimenter vos arguments lors de vos demandes de déréférencement auprès des responsables de traitement.
[1] CEDH, Affaire JEZIOR c. POLOGNE, 4 juin 2020, 31955/11
[2] Article 4 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
[3] Article 17 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
[4] Article 17 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données


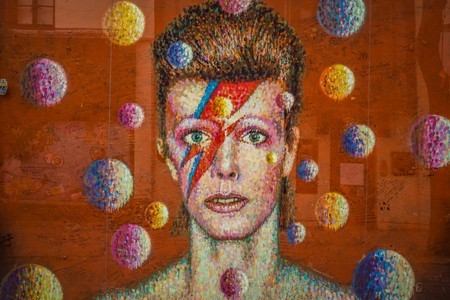


 Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.
Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.
 Veille publiée dans la Revue de la Propriété Intellectuelle Lexis Nexis numéro 7, de juillet 2020
Veille publiée dans la Revue de la Propriété Intellectuelle Lexis Nexis numéro 7, de juillet 2020
 Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.
Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.
 A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative
A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative

 Depuis le 11 décembre 2019,
Depuis le 11 décembre 2019, 
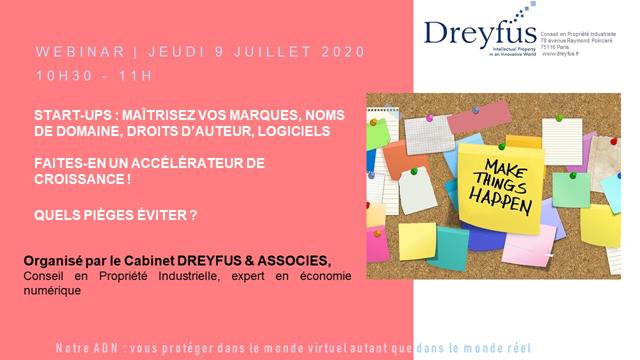 Webinar start up le 9 juillet 2020 :
Webinar start up le 9 juillet 2020 :