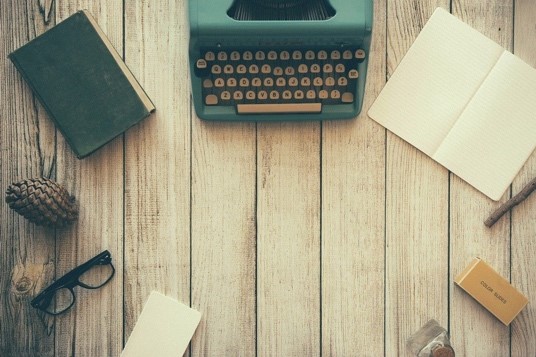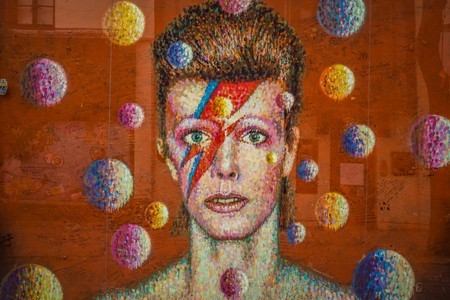Les brevets et la question de l’inventeur IA : quelles perspectives après les décisions récentes ?
L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) transforme profondément le paysage de l’innovation. Des systèmes d’IA sont désormais capables de générer des inventions originales, posant ainsi la question cruciale : une IA peut-elle être reconnue comme inventeur au sens du droit des brevets ? Les récentes décisions judiciaires et les débats en cours mettent en lumière les tensions entre les avancées technologiques et les cadres juridiques existants.
Cadre juridique actuel : l’inventeur ou l’auteur doit-il être humain ?
- L’affaire DABUS : quand l’intelligence artificielle réclame un droit d’inventer
L’affaire DABUS est bien plus qu’un simple litige juridique : elle cristallise les tensions entre innovation technologique et droit positif. Pour rappel, DABUS (acronyme de Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) est un système d’intelligence artificielle mis au point par le Dr Stephen Thaler. Ce dernier a soutenu que deux inventions, un récipient alimentaire à structure fractale et un dispositif de signalisation lumineux, avaient été créées sans aucune intervention humaine inventive. Il a donc demandé à ce que DABUS soit désigné comme inventeur unique dans ses dépôts de brevets à travers le monde.
Les offices de brevets concernés au Royaume-Uni, aux États-Unis, à l’Office européen des brevets (OEB), en Australie et en Allemagne ont opposé une fin de non-recevoir. Dans tous ces systèmes juridiques, seul un être humain peut être légalement reconnu comme inventeur.
La Cour suprême britannique s’est appuyée sur le Patents Act 1977, qui exige expressément que l’inventeur soit une « personne naturelle ».
L’OEB s’est prononcé dans les affaires J 0008/20 et J 0009/20 (décisions du 21 décembre 2021). Si l’article 81 CBE impose bien de désigner un inventeur, la lecture combinée de cet article avec l’article 60(1) CBE a conduit l’OEB à conclure que seule une personne physique peut être désignée comme telle. L’Office a notamment souligné qu’une IA ne peut ni détenir de droits, ni les transmettre, condition pourtant essentielle à l’attribution d’un droit de brevet. En somme, l’IA n’a pas la capacité juridique pour être investie de la qualité d’inventeur au sens de la Convention sur le brevet européen.
Enfin, la Cour d’appel fédérale américaine, dans l’arrêt Thaler v. Vidal (2022), a jugé que le terme « individual » employé dans le droit américain ne peut concerner qu’une personne physique.
Un seul pays a, à ce jour, fait exception : l’Afrique du Sud. En 2021, son autorité compétente, la Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), a accepté un brevet désignant l’IA comme inventeur. Cependant ce cas reste marginal car le système sud-africain repose sur un modèle purement déclaratif, sans examen de fond des conditions de brevetabilité. En d’autres termes, cette reconnaissance ne fait pas autorité au niveau international.
- L’auteur d’une œuvre peut-il être une IA ? La justice américaine tranche sans détour
La question de la paternité humaine se pose aussi en droit d’auteur, notamment depuis que le Dr Thaler a tenté d’enregistrer une œuvre générée par sa machine, intitulée A Recent Entrance to Paradise. Une fois de plus, il désignait l’IA comme auteur exclusif.
La Cour d’appel du District of Columbia a tranché en mars 2025 dans l’arrêt Thaler v. Perlmutter. La réponse est sans ambiguïté : une machine ne peut pas être titulaire de droits d’auteur.
Selon la Cour, le Copyright Act ne définit pas le terme « auteur », mais tout dans son esprit indique qu’il s’agit d’une personne humaine : capable d’intention, de choix, de relations familiales, et dotée de droits exclusifs dès la création.
Elle souligne aussi que l’IA est un outil, non un sujet de droit. Ce n’est pas la machine qui crée, mais l’humain qui la programme ou l’utilise.
Par ailleurs, le Copyright Office américain maintient depuis toujours une exigence de paternité humaine pour l’enregistrement des œuvres. Cette position est cohérente avec toute l’histoire du droit d’auteur moderne.
- Et en France ? Une approche fondée sur l’originalité humaine
En droit français comme en droit européen, la protection d’une œuvre repose sur son originalité, entendue comme l’expression de la personnalité de son auteur.
Selon la jurisprudence constante de la CJUE (Infopaq, Painer, Funke Medien), une œuvre ne peut être protégée que si son auteur a effectué des choix libres et créatifs, révélant sa sensibilité.
Or, une IA n’a ni personnalité juridique, ni esprit créatif, ni intention. Elle ne fait qu’exécuter des algorithmes, aussi sophistiqués soient-ils.
Par conséquent, ni en France, ni dans l’Union européenne, une œuvre entièrement générée par une IA ne peut aujourd’hui bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
- Vers une évolution du droit ?
Cette affaire montre que le principe de paternité humaine reste un pilier du droit de la propriété intellectuelle. Bien que certains appellent à une réforme pour reconnaître un rôle autonome de l’IA dans le processus créatif, la plupart des systèmes juridiques préfèrent maintenir une vision personnaliste de la création.
Cela ne signifie pas que les exploitants d’œuvres générées par IA sont sans recours. Le droit de la concurrence déloyale, la protection contractuelle, voire certaines formes de responsabilité civile, peuvent offrir une sécurité juridique. Il faudra une initiative législative claire, et non une interprétation judiciaire, pour faire évoluer le cadre actuel.
Enjeux juridiques et économiques
Défis pour la protection des innovations générées par l’IA
L’incapacité à reconnaître l’IA comme inventeur soulève des défis majeurs pour la protection des innovations. Les entreprises investissant massivement dans des systèmes d’IA capables de générer des inventions originales se retrouvent confrontées à un vide juridique. Sans possibilité de brevet, ces innovations risquent de ne pas être protégées efficacement, exposant les entreprises à des risques de copie et de perte d’avantage concurrentiel.
Cette situation pourrait également freiner les investissements dans la recherche et le développement de l’IA, les entreprises étant réticentes à investir dans des technologies dont les résultats ne peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle.
Conséquences pour les entreprises et les investisseurs
L’incertitude juridique entourant la reconnaissance de l’IA comme inventeur peut avoir des répercussions économiques significatives. Les entreprises pourraient être dissuadées de commercialiser des produits issus d’inventions générées par l’IA, craignant des litiges ou une absence de protection juridique. De plus, les investisseurs pourraient hésiter à financer des projets d’IA innovants en raison du manque de clarté sur la protection des résultats.
Perspectives d’évolution du droit des brevets
Vers une reconnaissance de l’IA comme co-inventeur ?
Face à ces défis, certains experts suggèrent une évolution du droit des brevets pour permettre la reconnaissance de l’IA comme co-inventeur, aux côtés d’un inventeur humain. Cette approche reconnaîtrait le rôle actif de l’IA dans le processus inventif tout en maintenant une responsabilité humaine. Une telle évolution nécessiterait une révision des textes législatifs et une harmonisation internationale des pratiques.
Adaptation des systèmes juridiques et pratiques professionnelles
Les systèmes juridiques pourraient également s’adapter en développant des mécanismes spécifiques pour les inventions générées par l’IA. Par exemple, des régimes de protection sui generis pourraient être envisagés, offrant une protection adaptée aux caractéristiques uniques de ces inventions. Parallèlement, les professionnels de la propriété intellectuelle devront adapter leurs pratiques pour évaluer et protéger efficacement les innovations issues de l’IA.
Conclusion
La question de la reconnaissance de l’IA comme inventeur dans le droit des brevets demeure complexe et sujette à débat. Les décisions récentes confirment la nécessité d’une personne humaine en tant qu’inventeur, mais les avancées technologiques pressent les législateurs à reconsidérer cette position. Une adaptation du cadre juridique semble inévitable pour accompagner l’évolution de l’innovation et garantir une protection adéquate des inventions générées par l’IA.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.
Nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Une IA peut-elle être reconnue comme inventeur dans une demande de brevet ?
Actuellement, la majorité des juridictions exigent qu’un inventeur soit une personne humaine.
2. Quelles sont les implications pour les entreprises utilisant l’IA pour innover ?
Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés à protéger juridiquement les inventions générées par l’IA, ce qui peut affecter leur stratégie d’innovation et d’investissement.
3. Existe-t-il des exceptions à cette règle ?
À ce jour, seule l’Afrique du Sud a accepté une demande de brevet désignant une IA comme inventeur, mais cette décision reste isolée et sans examen substantiel.