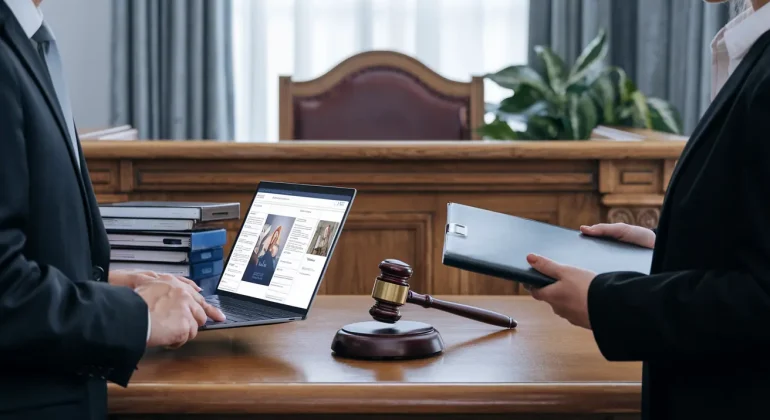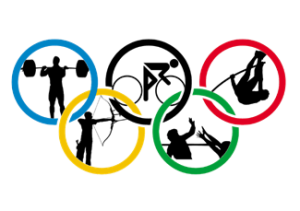Jurisprudence sur les procédures d’opposition et de nullité – 2024
Dans le domaine en constante évolution du droit de la propriété intellectuelle, les procédures d’opposition et de nullité constituent des instruments essentiels pour préserver l’intégrité et la pertinence des registres de marques. En 2024, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) et les juridictions françaises ont rendu des décisions marquantes clarifiant des subtilités procédurales. Cet article analyse ces décisions clés, fournissant aux entreprises des informations précieuses sur les dernières tendances façonnant le contentieux de la propriété intellectuelle en France.
Éléments procéduraux déterminants
Déchéance pour non‑usage : nouvelles attentes probatoires
La déchéance pour non-usage reste un aspect central des litiges en matière de marques. Les récentes décisions confirment l’approche souple mais rigoureuse de l’INPI en matière de preuve. Les pièces non datés ou datées hors période pertinente, tels que des supports marketing, des captures d’écran ou des factures postérieures, sont admissibles dans une appréciation globale, lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments datés (INPI, 2 mai 2024, Bob dépannage!). Cela souligne la nécessité pour les titulaires de marques de conserver des dossiers d’usage complets et détaillés.
Cependant, le critère de la pertinence géographique est appliqué strictement. Par exemple, des documents en anglais visant un marché étranger (une société suisse) ont été écartés pour établir un usage en France (INPI, 11 mars 2024, Bureau d’Idées). Cette rigueur souligne l’importance d’une documentation spécifiquement adaptée au marché local.
Intérêt à agir et abus de droit
En 2024, la jurisprudence a confirmé que l’intérêt général prime sur l’intérêt individuel dans les actions en nullité, dispensant les demandeurs de démontrer un intérêt personnel à agir (CA Paris, 24 avril 2024, Vape). Ce principe renforce le rôle de ces procédures dans la préservation de l’intégrité des registres des marques.
Les allégations d’abus de droit, quant à elles exigent des preuves substantielles d’une intention malveillante. Dans l’affaire MySunbed (INPI, 27 mai 2024), l’INPI a rejeté des accusations de mauvaise foi lorsque les actions du demandeur n’étaient pas clairement destinées à nuire au titulaire de la marque, établissant ainsi un seuil élevé pour les défenses liées à l’abus de droit.
Champ d’application temporel : due diligence historique
Le droit applicable à la date de dépôt est crucial pour évaluer la validité d’une marque. Des décisions comme Cavalride (INPI, 3 avril 2024) ont réaffirmé que la validité des marques est évaluée en fonction du cadre juridique en vigueur à la date de leur dépôt, rendant la recherche juridique historique indispensable pour les praticiens.
Motifs de nullité approfondis
Distinctivité, caractère trompeur et ordre public
La distinctivité reste une pierre angulaire de l’enregistrement des marques. L’affaire MySunbed (INPI, 27 mai 2024) a mis en lumière les normes évolutives de perception des consommateurs, notamment en ce qui concerne les termes anglais de base utilisés en France. Par ailleurs, les décisions sur le caractère trompeur ont souligné que les demandeurs doivent démontrer un potentiel de tromperie au moment du dépôt, plutôt que de s’appuyer sur des éléments postérieurs à l’enregistrement (INPI, 3 avril 2024).
Concernant l’ordre public, une marque ne peut être rejetée qu’en cas de restriction juridique explicite lors du dépôt. Par exemple, l’emploi du terme « boucher » pour des produits non carnés n’a pas été jugé contraire à l’ordre public en l’absence d’interdiction légale claire (INPI, 18 mars 2024, NL 23-0089).
Renommée et intentions parasitaires
Prouver la renommée demeure un défi, nécessitant des preuves solides telles que la reconnaissance judiciaire antérieure ou une large exposition auprès des consommateurs (INPI, 12 juillet 2024, Immo Angels). Dans l’affaire Cadault (INPI, 29 avril 2024), l’intention parasitaire n’a pas été retenue, faute de démonstration d’un lien clair entre la marque contestée et un personnage célèbre de la série Emily in Paris.
Tendances jurisprudentielles du contentieux PI en France
Les décisions de 2024 révèlent une approche équilibrée : flexibilité pour les preuves d’usage, mais normes rigoureuses pour la distinctivité et la renommée. Cette combinaison favorise un environnement compétitif tout en protégeant l’intégrité des registres.
Les juridictions ont également adopté une approche plus sophistiquée concernant les nuances linguistiques et culturelles. L’affaire La Chicha Loca (INPI, 26 janvier 2024) démontre une reconnaissance croissante des perceptions publiques variées selon les contextes régionaux et linguistiques.
Conclusion
Les décisions de 2024 mettent en avant l’importance d’une préparation stratégique dans les procédures d’opposition et de nullité. Les principaux enseignements incluent :
- L’INPI met l’accent sur l’intérêt public dans les actions en nullité.
- Les revendications de nullité réussies nécessitent des arguments fondés sur des preuves complètes, notamment en matière de distinctivité et de renommée.
- Les contextes culturels et linguistiques jouent un rôle croissant dans l’évaluation des marques.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Quelles différences entre opposition et action en nullité ?
L’opposition vise à empêcher l’enregistrement d’une demande de marque, tandis que la nullité attaque un enregistrement déjà accordé.
2. Quel délai pour engager une action en déchéance pour non usage ?
Après cinq ans d’inexploitation continue ; l’INPI admet une tolérance uniquement si la preuve d’usage est suffisante.
3. La renommée doit elle être nationale ?
Non. Une renommée sectorielle ou régionale peut suffire si elle est objectivement établie.