L’importance de la surveillance des marques sur les réseaux sociaux et les stratégies avancées pour contrer les atteintes
La présence en ligne joue un rôle crucial dans la construction de l’image des marques, mais cette même visibilité les expose à des risques significatifs tels que la contrefaçon, la diffamation et les violations de droits. Les réseaux sociaux, à la fois catalyseurs d’opportunités et foyers de menaces, exigent une surveillance accrue. Les entreprises doivent intégrer cette surveillance comme un élément fondamental de leur stratégie de gestion des actifs immatériels. Dreyfus, expert en propriété intellectuelle, se positionne comme un acteur clé dans ce domaine en apportant des solutions techniques et juridiques adaptées.
L’impératif de la surveillance proactive sur les réseaux sociaux
Contrairement à une hypothèse souvent partagée, les hébergeurs de contenu (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) ne sont pas tenus par la loi de surveiller activement ce qui est publié. Conformément à la Directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique, ces intermédiaires techniques ne peuvent être tenus responsables qu’une fois notifiés de l’existence de contenus illicites. Cette déresponsabilisation impose aux entreprises d’assumer elles-mêmes une surveillance active pour protéger leur marque.
Les risques encourus par les entreprises non vigilantes sont variés et lourds de conséquences :
- Contrefaçons : La diffusion de produits contrefaits via les réseaux sociaux impacte les revenus et affaiblit l’image de marque.
- Diffamation et campagnes de dénigrement : Une publication virale négative peut nuire irrémédiablement à la réputation d’une entreprise.
- Usurpation d’identité : Les faux comptes exploitant le nom d’une marque ou de ses dirigeants déstabilisent la confiance des parties prenantes.
- Violations des droits de propriété intellectuelle : L’utilisation non autorisée de logos ou de noms commerciaux peut réduire la protection juridique de ces actifs.
Les mécanismes de takedown : piliers de la réponse réactive
Les plateformes comme Amazon, Alibaba ou encore Facebook ont mis en place des procédures de « notice and takedown » qui permettent de signaler et de retirer des contenus illicites. Ces dispositifs sont une réponse directe à la prolifération des atteintes sur leurs écosystèmes.
Déroulement typique d’une procédure de takedown
- Identification des contenus litigieux : Cela passe par des outils automatisés ou une analyse manuelle pour repérer les publications problématiques.
- Notification à l’hébergeur : Une demande formelle, incluant les preuves de la violation, est soumise à la plateforme concernée.
- Examen par l’hébergeur : Les équipes de modération décident de la conformité de la demande aux politiques internes et au cadre juridique.
- Retrait des contenus : Si la plainte est fondée, les contenus illicites sont supprimés ou bloqués rapidement.
- Suivi et escalade : En cas de rejet ou de récidive, des actions juridiques peuvent être envisagées.
Un exemple marquant est le programme « Brand Registry » d’Amazon, qui offre aux détenteurs de marques des outils pour surveiller les listings et signaler les violations. Alibaba propose également des fonctionnalités similaires, adaptées au contexte du commerce asiatique.
Pourquoi s’appuyer sur un acteur spécialisé comme Dreyfus ?
Le recours à des experts permet d’optimiser les chances de succès et de minimiser les délais dans les procédures de takedown. Dreyfus offre :
- Une expertise juridique pointue : Chaque cas est évalué en fonction du cadre légal applicable et des jurisprudences en vigueur.
- Des outils technologiques avancés : La surveillance automatisée garantit une détection rapide et précise des infractions.
- Un accompagnement complet : De la veille initiale aux éventuelles poursuites judiciaires, Dreyfus gère l’ensemble du processus.
Les réseaux sociaux : opportunités et vulnérabilités
La nature ouverte et participative des réseaux sociaux, bien que source d’opportunités marketing, constitue également une porte d’entrée pour diverses atteintes.
- Publicités frauduleuses : Elles exploitent l’image d’une marque pour rediriger les utilisateurs vers des sites de contrefaçon.
- Contenus choquants ou controversés : Associer une marque à des thèmes polémiques nuit à sa perception publique.
- Campagnes de dénigrement orchestrées : Avis négatifs falsifiés, hashtags hostiles, ou posts diffamatoires érodent la réputation.
Trois axes stratégiques pour une protection renforcée
Les marques doivent envisager une approche à plusieurs niveaux : proactive, préventive et réactive.
- Proactif : Maintenir une présence visible et active
Une communication régulière sur les réseaux sociaux permet de surveiller et contrôler les discussions autour de la marque.
- Préventif : Mettre en place une veille structurée
Les outils de surveillance — comme les crawlers automatisés ou les alertes configurables — détectent les atteintes potentielles avant qu’elles ne s’aggravent.
- Réactif : Exploiter les recours juridiques et techniques
Les procédures de takedown et les actions judiciaires restent des étapes incontournables pour contrer les infractions avérées.
Un futur en mutation : enjeux et perspectives
L’évolution rapide des technologies et des pratiques en ligne pose de nouveaux défis :
- L’émergence des deepfakes : Ces contenus falsifiés complexifient les enjeux de diffamation et de contrefaçon.
- Une régulation renforcée : L’encadrement juridique des plateformes pourrait évoluer, influençant les responsabilités des hébergeurs.
- Le double usage de l’intelligence artificielle : Bien qu’utile pour la surveillance, elle peut également être exploitée à des fins malveillantes.
Conclusion
Surveiller les marques sur les réseaux sociaux est un enjeu stratégique incontournable. Face à l’absence de surveillance proactive par les plateformes, il est essentiel pour les entreprises d’adopter des stratégies globales de défense. Avec l’accompagnement d’experts comme Dreyfus, elles peuvent anticiper et contrer les menaces tout en assurant la durabilité et la crédibilité de leur marque dans un environnement numérique en constante évolution.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !





 En changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.
En changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.



 « La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.
« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.






 Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.
Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

 Veille publiée dans la Revue de la Propriété Intellectuelle Lexis Nexis numéro 7, de juillet 2020
Veille publiée dans la Revue de la Propriété Intellectuelle Lexis Nexis numéro 7, de juillet 2020
 Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.
Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.
 A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative
A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative

 Les questions juridiques relatives à la propriété des inventions et des œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle (ou « IA ») sont au premier plan pour de nombreuses entreprises.
Les questions juridiques relatives à la propriété des inventions et des œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle (ou « IA ») sont au premier plan pour de nombreuses entreprises.
 CJUE – 5 septembre 2019
CJUE – 5 septembre 2019

 En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.
En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.
 En l’honneur de la 22ème journée mondiale anti-contrefaçon, le Cabinet Dreyfus a assisté à un Webinar organisé par l’
En l’honneur de la 22ème journée mondiale anti-contrefaçon, le Cabinet Dreyfus a assisté à un Webinar organisé par l’

 Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.
Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.
 Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020, n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary Hostmaster
Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020, n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary Hostmaster


 Source :
Source : 
 Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.
Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.
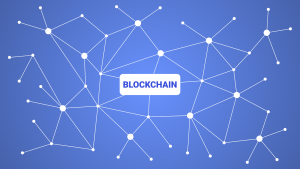 Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.
Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.
 OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 2 sept. 2019, n° D2019-1638, Great American Hotel Group c/ Domains By Proxy, LLC / R Greene
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 2 sept. 2019, n° D2019-1638, Great American Hotel Group c/ Domains By Proxy, LLC / R Greene
 La
La 




 Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi
Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi 

 En mars 2017, les nouvelles règles de droit civil chinois ont porté de 2 à 3 ans le délai de prescription des actions civiles.
En mars 2017, les nouvelles règles de droit civil chinois ont porté de 2 à 3 ans le délai de prescription des actions civiles.
 Le 65ème forum de
Le 65ème forum de 
 Dans l’
Dans l’
 Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).
Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).
 Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.
Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.








































 Le 9 juin 2014, un tribunal fédéral de Californie a refusé d’écarter la plainte déposée par Parts.com contre la société américaine Yahoo pour la deuxième fois en moins de six mois.
Le 9 juin 2014, un tribunal fédéral de Californie a refusé d’écarter la plainte déposée par Parts.com contre la société américaine Yahoo pour la deuxième fois en moins de six mois.











































