Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.
Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.
Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.
En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.
Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.
En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.
De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.
Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.
De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.
Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.
Dès lors, la plainte est rejetée.
Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur





 Source: WIPO, Arbitration and Mediation Center, Nov. 5, 2020, aff. No. D2020-2024 Cobrajet, Inc. v. The Endurance International Group, Inc,
Source: WIPO, Arbitration and Mediation Center, Nov. 5, 2020, aff. No. D2020-2024 Cobrajet, Inc. v. The Endurance International Group, Inc,


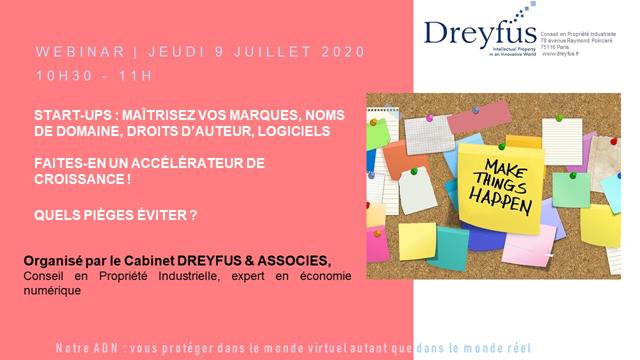 Webinar start up le 9 juillet 2020 :
Webinar start up le 9 juillet 2020 : 
 La loi de finance de 2019 harmonise les règles fiscales françaises et européennes afin de favoriser au mieux l’investissement des créations et des inventions brevetables. On parle d’IP Box à la française.
La loi de finance de 2019 harmonise les règles fiscales françaises et européennes afin de favoriser au mieux l’investissement des créations et des inventions brevetables. On parle d’IP Box à la française.