Contrefaçon de vin : comment réagir en cas d’usurpation de marque ou d’appellation ?
Dans le secteur viticole, la contrefaçon représente un fléau majeur. De faux vins étiquetés sous une marque reconnue ou usurpant une appellation renommée peuvent non seulement tromper le consommateur, mais aussi porter un préjudice considérable aux producteurs légitimes. La France, par la réputation internationale de ses vins (Bordeaux, Bourgogne, Champagne, etc.), est particulièrement exposée à ce phénomène.
Cet article explique comment identifier et réagir en cas de contrefaçon ou d’usurpation de marque ou d’appellation, en abordant les dispositifs juridiques, les bonnes pratiques pour préserver son image et la portée des actions à mener, en France comme à l’international.
Comprendre la contrefaçon dans le milieu viticole
Définition générale de la contrefaçon
La contrefaçon, au sens du Code de la propriété intellectuelle, consiste en la reproduction ou l’imitation non autorisée d’un droit protégé (marque, brevet, design, droit d’auteur, etc.). Dans le cadre du vin, elle peut se traduire par :
- L’utilisation d’une marque sans autorisation : Par exemple, un opérateur commercialisant un vin de moindre qualité sous un nom déposé et réputé, afin de tirer profit de sa notoriété.
- La copie ou la falsification d’étiquettes : Reproduire à l’identique le packaging d’un producteur légitime pour tromper le consommateur sur l’origine du produit.
- La revendication abusive d’une AOC/AOP/IGP : Employer des termes comme “Champagne” ou “Bourgogne” sans respecter le cahier des charges ou sans en être autorisé.
L’enjeu économique et sanitaire
- Image de marque ternie : Des vins de contrefaçon, souvent de qualité médiocre, peuvent nuire à la réputation d’un domaine ou d’une région viticole toute entière.
- Perte financière : Selon des estimations relayées par le Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV), les pertes pour l’industrie viticole française liées à la contrefaçon atteindraient plusieurs centaines de millions d’euros par an.
- Risque pour le consommateur : Les vins contrefaits peuvent parfois contenir des substances non conformes, représentant un danger pour la santé.
Contexte international
Sur les marchés asiatiques, américains ou même européens, la forte demande pour les vins français incite certains acteurs malveillants à fabriquer de faux produits. Les producteurs doivent donc envisager des stratégies de protection et de surveillance à l’échelle mondiale, notamment via :
- La marque de l’Union européenne (EUIPO) : Protège la marque dans l’ensemble des 27 États membres.
- Le Système de Madrid (OMPI) : Permet d’étendre sa protection à de nombreux pays en une seule démarche.
Usurpation de marque et d’appellation : quelles formes prend-elle ?
Marque usurpée
Une marque déposée (ex. « Château X ») est copiée ou imitée par un tiers. L’étiquette peut reprendre :
- Le nom exact de la marque, ou un nom très proche suscitant la confusion (ex. « Château Ex »).
- Le logo et la charte graphique : Couleurs, typographie, disposition identiques ou quasi identiques.
Appellation trompeuse
Les appellations d’origine contrôlée (AOC), appellations d’origine protégée (AOP) ou indications géographiques protégées (IGP) sont des signes distinctifs juridiquement protégés. Leur emploi abusif constitue une tromperie pour le consommateur et une infraction pouvant relever de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.
- Exemple : Un vin provenant d’une autre région étiqueté “Champagne” ou “Saint-Émilion”.
- Organismes défendant ces appellations : Le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne), l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), etc.
Étiquetage et mentions illégales
L’usurpation peut également consister à ajouter sur l’étiquette des mentions “millésime”, “grand cru”, “bio” ou “vieilles vignes” sans justification réglementaire. Ces pratiques, même si elles ne visent pas spécifiquement une marque protégée, faussent la concurrence et induisent le consommateur en erreur.
Identifier la contrefaçon et constituer un dossier de preuves
Signes d’alerte
- Prix anormalement bas : Un vin prétendument haut de gamme à un tarif dérisoire peut être suspect.
- Canaux de distribution non officiels : Vente sur des sites internet douteux, marchés parallèles, petits détaillants inconnus.
- Apparence de l’étiquette : Impressions floues, erreurs typographiques, collages approximatifs, informations légales manquantes (taux d’alcool, adresse d’embouteillage…).
Rassembler des preuves tangibles
Pour entamer une action, il est indispensable de collecter des éléments démontrant la contrefaçon :
- Photographies du produit suspect : Les angles d’étiquette, les détails du bouchon, du numéro de lot, etc.
- Factures ou bons de commande : Qui montre la provenance, le prix et l’acheteur.
- Analyses de laboratoire : Dans certains cas, comparer la composition du vin suspect à celle du vin authentique peut aider à prouver la contrefaçon.
Conseil pratique : Conserver les échantillons physiques du produit en cause, scellés par huissier si possible, pour faciliter l’instruction et la preuve de la matérialité des faits.
Importance d’une veille proactive
- Surveillance de marque : Souscrire à un service de veille auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou d’organismes spécialisés, afin de repérer d’éventuelles imitations ou nouvelles demandes de marque trompeuses.
- Contrôle du marché : Vérifier régulièrement les plateformes de e-commerce (françaises et étrangères), les sites d’enchères, les foires aux vins et marchés parallèles.
Actions et recours en cas d’usurpation ou de contrefaçon
Phase amiable : mise en demeure
La première étape consiste souvent à envoyer une lettre de mise en demeure au présumé contrefacteur, lui demandant de :
- Cesser immédiatement la commercialisation du produit litigieux.
- Retirer du marché tous les vins concernés.
- Détruire ou livrer les stocks restants.
- Payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi (perte financière, atteinte à l’image, etc.).
Cette démarche peut suffire lorsque la contrefaçon résulte d’une négligence ou d’une ignorance, mais elle reste souvent insuffisante face à des pratiques organisées.
Procédures judiciaires
Si la phase amiable échoue ou si le dommage est trop important, on peut intenter une action devant les juridictions civiles ou pénales, selon la gravité des faits.
- Action civile (Tribunal judiciaire) : Permet d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi, et d’ordonner la cessation des actes contrefaisants.
- Action pénale : La contrefaçon constitue un délit (articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle), passible d’amendes et d’emprisonnement pour les auteurs.
Exemple : Si le contrefacteur est un réseau international, le juge peut ordonner la saisie et la destruction des marchandises, ainsi que la clôture de sites internet illicites.
Rôle des douanes
Les services douaniers peuvent intervenir pour bloquer l’importation ou l’exportation de produits contrefaits. Le règlement (UE) n°608/2013 prévoit que les titulaires de droits (marques, appellations, etc.) puissent demander aux douanes de surveiller et d’intercepter tout lot suspect.
- Procédure : Déposer une demande d’intervention (AFA) auprès des douanes françaises et européennes.
- Avantage : Permet d’éviter que les marchandises contrefaites ne circulent librement, et facilite l’établissement de preuves.
Études de cas, statistiques et exemple fictif
Étude de cas : Champagne contrefait en Asie
Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) a mené plusieurs opérations pour lutter contre les vins mousseux trompeusement étiquetés comme “Champagne” en Chine et dans d’autres pays d’Asie.
- Contexte : Les contrefacteurs profitaient de la renommée internationale du nom “Champagne” pour vendre des vins bas de gamme.
- Résultat : Grâce à la surveillance douanière et à des actions judiciaires, une partie des stocks a été saisie et détruite, et des sanctions financières ont été infligées aux fraudeurs.
Cette réussite illustre l’importance du travail conjoint des organismes interprofessionnels, des autorités publiques et des producteurs.
Statistiques EUIPO
Selon un rapport de l’EUIPO publié en 2025, la contrefaçon des vins et spiritueux représenterait environ 2,4 milliards d’euros de pertes annuelles au sein de l’Union européenne, dont une part significative pour les AOP françaises. Ce phénomène touche particulièrement les vins de prestige et à forte valeur ajoutée, mais pas uniquement.
Exemple fictif : Domaine Verger de la Lune
Le « Domaine Verger de la Lune » découvre qu’un importateur en Europe de l’Est vend un vin sous l’appellation “Moon Orchard Wines”, avec une étiquette quasi identique.
- Recherche de preuves : Collecte d’échantillons et de photos de l’étiquette contrefaisante.
- Mise en demeure : Lettre envoyée à l’importateur, exigeant la cessation immédiate et le retrait du marché.
- Action judiciaire : Après refus du fraudeur, le domaine poursuit l’importateur pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
- Issue : Le tribunal ordonne la confiscation des bouteilles, le paiement de dommages-intérêts et la publication du jugement.
Conseils pratiques pour lutter contre la contrefaçon et protéger son vin
Protéger sa marque et sa notoriété en amont
- Déposer sa marque : Avant tout lancement, enregistrer la marque au minimum en France (INPI), mais idéalement au niveau européen (EUIPO) ou via l’OMPI pour les pays ciblés.
- Sensibiliser son réseau : Communiquer avec ses distributeurs officiels, importateurs, cavistes, etc. afin qu’ils signalent toute irrégularité constatée.
Renforcer la traçabilité et la sécurité
- Etiquettes sophistiquées : Utiliser des dispositifs d’authentification (hologrammes, QR codes, encres UV…), rendant la copie plus difficile.
- Codes de lot et bases de données : Associer chaque bouteille à un code unique consultable en ligne par le consommateur, pour vérifier l’origine.
- Outils numériques : Certaines solutions blockchain offrent un suivi pointu du parcours de la bouteille, depuis le chai jusqu’au point de vente.
Mettre en place une veille commerciale et juridique
- Surveillance du web : Rechercher régulièrement ses marques ou appellations sur les principales marketplaces et sites d’enchères en ligne.
- Collaboration interprofessionnelle : Les syndicats et interprofessions (CIVC, Inter Rhône, BIVB, BNIC, etc.) jouent un rôle crucial dans la détection et la lutte contre la contrefaçon.
- Procédure douanière proactive : Déposer des demandes d’intervention afin que les douanes ciblent les expéditions suspectes.
Conclusion
La contrefaçon de vin n’est pas seulement un enjeu économique, mais aussi un risque majeur pour l’image et la réputation d’un producteur ou d’une appellation. Alors que les fraudeurs perfectionnent leurs méthodes, il est vital pour chaque acteur du secteur viticole de connaître les mécanismes de protection offerts par la législation, de surveiller activement le marché et d’agir avec fermeté dès le moindre signe d’usurpation.
En anticipant les dépôts de marque, en sécurisant son étiquetage et en travaillant main dans la main avec les autorités et les organisations professionnelles, chaque domaine ou maison de négoce peut ainsi préserver l’authenticité et la valeur de son vin.
Pourquoi choisir le cabinet Dreyfus ?
- Expertise reconnue : Notre équipe possède plus de 20 ans d’expérience dans la protection des marques et la lutte contre la contrefaçon, notamment dans le domaine viticole.
- Réseau international : Nous collaborons avec des partenaires à travers le monde pour agir rapidement sur les marchés clés.
- Stratégie sur mesure : Nous vous aidons à élaborer un plan de veille et de protection adapté à vos marchés, et gérons toutes les procédures (dépôts, oppositions, contentieux).
Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.
Vous faites face à une contrefaçon de votre marque de vin ou d’une appellation ?
- Contactez-nous pour une évaluation gratuite de votre situation.
- Abonnez-vous à notre newsletter pour rester informé des dernières évolutions légales.
- Téléchargez notre guide « 7 étapes essentielles pour lutter contre la contrefaçon de vin », incluant études de cas et check-list complète.
Liens et ressources externes
- INPI : inpi.fr
- EUIPO : euipo.europa.eu
- OMPI : wipo.int
- CIVC : champagne.fr
- INAO : inao.gouv.fr
Protégez l’excellence de votre terroir et faites respecter vos droits : la lutte contre la contrefaçon est un enjeu collectif au service de la qualité et de la réputation du vin français.





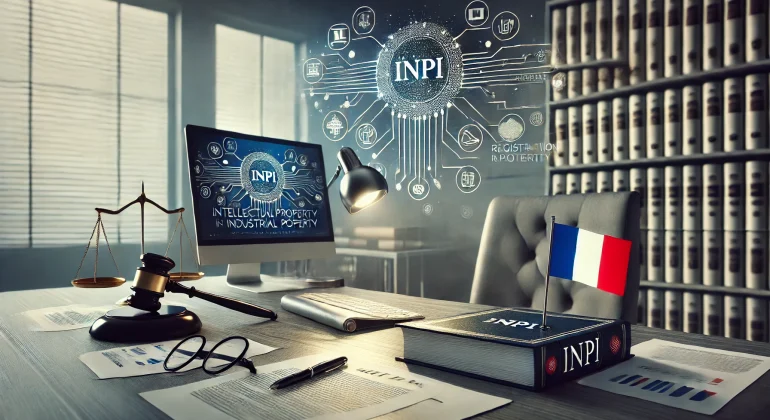



 Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, 20/12763
Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, 20/12763

