Extension .marque : Guide complet pour les entreprises avant la vague ICANN 2026
À l’heure où la confiance numérique devient un actif stratégique, les entreprises cherchent à reprendre le contrôle de leur identité en ligne. La future ouverture du programme ICANN 2026 pour les extensions internet personnalisées, dites .marque, représente une opportunité inédite de bâtir un espace numérique souverain et sécurisé, au nom même de la marque.
Le Cercle des .marques 2025, organisé par l’Afnic, a réuni en octobre les pionniers et experts du domaine pour éclairer les enjeux et les conditions de réussite de cette nouvelle vague. Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus Associés, y a partagé son expertise sur le rôle central de la propriété intellectuelle dans la préparation des candidatures à un .marque. Ce guide complet vous aide à comprendre pourquoi et comment anticiper dès maintenant cette opportunité stratégique avant la vague ICANN 2026.
Pourquoi envisager un .marque ?
Souveraineté numérique et sécurité
Détenir son propre TLD permet à une entreprise de contrôler totalement son écosystème numérique. Elle définit qui peut enregistrer un nom, comment il est utilisé, et sous quelles conditions de sécurité. C’est une réponse directe aux menaces croissantes : phishing, cybersquattage, détournement de nom de domaine. Un .marque, c’est bien plus qu’une extension : c’est une zone numérique souveraine au service de la confiance, souligne Nathalie Dreyfus.
Cohérence de marque et innovation
Avec un .marque, tous les services digitaux – site, extranet, applications, e-commerce – peuvent s’articuler autour d’une même racine, garantissant cohérence et impact. Les usages des pionniers comme .leclerc, .bnpparibas ou .audi démontrent qu’un TLD de marque est un outil puissant de différenciation et d’innovation.
SEO et intelligence artificielle
L’Afnic a mis en avant la convergence entre SEO, IA et nouvelles extensions. Les algorithmes tendent à valoriser la clarté des signaux de marque : un .marque contribue donc à la fiabilité perçue d’un site. À l’ère du Search Generative Experience, où Google et Bing reformulent les requêtes, l’autorité de la source devient clé.
Un investissement stratégique à long terme
La candidature à un .marque représente un investissement conséquent – environ 200 000 USD de frais ICANN + coûts d’exploitation – mais le retour potentiel dépasse le cadre du référencement. Il s’agit d’un actif immatériel stratégique, au même titre qu’une marque enregistrée ou un brevet :
- Protection renforcée contre les usages abusifs
- Valorisation dans la stratégie de communication
- Atout pour les marchés internationaux sensibles à la confiance numérique
Se préparer à la vague 2026
L’Afnic a rappelé le calendrier :
- Décembre 2025 : publication du nouvel Applicant Guidebook par l’ICANN
- Avril 2026 : ouverture des candidatures
Les entreprises doivent anticiper dès aujourd’hui :
- Réunir une équipe pluridisciplinaire : juridique, IT, communication, sécurité
- Évaluer la faisabilité technique et financière
- Définir les usages concrets : clients, partenaires, intranet, marketing
- Construire un dossier solide intégrant la propriété intellectuelle
Les risques à anticiper
- Sous-utilisation : un TLD inactif perd toute valeur stratégique.
- Coûts de gouvernance : un registre mal administré peut nuire à la crédibilité.
- Manque de vision d’ensemble : l’échec vient souvent d’une absence de stratégie d’usage à long terme.
Pour Nathalie Dreyfus, la réussite d’un .marque repose sur la cohérence entre vision juridique, technique et marketing.
Conditions de réussite
- Objectif clair : définir à quoi servira le .marque et pour qui.
- Gouvernance solide : intégrer toutes les parties prenantes dès le départ.
- Usage visible : montrer concrètement la valeur ajoutée du .marque.
- Mesure et pilotage : suivre la performance (trafic, sécurité, notoriété).
- Accompagnement expert : choisir un partenaire maîtrisant à la fois la PI, les règles de l’ICANN et le digital.
Le rôle du cabinet Dreyfus
Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans la protection et la valorisation de leurs actifs immatériels depuis plus de 20 ans. Notre équipe aide les titulaires de marques à :
- Évaluer la pertinence d’un .marque pour leur stratégie digitale
- Constituer le dossier ICANN complet
- Définir la gouvernance et la politique d’enregistrement
- Sécuriser la marque et les sous-domaines
Conclusion
La fenêtre d’opportunité pour les .marque ne s’ouvre qu’une fois par décennie. Les entreprises qui sauront se positionner dès maintenant prendront une longueur d’avance décisive sur la maîtrise de leur identité numérique. Le .marque est la nouvelle frontière du branding : il transforme le nom de domaine en actif stratégique, conclut Nathalie Dreyfus.
FAQ
Qu’est-ce qu’un .marque ?
Un .marque est une extension internet personnalisée (TLD) réservée à une marque enregistrée. Elle permet de créer un espace numérique sécurisé et contrôlé.
Quel coût ?
Les frais ICANN avoisinent 200 000 USD, auxquels s’ajoutent les coûts de gestion annuelle. C’est un investissement de long terme.
Quand puis-je candidater ?
La prochaine fenêtre d’ouverture ICANN est prévue pour avril 2026. La préparation doit commencer dès 2025.





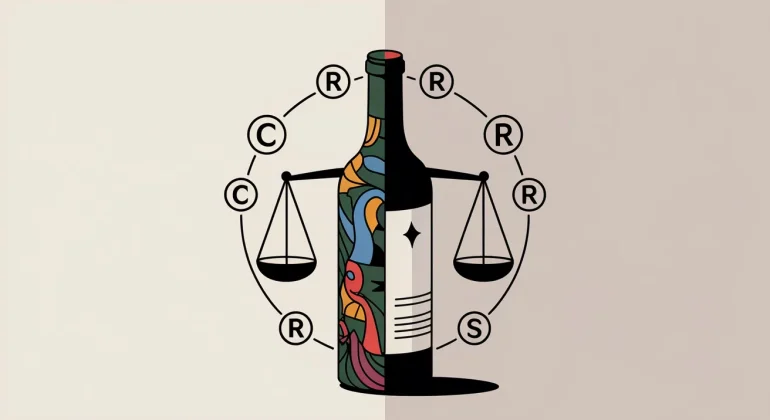



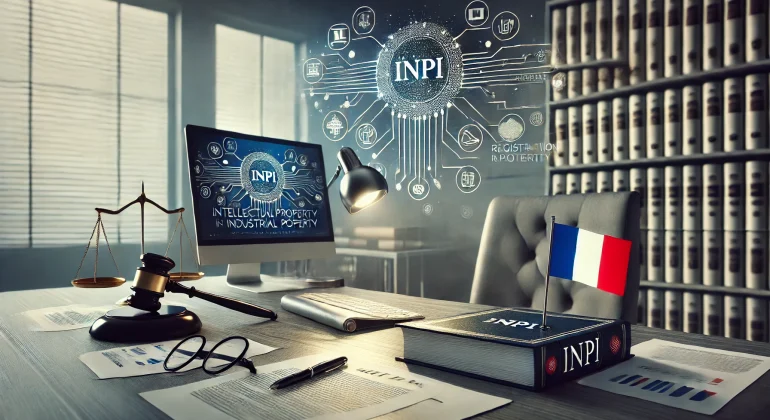

 c
c 