Le Parlement européen adopte de nouvelles mesures pour des emballages plus durables
Dans un contexte où chaque Européen génère près de 190 kilogrammes de déchets d’emballages par an, l’Union européenne a observé une augmentation constante de ces déchets, passant de 66 millions de tonnes en 2009 à 84 millions de tonnes en 2021. Les emballages ont généré un chiffre d’affaires de 355 milliards d’euros en 2018, soulignant leur importance économique mais aussi leur impact environnemental.
Le 22 novembre 2023, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont franchi une étape significative dans la lutte contre les déchets d’emballages en parvenant à un accord provisoire sur un ensemble de mesures visant à redéfinir le marché européen des emballages.
Le 24 avril 2024, le parlement adopte, avec 476 voix pour, 129 contre, et 24 abstentions, ces nouvelles mesures. Les députés ont résisté à un lobbying intense pour favoriser une économie plus circulaire et durable.
Ce règlement s’inscrit dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, lancé en 2019, qui vise à faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone d’ici 2050 et à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, conformément à la loi climat européenne de juin 2021 et à la directive sur les plastiques à usage unique.
Objectifs du nouveau règlement
Avec ces mesures couvrant l’ensemble du cycle de vie des emballages, les objectifs du Parlement sont clairs : répondre aux attentes des citoyens de construire une économie circulaire, d’éviter le gaspillage, d’éliminer progressivement les emballages non durables et de lutter contre l’utilisation d’emballages en plastique à usage unique.
Parmi les objectifs clés, l’UE s’engage à réduire la quantité d’emballages de 5% d’ici 2030, 10% d’ici 2035, et 15% d’ici 2040, en mettant l’accent sur la diminution des emballages plastiques. Pour y parvenir, il sera interdit dès 2030, la mise en circulation d’emballages à usage unique tels que les emballages pour fruits et légumes non transformés. Ces derniers sont souvent dénoncés par l’association Greenpeace, notamment au travers du hashtag #RidiculousPackaging.
En plus de l’interdiction des emballages superflus, les nouvelles mesures imposent des restrictions sur le ratio de vide dans les emballages, interdisant que les emballages contiennent plus de 50 % d’espace vide.
Par ailleurs, pour protéger la santé des consommateurs, des limites strictes seront mises en place concernant l’utilisation des substances alkyles perfluorées et polyfluorées (PFAS) dans les emballages alimentaires.
Favoriser le recyclage
A partir du 1er janvier 2030, la plupart des emballages vendus dans l’Union européenne devront être recyclables et seront classés en fonction de leur niveau de recyclabilité. Il est notamment prévu que les emballages devront être composés à au moins 10% de produits recyclés. De plus, une étiquette devra informer les consommateurs du contenu de ces emballages.
Afin d’améliorer le recyclage des emballages, les contenants de boissons en plastiques ou en métal de moins de 3 litres devront être collectés séparément avec un système de consigne. On note, cependant, une exception non négligeable pour le vin, les spiritueux, et les produits laitiers.
Conclusion
Frédérique Ries, rapporteure du projet, a souligné que, pour la première fois, l’UE fixe des objectifs de réduction des emballages indépendamment du matériau utilisé. Les nouvelles règles favorisent l’innovation et incluent des exemptions pour les micro-entreprises, tout en interdisant les produits chimiques à usage unique dans les emballages alimentaires. Ce règlement est perçu comme une victoire pour la santé des consommateurs européens et appelle à une collaboration entre tous les secteurs industriels, les pays membres de l’UE, et les consommateurs pour combattre les emballages excédentaires.
Le Conseil doit encore approuver formellement cet accord avant qu’il n’entre en vigueur. Mais, cette législation marque un pas de plus vers la réalisation des objectifs environnementaux de l’UE, en intégrant les préoccupations des citoyens pour une gestion plus durable des ressources et la réduction des impacts environnementaux des emballages.
Dreyfus est engagé pour l’environnement afin de réduire nos déchets et optimiser notre consommation d’énergétique.
Le cabinet Dreyfus collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !






 « La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.
« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.


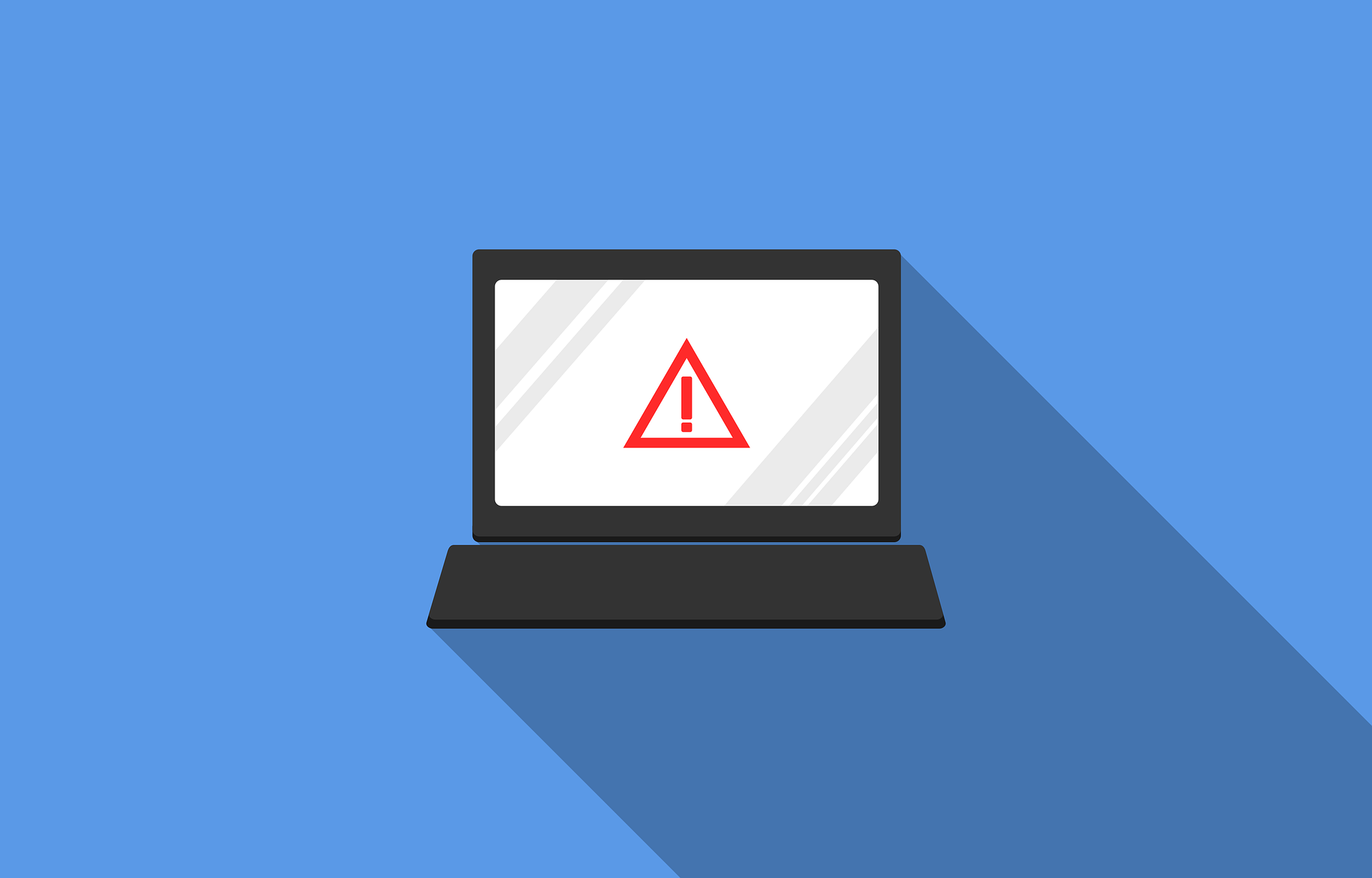

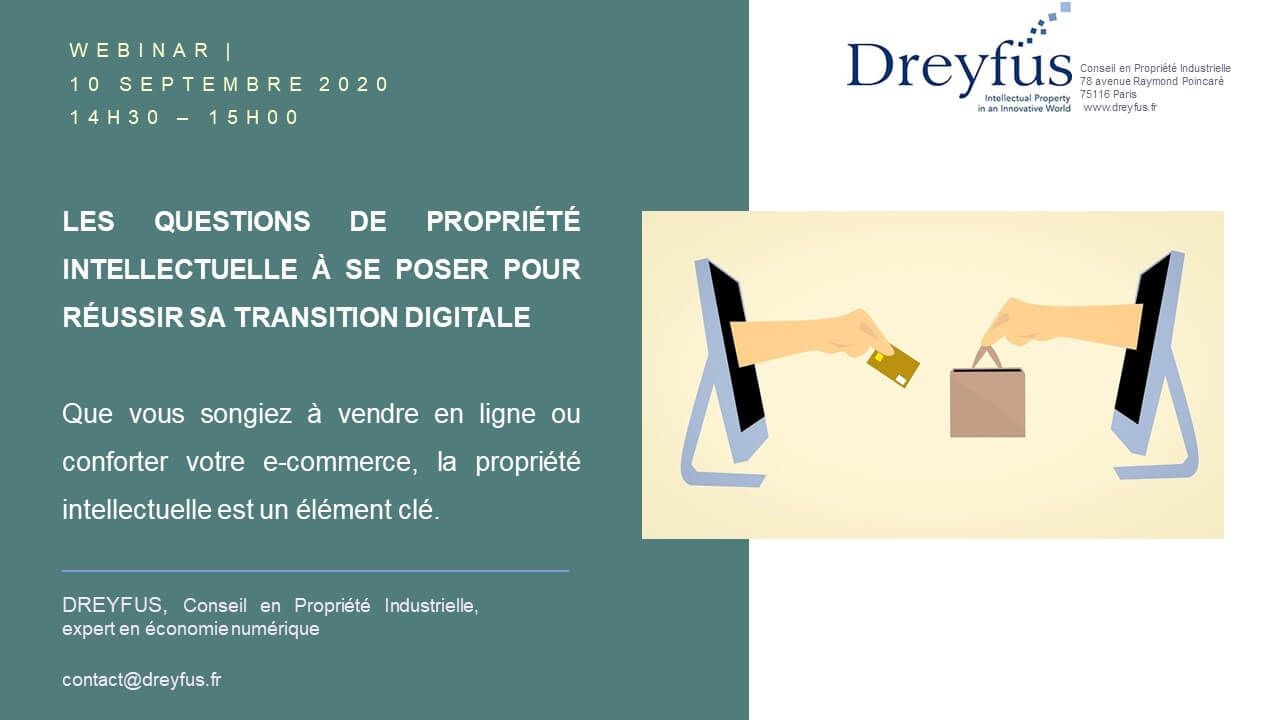 Webinar 10 septembre 2020 :
Webinar 10 septembre 2020 :