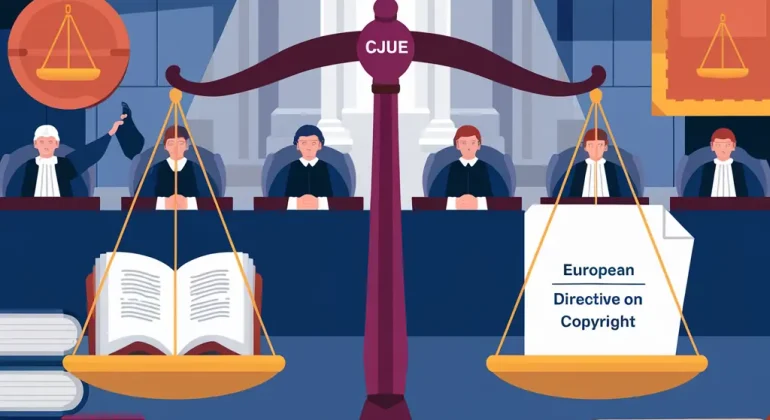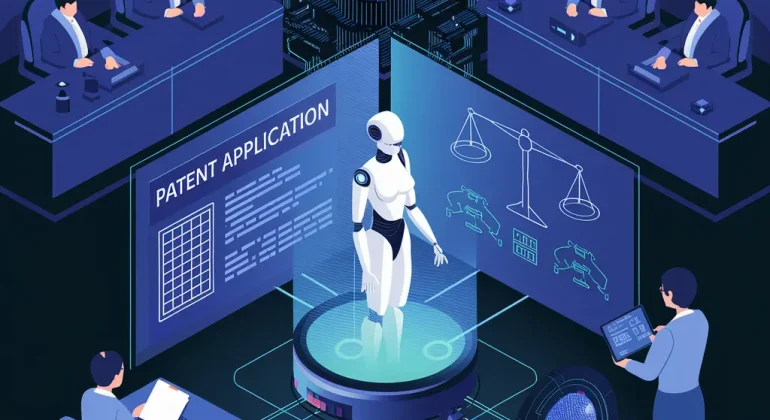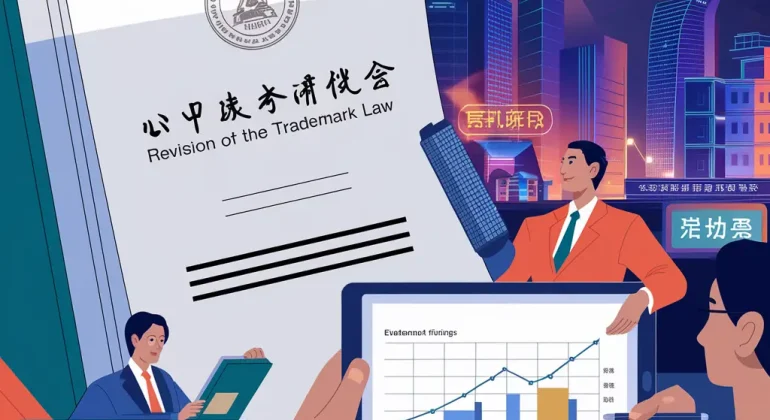L’annulation de l’interdiction des expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales »
Le 28 janvier 2025, par deux décisions majeures (n° 465835 et n° 492839), le Conseil d’État a annulé les décrets n° 2022-947 et n° 2024-144 interdisant l’usage des expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales ». Cette décision s’aligne sur la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui avait précédemment abordé cette question (arrêt du 4 octobre 2024, affaire C‑438/23). Ce jugement a des répercussions importantes pour l’industrie alimentaire, notamment en ce qui concerne l’étiquetage des produits végétaux. Il marque également un tournant dans le débat juridique sur l’utilisation de terminologies traditionnelles dans le secteur alimentaire face à la montée des alternatives végétales. Dreyfus vous accompagne pour expliquer la portée de ces décisions.
Contexte de l’affaire
Le cadre juridique de l’interdiction
L’interdiction des termes « steaks de soja » et « saucisses végétales » avait été imposée par le gouvernement français en raison de préoccupations concernant la possibilité que ces expressions induisent en erreur les consommateurs, en leur faisant croire que les produits étaient à base de viande. Cependant, des entreprises du secteur végétal ont contesté ces décrets, estimant qu’ils constituaient une restriction injustifiée de leur liberté de commercialisation. La question de savoir si cette interdiction respectait les principes européens en matière de concurrence et de liberté de marché a été soulevée, et c’est ainsi que le Conseil d’État a pris la décision de revenir sur cette mesure.
Le rôle du droit européen
La décision du Conseil d’État intervient après un arrêt important rendu par la CJUE le 4 octobre 2024 (affaire C‑438/23). La Cour avait jugé que de telles interdictions pouvaient enfreindre la liberté commerciale des entreprises, tant que les produits étaient clairement étiquetés comme étant d’origine végétale et non animale. Cette position a été cruciale dans l’évaluation par le Conseil d’État, qui a considéré que les décrets français ne respectaient pas les principes de liberté de circulation des marchandises et de marketing définis par l’Union européenne.
Raisonnement juridique derrière l’annulation
L’impact de l’arrêt de la CJUE
Le Conseil d’État, dans ses décisions du 28 janvier 2025, a suivi la logique de la CJUE en concluant que la réglementation française interdisant les termes comme « steaks de soja » et « saucisses végétales » était excessive. Le Conseil d’État a souligné qu’une telle interdiction était trop restrictive, d’autant plus que ces termes pouvaient être utilisés à condition qu’il y ait une mention claire précisant que les produits étaient végétaux. Cette décision vise à assurer une plus grande liberté pour les producteurs tout en préservant la transparence nécessaire pour les consommateurs.
Protection des consommateurs contre liberté des entreprises
Le Conseil d’État a estimé qu’il était possible de concilier la protection des consommateurs et la liberté commerciale des entreprises. Il a affirmé que l’usage de termes tels que « steaks » ou « saucisses » ne créait pas de confusion pour les consommateurs, à condition que l’étiquetage précise clairement que ces produits sont d’origine végétale. Cette solution permet d’éviter une réglementation trop rigide, qui pourrait nuire au développement du marché des produits végétaux tout en protégeant les consommateurs contre les abus.
Implications pour l’industrie alimentaire végétale
Plus de flexibilité pour les producteurs
L’annulation de l’interdiction ouvre de nouvelles perspectives pour les producteurs de produits végétaux. Ceux-ci peuvent désormais utiliser des termes comme « steaks de soja » et « saucisses végétales » dans leurs communications marketing sans crainte de sanctions. Cela leur permet de mieux répondre à la demande croissante de produits à base de plantes, qui est en plein essor en France et en Europe. Cette décision permet ainsi une plus grande liberté pour les producteurs tout en garantissant une information claire et non trompeuse pour les consommateurs.
Impact sur le comportement des consommateurs
Cette décision a également des implications directes sur les comportements des consommateurs. Elle garantit une meilleure lisibilité des produits végétaux sur le marché et facilite la transition vers des alternatives végétales en réduisant la confusion sur leur nature. Les consommateurs peuvent ainsi faire des choix éclairés tout en étant assurés de l’origine végétale des produits, ce qui est essentiel pour ceux qui optent pour des régimes végétariens ou véganes.
Conclusion
L’annulation des décrets interdisant les expressions « steaks de soja » et « saucisses végétales » par le Conseil d’État constitue une victoire pour l’industrie alimentaire végétale. En s’alignant sur la position de la CJUE, cette décision permet aux producteurs de mieux communiquer sur leurs produits tout en préservant la transparence pour les consommateurs. Elle souligne également l’importance de trouver un équilibre entre protection du consommateur, innovation des entreprises et respect des principes européens de liberté de marché.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.
Nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
FAQ
1. Pourquoi la France a-t-elle imposé une interdiction sur les termes « steaks de soja » et « saucisses végétales » ?
La France a imposé cette interdiction pour éviter toute confusion chez les consommateurs, estimant que ces termes pouvaient les induire en erreur en leur faisant croire que ces produits étaient à base de viande.
2. Quel est l'impact de l'arrêt de la CJUE sur l'étiquetage alimentaire en Europe ?
L'arrêt de la CJUE a souligné que les produits végétaux peuvent utiliser des termes alimentaires traditionnels, à condition que l'étiquetage indique clairement qu'il s'agit de produits à base de plantes, favorisant ainsi la liberté de marketing tout en protégeant les consommateurs.
3. Quel était le raisonnement juridique derrière la décision du Conseil d'État ?
La décision du Conseil d'État repose sur les principes européens de libre marché et de libre circulation des biens, ainsi que sur l'arrêt de la CJUE, qui autorise l’utilisation de termes alimentaires traditionnels pour les produits végétaux, sous réserve d’une mention claire de leur origine.