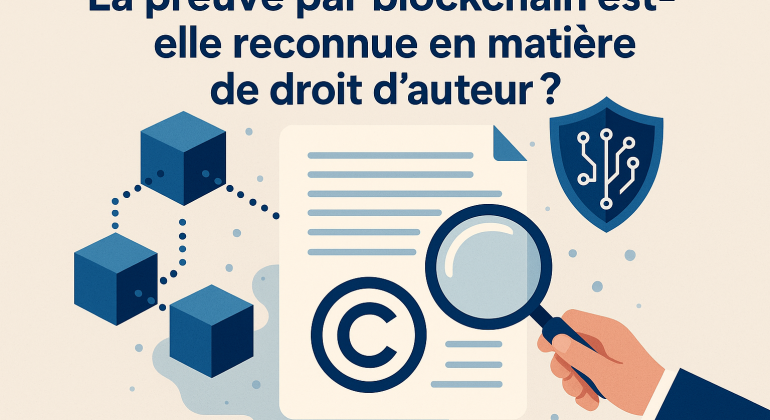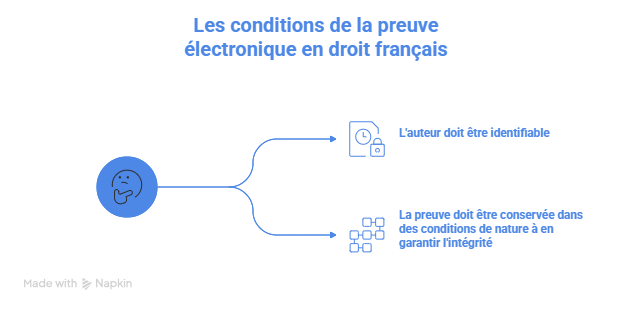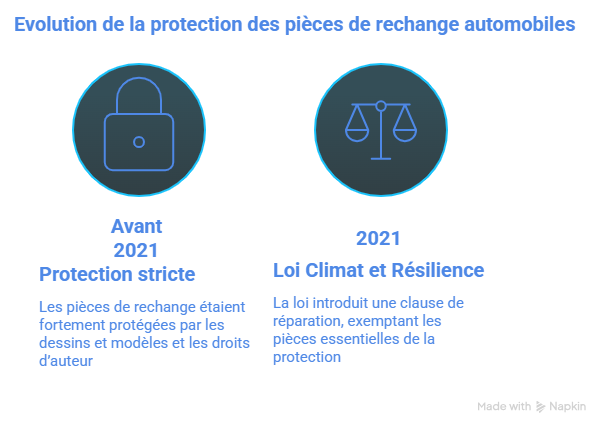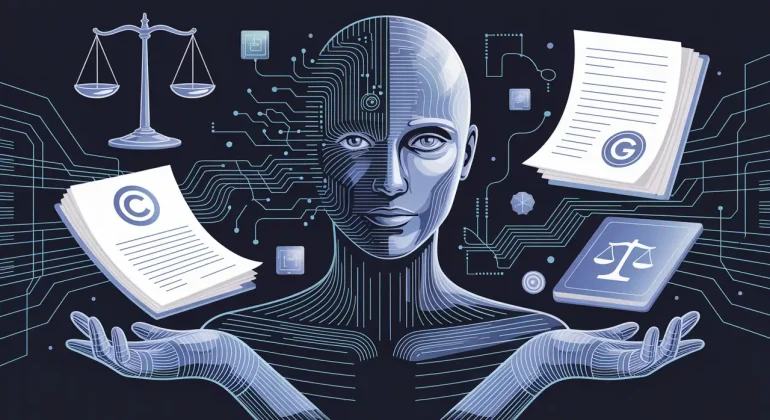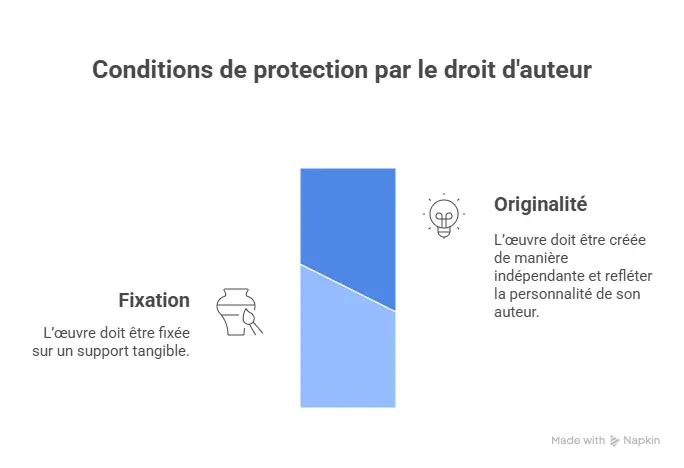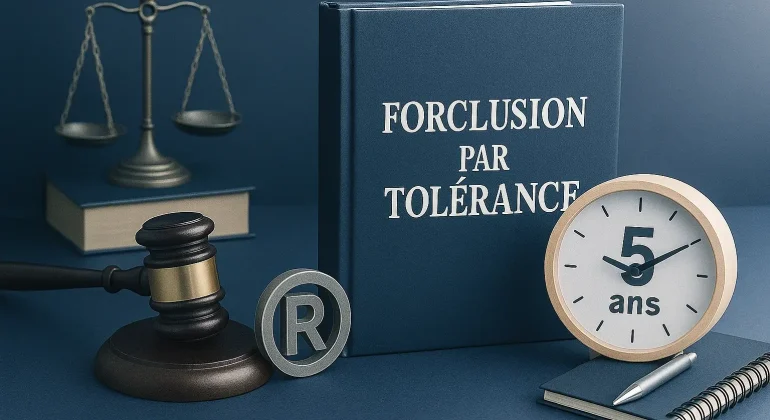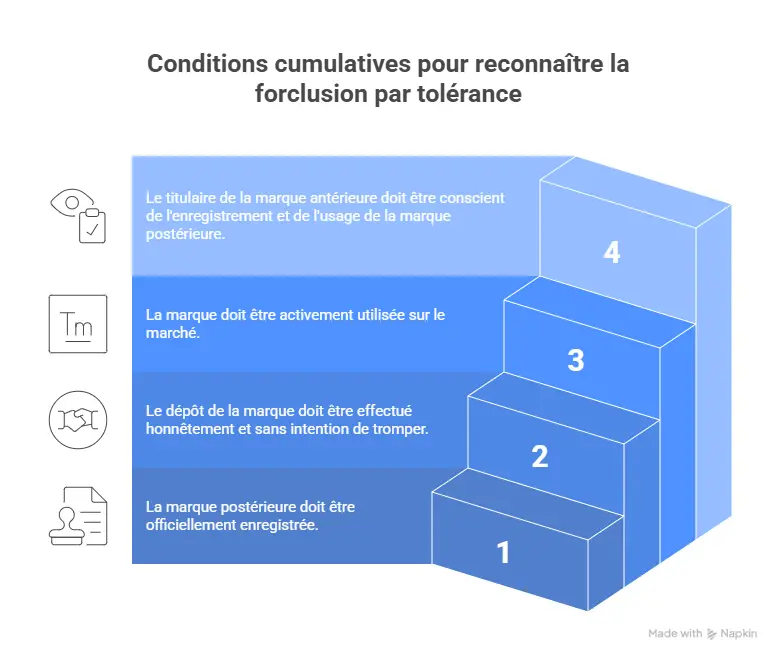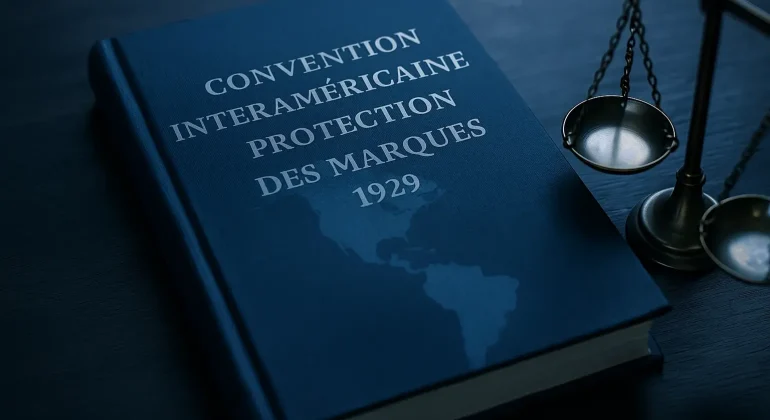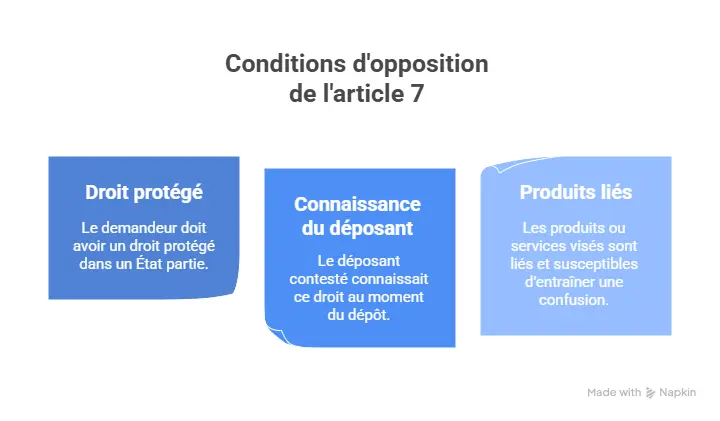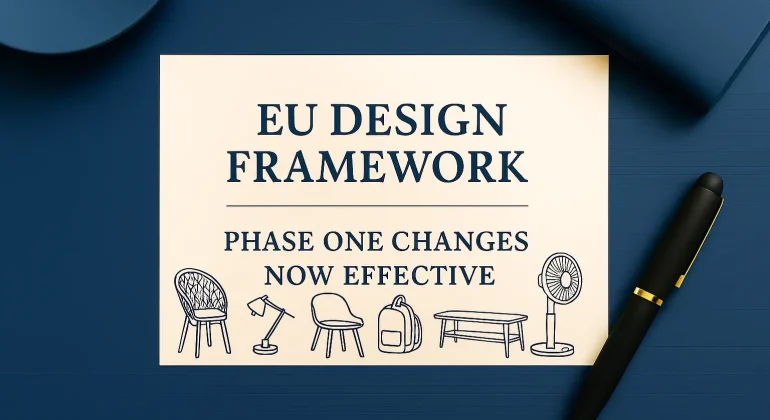Guide pratique pour sélectionneurs, entreprises semencières et conseils en propriété intellectuelle
Dernière mise à jour : Septembre 2025
Les obtentions végétales représentent un enjeu économique majeur dans l’industrie semencière mondiale. Ce guide complet vous accompagne dans l’optimisation de vos stratégies de protection variétale, de la création au contentieux.
Qu’est-ce qu’une obtention végétale ?
Définition du certificat d’obtention végétale (COV)
Le certificat d’obtention végétale (COV) est un titre de propriété intellectuelle qui protège les variétés végétales nouvelles. Contrairement au brevet, il s’agit d’un système de protection sui generis spécialement adapté au vivant végétal.
Variétés protégeables :
- Toutes les espèces botaniques (cultivées ou sauvages)
- Variétés créées par sélection traditionnelle
- Hybrides F1 et lignées parentales
- Variétés issues de biotechnologies (sous conditions réglementaires)
Cadre juridique français et international
En France :
- Articles L623-1 à L623-35 du Code de la propriété intellectuelle
- Instance nationale des obtentions végétales (INOV) au GEVES
- Comité technique permanent de la sélection (CTPS) : autorité consultative
Au niveau international :
- Convention UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales)
- 76 pays membres en 2025
- Acte de 1991 : standard de référence actuel
Au niveau européen :
- Office communautaire des variétés végétales (OCVV) à Angers
- Protection unitaire sur les 27 États membres
- Règlement CE n° 2100/94
Durée de protection
| Type de variété |
Durée de protection |
| Variétés agricoles standard |
25 ans |
| Arbres fruitiers, forestiers, vignes |
30 ans |
| Pommes de terre |
30 ans |
Source : Loi n° 2006-236 du 1er mars 2006
Les 4 critères DHS de protection
Pour être protégée, une variété doit satisfaire cumulativement aux 4 critères UPOV :
Distinction (D)
La variété doit se distinguer nettement de toute variété notoirement connue à la date de dépôt.
Méthode d’évaluation :
- Comparaison avec les variétés de référence les plus proches
- Observation de caractères morphologiques et physiologiques
- Application des protocoles techniques UPOV spécifiques à chaque espèce
Variétés notoirement connues :
- Variétés protégées dans tout pays
- Variétés inscrites aux catalogues officiels
- Variétés commercialisées publiquement
- Variétés décrites dans des publications spécialisées
Homogénéité (H)
La variété doit être suffisamment homogène dans ses caractères pertinents, compte tenu de son mode de reproduction.
Standards d’homogénéité :
- Variétés autogames : homogénéité très élevée (> 99%)
- Variétés allogames : tolérance selon l’espèce
- Variétés clonales : homogénéité quasi-parfaite
Stabilité (S)
La variété doit demeurer conforme à sa description après reproductions successives.
Démonstration :
- Minimum 2 cycles de reproduction
- Maintien des caractères distinctifs
- Absence de ségrégation anormale
Nouveauté
La variété ne doit pas avoir été commercialisée avec l’accord de l’obtenteur :
- Plus d’1 an avant le dépôt (territoire national)
- Plus de 4 ans avant le dépôt (autres pays)
- Plus de 6 ans pour arbres et vignes (autres pays)
Attention : La commercialisation par un tiers sans autorisation ne détruit pas la nouveauté.
Procédures de dépôt en France et en Europe
Protection nationale française
Autorité compétente : Instance nationale des obtentions végétales (INOV) au GEVES
Procédure :
- Dépôt de la demande avec questionnaire technique détaillé
- Examen formel : vérification de la complétude du dossier
- Essais DHS : examen officiel de distinction, homogénéité, stabilité
- Examen de la dénomination variétale
- Délivrance du certificat ou rejet motivé
Délais indicatifs :
- Examen formel : 2-3 mois
- Essais DHS : 2-3 saisons de culture
- Durée totale : 24-36 mois
Protection européenne (OCVV)
Autorité compétente : Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Avantages :
- Protection unitaire sur 27 pays UE
- Procédure unique en français, anglais ou allemand
- Coût optimisé pour une couverture européenne
Procédure similaire au dépôt national avec examen technique externalisé
Constitution du dossier technique
Questionnaire technique :
- Description précise de la variété
- Caractères distinctifs mis en évidence
- Méthode de création ou découverte
- Comparaisons avec variétés similaires
Matériel végétal requis :
- Quantités selon protocoles UPOV
- Pureté variétale certifiée (>98% généralement)
- Faculté germinative conforme aux standards
- Conditionnement adapté au transport et stockage
Documentation complémentaire :
- Photographies représentatives
- Analyses biochimiques (si pertinentes)
- Données d’essais préliminaires
- Généalogie de sélection
Stratégies de protection internationale
Choix de la stratégie territoriale
Option 1 : protection nationale
- Public cible : PME, variétés de niche
- Marchés : exploitation locale/régionale
- Coûts : investissement limité (quelques milliers d’euros)
Option 2 : protection européenne OCVV
- Public cible : entreprises moyennes/grandes
- Marchés : commercialisation UE
- Avantage : une procédure = 27 pays
Option 3 : protection multi-pays
- Public cible : leaders mondiaux
- Stratégie : dépôts coordonnés pays par pays
- Cibles : USA, Canada, Australie, Japon, Brésil…
Planification temporelle
Timing optimal :
- Protection précoce : dépôt dès la stabilisation variétale
- Priorité Union : 12 mois pour étendre internationalement
- Coordination : planifier les dépôts selon les saisons d’essais
Gestion de portefeuille
Approche segmentée :
- Variétés stratégiques : protection large et défense active
- Variétés de volume : protection ciblée marchés clés
- Variétés émergentes : protection évolutive selon développement commercial
Valorisation commerciale et contrats
Modèles économiques
Exploitation directe
- Production et commercialisation propre
- Marges élevées mais investissements lourds
- Contrôle total de la chaîne de valeur
Licences d’exploitation
- Revenus récurrents sans investissement productif
- Multiplication des débouchés commerciaux
- Partage des risques avec les licenciés
Structuration des contrats de licence
Modalités de rémunération typiques :
| Mode de calcul |
Fourchettes sectorielles |
| Forfait d’entrée |
5 000 € – 50 000 € |
| Redevances sur CA semences |
3% – 8% |
| Redevances par unité |
0,10 € – 1 € par kg |
| Minimum garanti annuel |
10 000 € – 100 000 € |
Clauses essentielles :
- Territoire : définition géographique précise
- Exclusivité : exclusive, co-exclusive ou non-exclusive
- Performance : objectifs de commercialisation
- Qualité : standards de production et pureté
Contrats de recherche collaborative
Partenariats R&D :
- Partage des coûts de développement variétal
- Échange de ressources génétiques
- Co-titularité des innovations créées
Points de négociation :
- Répartition des droits selon les contributions
- Territoires d’exploitation respectifs
- Gestion des développements parallèles
- Confidentialité des informations échangées
Défense des droits et contentieux
Surveillance du marché
Veille concurrentielle :
- Monitoring des nouveaux dépôts sectoriels
- Analyse génétique des variétés suspectes
- Contrôles terrain chez distributeurs et producteurs
Détection de contrefaçon :
- Analyses ADN : marqueurs moléculaires spécifiques
- Expertise morphologique : comparaison des caractères DHS
- Traçabilité documentaire : origine des semences
Actions en contrefaçon
Conditions de l’action :
- Titre valable : COV en vigueur et annuités payées
- Actes de contrefaçon : production, commercialisation sans licence
- Variété identique : preuve de l’identité variétale
Mesures disponibles :
- Saisie-contrefaçon : conservatoire ou au fond
- Expertise judiciaire : analyses comparatives
- Dommages-intérêts : réparation du préjudice subi
- Mesures d’interdiction : cessation des actes illicites
Exceptions légales
Exception de recherche :
- Recherche fondamentale libre sur variétés protégées
- Limite : distinction avec essais pré-commerciaux
Privilège de l’agriculteur :
- Auto-consommation : réutilisation de sa propre récolte
- Espèces concernées : liste européenne limitative
- Conditions : exploitation propre, redevance éventuelle
Évolutions technologiques et réglementaires
Nouvelles techniques de sélection (NBT)
Technologies émergentes :
- Édition génomique (CRISPR-Cas9, TALEN)
- Mutagénèse dirigée
- Cisgénèse et techniques apparentées
Enjeux de brevetabilité
Les nouvelles techniques génomiques (NGT) soulèvent des questions inédites sur l’articulation entre obtentions végétales et brevets. Pour décrocher son brevet, un obtenteur devra avoir « démontré un apport technique qui dépasse la simple sélection », selon Nathalie Dreyfus, conseil en propriété industrielle expert près la Cour de cassation.
Impact des NGT sur la brevetabilité :
- Facilitation des conditions : Les NGT permettent d’identifier et reproduire rapidement des mutations naturelles
- Description technique : Possibilité de définir scientifiquement des inventions
- Accès aux critères : Nouveauté, activité inventive et application industrielle plus facilement réunies
Risques et opportunités
Craintes juridiquement fondées : La crainte de certains obtenteurs, qui voient les NGT comme « un cheval de Troie aux brevets », est « juridiquement fondée », indique Nathalie Dreyfus. Le risque d’augmentation des brevets et la création d’un « enchevêtrement de droits » sont réels. Cette situation peut conduire « les semenciers à négocier des licences ou à s’exposer à des contentieux en cas d’utilisation non autorisée ».
Impact économique : Ce cumul de droits « se traduirait nécessairement par une hausse des coûts de transaction, et donc, à terme, par une augmentation du prix des semences ». Pour les agriculteurs, cette hausse « ne serait pas visible directement, mais intégrée dans le prix final des semences ».
Compensation possible : Toutefois, « si les NGT apportent de véritables bénéfices agronomiques (meilleure résistance aux maladies, réduction des besoins en intrants), l’investissement supplémentaire pourrait être compensé » par un recul des coûts de production et une meilleure rentabilité des exploitations. « Tout dépendra de l’équilibre entre l’augmentation des coûts (juridiques et commerciaux) et les gains techniques et économiques permis par les variétés NGT », sans oublier ceux environnementaux.
Limites de la brevetabilité
Traits non brevetables : Les traits natifs des plantes, c’est-à-dire ceux qui existent naturellement dans une espèce ou qui résultent de processus biologiques classiques, « ne sont pas brevetables en Europe », explique Nathalie Dreyfus. Tous les traits issus de NGT-1, considérés comme des techniques de sélection conventionnelle, ne répondront pas forcément aux critères de brevetabilité.
Coexistence des systèmes
Selon Nathalie Dreyfus, les deux systèmes de propriété intellectuelle peuvent poursuivre leur coexistence après une autorisation des NGT. Cette coexistence « permet de maintenir un équilibre et de garantir une protection efficace des innovations tout en préservant la liberté de sélection des semenciers », à condition de réserver les brevets « aux traits véritablement innovants, et non à des caractéristiques naturelles ou des modifications mineures ».
Position réglementaire :
- UPOV : éligibilité des variétés NBT si critères DHS respectés
- UE : négociations en cours entre Conseil (favorable aux brevets) et Parlement (opposition majoritaire)
- Enjeu : équilibre entre innovation et accès au matériel génétique
Digitalisation des procédures
Innovations technologiques :
- Phénotypage automatisé : capteurs IoT, drones, IA
- Bases de données génomiques : caractérisation moléculaire
- Blockchain : traçabilité et lutte anti-contrefaçon
Perspectives d’évolution :
- Dématérialisation des procédures administratives
- Harmonisation des standards techniques internationaux
- Accélération des examens par l’IA
Guide pratique étape par étape
Phase pré-dépôt (6-12 mois avant)
Check-list technique :
- Stabilisation variétale : homogénéité > seuil espèce
- Tests DHS préliminaires : distinction confirmée
- Recherche d’antériorités : variétés proches identifiées
- Multiplication de semences : stocks pour essais officiels
- Documentation technique : questionnaire préparé
Check-list stratégique :
- Analyse marché : potentiel commercial évalué
- Budget protection : coûts pluriannuels provisionnés
- Stratégie territoriale : pays prioritaires définis
- Dénomination : nom disponible vérifié
Procédure de dépôt
Planning type (exemple céréales d’hiver) :
| Période |
Actions |
| Septembre N |
Dépôt demande + questionnaire |
| Octobre N |
Fourniture matériel végétal essais |
| Avril N+1 |
1ère saison d’observation |
| Septembre N+1 |
Complément matériel si nécessaire |
| Avril N+2 |
2ème saison d’observation |
| Septembre N+2 |
Décision finale attendue |
Post-obtention
Gestion commerciale :
- Stratégie de commercialisation définie
- Partenaires distributeurs identifiés
- Contrats de licence négociés
- Plan marketing variétal déployé
Protection des droits :
- Surveillance marché organisée
- Échéances annuités calendées
- Maintien lignées pures sécurisé
- Procédures contentieuses préparées
Questions fréquemment posées
Combien coûte une protection d’obtention végétale ?
Coûts indicatifs France (hors conseil) :
- Dépôt initial : 500-1 000 €
- Essais DHS : 2 000-5 000 € selon espèce
- Annuités de maintien : 200-500 € par an
- Total sur 25 ans : 10 000-20 000 €
Peut-on protéger une variété déjà commercialisée ?
Non, sauf si la commercialisation :
- Remonte à moins d’1 an (France)
- Était sans l’accord de l’obtenteur (contrefaçon)
- Concernait uniquement des essais à petite échelle
Quelle est la différence entre obtentions végétales et brevets face aux NGT ?
Impact des nouvelles techniques génomiques :
| Critère |
Obtention végétale |
Brevet (avec NGT) |
| Objet |
Variété dans son ensemble |
Trait spécifique breveté |
| Accès matériel génétique |
Libre pour sélection |
Licence nécessaire si trait breveté |
| Coûts |
Redevances COV standards |
Potentielle hausse des coûts de transaction |
| Durée |
25-30 ans |
20 ans |
| « Semences de ferme » |
Droit maintenu |
Autorisation du détenteur du brevet requise |
Enjeux économiques : Les NGT pourraient créer un « enchevêtrement de droits » augmentant les coûts de transaction. Cependant, les bénéfices agronomiques (résistance aux maladies, réduction d’intrants) pourraient compenser ces surcoûts.
Comment choisir entre protection nationale et européenne ?
Protection nationale si :
- Budget limité (< 10 000 €)
- Marché principalement français
- Variété de niche locale
Protection européenne si :
- Ambition commerciale européenne
- Budget > 15 000 €
- Variété à fort potentiel
Que dit la réglementation européenne sur les NGT et les brevets ?
État des négociations (septembre 2025) :
- Conseil de l’UE : favorable à la brevetabilité des traits NGT
- Parlement européen : opposition majoritaire aux brevets
- Présidence danoise : priorité donnée au dossier pour fin 2025
- Vote final : prévu premier semestre 2026
Points de débat :
- Étiquetage des NGT tout au long de la chaîne
- Coexistence cultures NGT/conventionnelles/bio
- Articulation brevets/certificats d’obtention végétale
Position des professionnels : « Le COV doit rester l’alpha et l’oméga du métier de l’obtenteur », selon l’Union française des semenciers, tout en gardant l’accès aux brevets pour les « réelles innovations ».
Conclusion
Les obtentions végétales constituent un levier stratégique essentiel pour les acteurs de la filière semencière. Une approche professionnelle de la protection variétale, intégrant les dimensions technique, juridique et commerciale, conditionne la compétitivité et la rentabilité des investissements R&D.
L’évolution rapide des technologies de sélection et de l’environnement réglementaire nécessite un accompagnement spécialisé pour optimiser les stratégies de protection et de valorisation.
Dans un contexte de changement climatique et de défis alimentaires mondiaux, l’innovation variétale devient plus que jamais cruciale. Les obtentions végétales offrent le cadre juridique nécessaire pour protéger et valoriser ces innovations, tout en préservant l’équilibre entre droits privatifs et intérêt général.
Avertissement : Ce guide a une valeur purement informative. Les procédures, coûts et délais mentionnés sont indicatifs et susceptibles d’évoluer. Pour toute question spécifique à vos obtentions végétales, consultez un conseil en propriété intellectuelle spécialisé.
Besoin d’accompagnement ? Contactez nos experts en obtentions végétales
Ressources utiles
Liens officiels :
Documentation technique :
- Protocoles d’examen UPOV par espèce
- Guidelines OCVV pour demandeurs
- Code de la propriété intellectuelle (articles L623-1 et suivants)
- Jurisprudence en matière d’obtentions végétales
Actualités réglementaires :