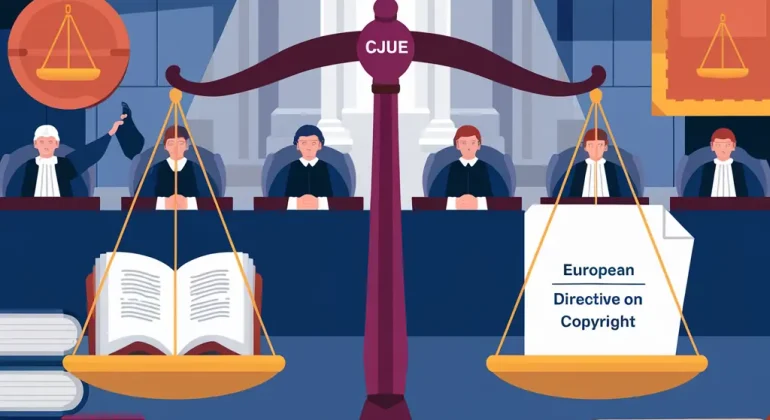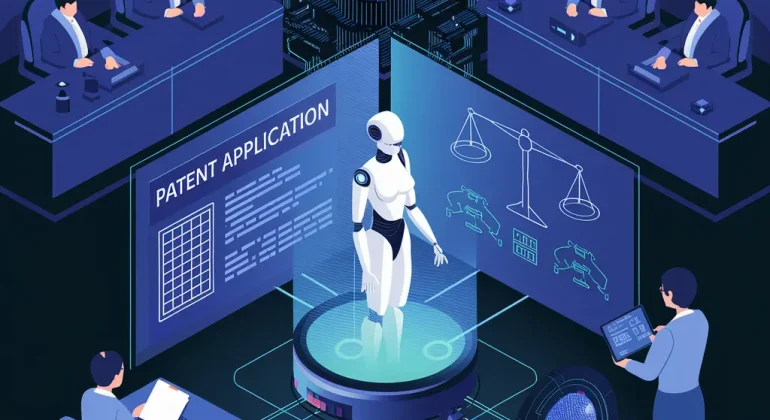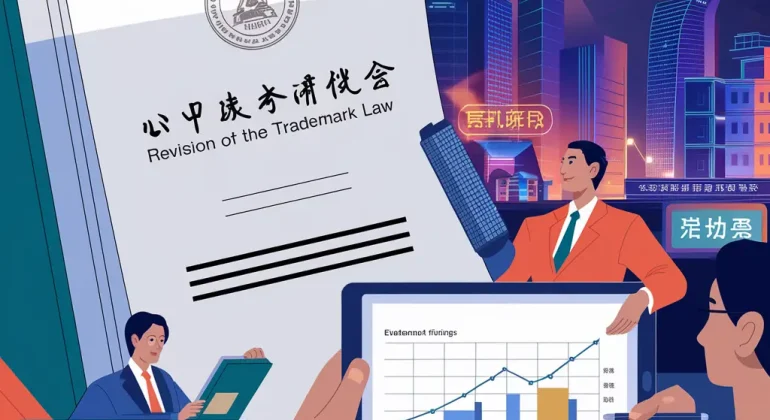Évolution jurisprudentielle concernant les marques déposées pour le compte d’une société en cours de formation : vers une simplification du formalisme
La protection d’une marque est essentielle pour toute entreprise, y compris celles en cours de formation. Le dépôt d’une marque au nom et pour le compte d’une société en formation soulève des questions juridiques complexes, notamment en matière de reprise des actes et de titularité des droits. Récemment, la jurisprudence française a évolué vers une simplification du formalisme requis pour ces actes.
Contexte juridique des sociétés en formation
Définition et cadre légal
Une société en formation est une entité juridique en cours de constitution qui n’a pas encore acquis la personnalité morale, laquelle intervient à l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Durant cette période, les actes peuvent être accomplis par les fondateurs au nom et pour le compte de la future société. Ces actes pourront être repris par la société une fois immatriculée, conformément aux articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce.
Procédures de reprise des actes
La reprise des actes peut s’effectuer de trois manières :
Par une mention dans les statuts de la société, annexant la liste des actes accomplis pour son compte.
Par un mandat donné par les associés à l’un d’eux pour accomplir des actes déterminés.
Par une décision prise par la société après son immatriculation, approuvant expressément les actes accomplis.
Dépôt de marque pour une société en formation
Importance du dépôt anticipé
Déposer une marque avant l’immatriculation de la société permet de sécuriser le nom commercial et d’éviter que des tiers n’en prennent possession. Ce dépôt est généralement effectué par un fondateur agissant pour le compte de la société en cours de formation.
Risques liés à l’absence de régularisation
Si, après l’immatriculation, la société ne procède pas à la régularisation du dépôt de marque, elle ne sera pas considérée comme titulaire de celle-ci. Cela signifie qu’elle ne pourra pas agir en contrefaçon ou défendre ses droits sur la marque. De plus, le fondateur ayant effectué le dépôt restera personnellement responsable.
Évolution jurisprudentielle récente
Revirement de la Cour de cassation du 29 novembre 2023
Par trois arrêts rendus le 29 novembre 2023 (n°22-12.865, n°22-18.295 et n°22-21.623), la Cour de cassation a assoupli les conditions de reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation. Auparavant, seuls les actes mentionnant expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation pouvaient être repris. Désormais, les juges peuvent apprécier la commune intention des parties, même en l’absence de telles mentions explicites.
Implications pour les sociétés en formation
Cette évolution facilite la reprise des actes et réduit le formalisme auparavant exigé. Les fondateurs disposent ainsi d’une plus grande flexibilité dans la gestion des actes préalables à l’immatriculation.
Étude de cas : l’affaire « PROPULSE »
Dans une affaire récente, décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er octobre 2024 (n° 24/01144), une marque « PROPULSE » avait été déposée par une personne physique « agissant pour le compte de la société Submersive Drinks en cours de formation ». Après l’immatriculation, aucune démarche de transfert de la marque à la société n’a été effectuée. Lorsqu’une action en contrefaçon a été intentée, le tribunal a jugé la société irrecevable, car elle n’était pas titulaire de la marque.
Recommandations pratiques pour les entrepreneurs
Formaliser les actes : Même si la jurisprudence a assoupli les exigences, il est recommandé de préciser dans les actes qu’ils sont conclus « au nom et pour le compte de la société en formation ».
Annexer les actes aux statuts : Lister les actes accomplis pour le compte de la société en formation en annexe des statuts facilite leur reprise automatique après l’immatriculation.
Effectuer les formalités post-immatriculation : Après l’immatriculation, procéder aux démarches nécessaires pour transférer officiellement la titularité de la marque à la société, notamment via une inscription modificative auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle récente simplifie le formalisme lié aux actes accomplis pour le compte d’une société en formation, notamment en matière de dépôt de marque. Toutefois, une vigilance demeure nécessaire pour assurer la protection des droits de la société sur sa marque.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.
Nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !