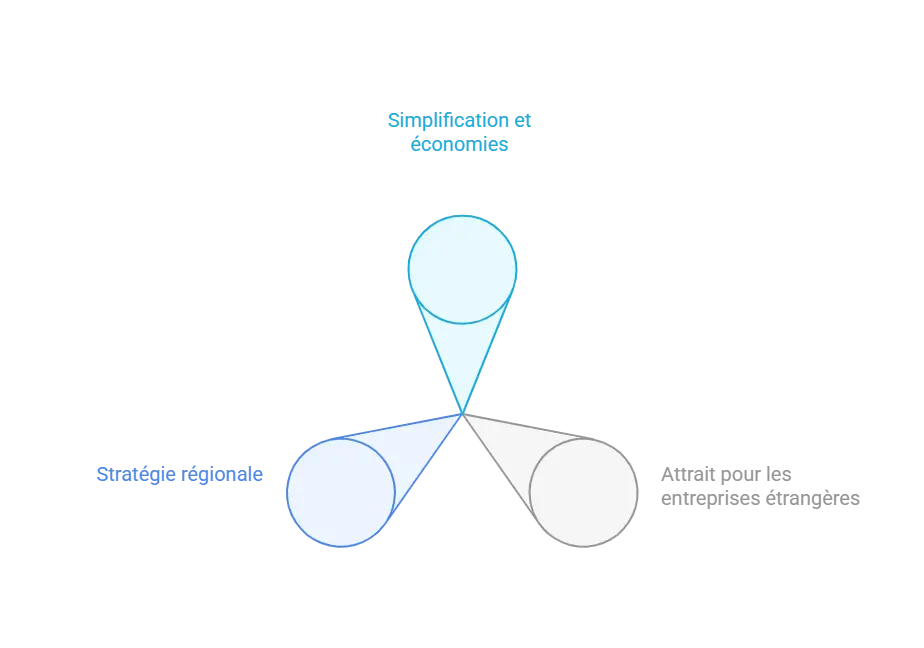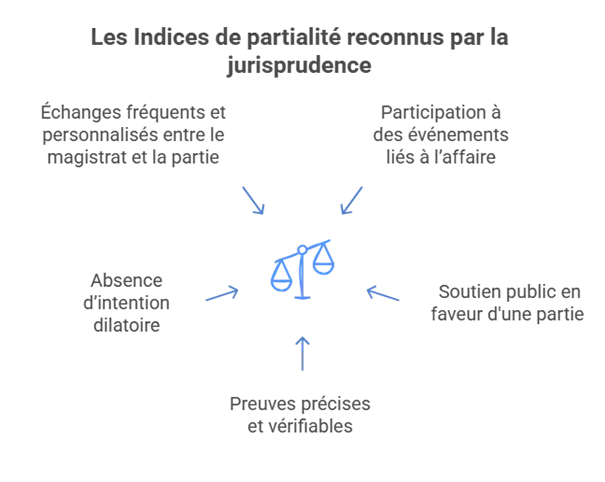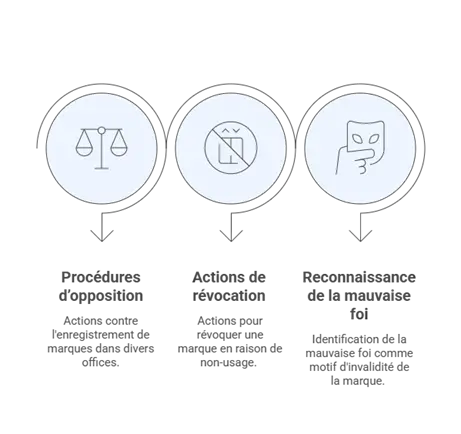L’articulation entre le droit des marques et la loi Evin (volet alcool)
Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.
Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.
Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.
Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.
En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.
L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large
L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose qu’« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique »
C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.
C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.
La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.
DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.
Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.
La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto, les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.
Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».
L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé
La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.
Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.
Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.
En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.
Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.
Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.
Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.
Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.
Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.
Affaire à suivre.