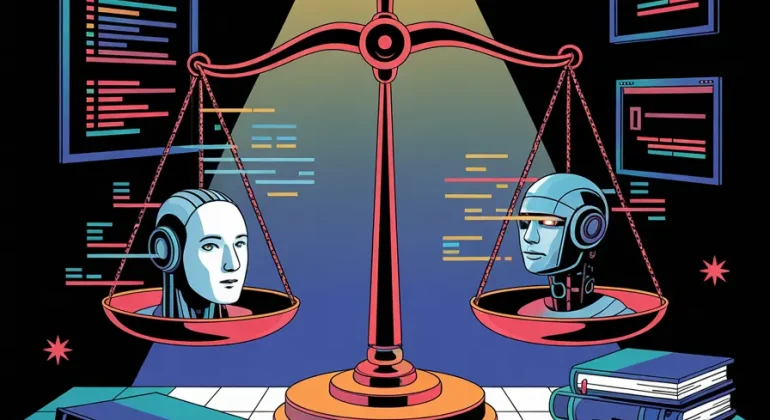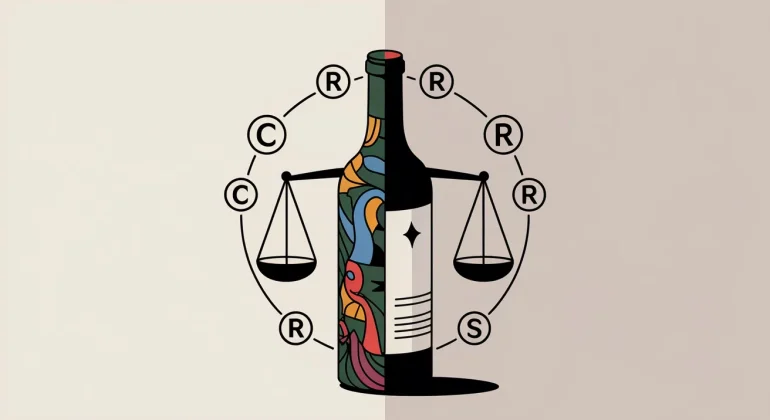L’IA peut-elle être poursuivie en justice pour contrefaçon ou plagiat ?
À l’ère où l’intelligence artificielle (IA) intervient massivement dans les processus créatifs et décisionnels, une interrogation essentielle émerge : l’IA peut-elle être juridiquement poursuivie pour contrefaçon ou plagiat ?
Alors que les IA génèrent des textes, images et musiques à un rythme inédit, la maîtrise du cadre juridique devient impérative pour les entreprises souhaitant sécuriser leur usage de ces technologies.
Dans cet article, nous analysons les responsabilités juridiques en matière de violation de droits de propriété intellectuelle impliquant l’IA, les défis posés par le droit actuel et les stratégies permettant de limiter les risques.
Responsabilité juridique de l’IA : état des lieux
L’IA n’a pas de personnalité juridique
À ce jour, aucune législation, y compris le récent règlement européen 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act), ne reconnaît à l’IA la qualité de sujet de droit.
L’IA demeure un outil, sans autonomie juridique propre. En vertu de l’article 1240 du Code civil et suivants et des principes fondamentaux de responsabilité délictuelle, seules les personnes physiques ou morales utilisant, développant ou commercialisant l’IA peuvent être tenues responsables.
L’IA Act, tout en instaurant un régime de responsabilité spécifique pour les systèmes à haut risque, confirme que l’obligation de conformité incombe exclusivement aux opérateurs humains ou juridiques, jamais aux IA elles-mêmes.
Des lois inadaptées aux créations autonomes
Le droit d’auteur, notamment la Convention de Berne et la Directive 2001/29/CE, protège les œuvres de l’esprit créées par des personnes humaines.
Les productions entièrement autonomes des IA, sans intervention humaine significative, échappent ainsi à la protection classique, ce qui complique l’attribution de droits ou la reconnaissance de violations lorsque de tels contenus reproduisent, sans autorisation, des œuvres existantes.
L’AI Act n’instaure pas de régime de propriété intellectuelle autonome pour les créations générées par IA. Il impose toutefois, via son article 50, des obligations de transparence pour informer l’utilisateur lorsqu’il interagit avec du contenu généré artificiellement. En parallèle, son article 52 organise la procédure de désignation et de surveillance des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique.
Quand les productions de l’IA mènent à la contrefaçon : qui est responsable ?
Responsabilité des personnes physiques ou morales exploitant l’IA
Lorsqu’une personne physique ou morale utilise une IA pour générer un contenu qui porte atteinte aux droits d’un tiers, elle est assimilée à l’auteur du contenu litigieux au regard du droit de la propriété intellectuelle.
La responsabilité est engagée indépendamment de toute faute intentionnelle, dès lors que l’exploitation du contenu cause un préjudice au titulaire de droits protégés.
Les exploitants doivent mettre en œuvre :
- Une vérification préalable systématique des contenus générés ;
- Des mécanismes de contrôle interne adaptés aux spécificités de l’IA utilisée.
Responsabilité des développeurs et fournisseurs d’IA
Le développeur ou le fournisseur d’une IA, personne physique ou morale, peut également voir sa responsabilité engagée dans deux cas principaux :
- En cas de manquement à son obligation de garantir un contrôle humain effectif, notamment en ne fournissant pas les informations indispensables à la compréhension, au contrôle et à l’intervention sur le système d’IA à haut risque, conformément à l’article 14 du règlement AI Act ;
- En cas d’utilisation illicite d’œuvres protégées lors de l’entraînement des modèles, ce qui constitue une violation distincte du droit de la propriété intellectuelle.
L’AI Act impose ainsi aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque :
- D’assurer la qualité, la représentativité et la pertinence statistique des jeux de données d’entraînement, de validation et de test, conformément aux exigences de l’article 10 ;
- D’établir une documentation technique rigoureuse, précisant les caractéristiques, les processus de développement et les mesures de conformité du système, en application de l’article 11 ;
- D’informer les utilisateurs finaux sur la nature et les limites des contenus générés par l’IA, afin de garantir la transparence et de prévenir toute utilisation abusive, conformément aux dispositions de l’article 50.
L’affaire DeepSeek : illustration des risques de plagiat par l’IA
En mars 2024, l’entreprise chinoise DeepSeek a été accusée d’avoir plagié du contenu soumis à conditions d’utilisation, sans respect des mentions obligatoires.
Des analyses ont démontré que l’ IA reproduisait mot pour mot des contenus préexistants, sans transformation ni création originale.
Face aux accusations, DeepSeek a soutenu que ses sources étaient publiques et que les extraits constituaient une forme de transformation. Toutefois, conformément au droit de la propriété intellectuelle, la simple agrégation ou reformulation superficielle ne suffit pas pour écarter la contrefaçon lorsque l’original est reconnaissable.
Cette affaire illustre les risques auxquels s’exposent les entreprises qui ne vérifient pas suffisamment la provenance et l’utilisation des jeux de données d’entraînement, soulignant la nécessité :
- D’auditer rigoureusement les bases d’entraînement,
- De tracer les sources exploitées,
- D’assurer une transparence effective vis-à-vis des utilisateurs.
Stratégies pour protéger votre entreprise
Mettre en place des politiques internes de conformité
- Vérifier systématiquement les contenus IA avant publication ;
- Former les équipes aux enjeux de propriété intellectuelle appliqués aux technologies émergentes ;
- Limiter l’usage de l’IA aux cas où le risque d’atteinte est maîtrisé.
Sécuriser les relations contractuelles
- Exiger des garanties précises sur la qualité des données d’entraînement ;
- Négocier des clauses d’indemnisation couvrant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ;
- Refuser toute clause de limitation de responsabilité déraisonnable au profit des fournisseurs.
Utiliser des outils technologiques et juridiques
- Employer des logiciels avancés de détection de plagiat ;
- Mettre en place un dispositif interne d’audit et de signalement rapide des risques.
Conclusion : anticiper pour sécuriser son activité
L’intelligence artificielle, en l’état actuel du droit, ne peut être tenue pour responsable.
Ce sont toujours les personnes physiques ou morales exploitant, développant ou commercialisant les systèmes d’IA qui assument la responsabilité juridique en cas de contrefaçon ou de plagiat.
Face aux nouvelles obligations issues du règlement européen sur l’intelligence artificielle, il est indispensable d’adopter une approche préventive, intégrant conformité technique, gouvernance contractuelle et vigilance permanente.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.
Nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !