Protection des marques en ligne : Méthodes stratégiques pour une défense efficace !
9 juillet 2024
Assurer la protection des marques sur Internet peut sembler une mission titanesque.
L’univers numérique évolue rapidement, offrant aux contrefacteurs de multiples façons de profiter illégalement des marques d’autrui. Dans ce contexte en constante évolution, il est essentiel de bien comprendre les différentes stratégies possibles.
Sans une stratégie claire de protection et de défense sur l’Internet, les entreprises peuvent se retrouver à jouer à un jeu interminable et sans fin pour tenter de contrer les menaces.
Identification des problèmes et de leur impact
La première étape pour développer une stratégie de protection des marques en ligne consiste à identifier les atteintes auxquels la marque est confrontée et à comprendre pourquoi il convient de ne pas les tolérer.
Les atteintes sont multiples et peuvent inclure notamment des faux sites marchands, des cas de phishing visant à obtenir des informations financières des clients, des situations d’usurpation d’identité, de fausses brochures d’information.
Les impacts peuvent être divers : pertes de revenus, atteinte à la réputation due à des produits contrefaits de mauvaise qualité ou dangereux, responsabilité des dirigeants ou plaintes de consommateurs.
Définir les objectifs de la stratégie et les indicateurs de succès
Dans un monde idéal, l’objectif serait d’éliminer complètement les atteintes. Cependant, compte tenu du déséquilibre des ressources entre les marques et les contrefacteurs, cela est rarement réalisable.
Une stratégie viable pourrait viser à perturber les cybersquatteurs et les contrefacteurs en rendant la marque plus difficile ou risquée à contrefaire. Il est aussi recommandé d’éduquer les consommateurs sur les risques d’achat de produits contrefaits.
Il est également possible de chercher à responsabiliser les intermédiaires, tels que les plateformes de commerce en ligne, en les incitant à améliorer leurs processus de détection et de gestion des contrefaçons.
Mesurer le succès
L’objectif doit être réaliste et le succès mesurable bien qu’il soit souvent difficile d’évaluer le nombre de ventes détournées des produits contrefaits.
Nous conseillons d’utiliser d’autres indicateurs qui peuvent inclure :
– Les taux de réponse ciblés
– Le nombre de sites web désactivés
– Le nombre de noms de domaine litigieux bloqués.
Surveillance et enquêtes robustes
Une fois qu’un problème est identifié, les étapes suivantes consistent à recueillir des informations contextuelles, déterminer l’origine du problème et identifier les différents protagonistes avant de décider d’une approche.
Une fois l’enquête effectuée, l’approche dépend des objectifs du titulaire des droits de la marque : obtenir le blocage d’un site, récupérer le nom de domaine litigieux, obtenir des dommages-intérêts, protéger les consommateurs voire défendre les dirigeants et le comité exécutif.
Nous recommandons en fonction des situations d’envoyer lettre de mise en demeure aux différents protagonistes d’une affaire, demander le blocage du site auprès des hébergeurs et des intermédiaires techniques, déposer d’une plainte UDRP ou entamer une action judiciaire au civil ou au pénal.
Collaborer avec les intermédiaires
Établir de bonnes relations avec les intermédiaires tels que les FAI, les plateformes de commerce électronique, les moteurs de recherche et les fournisseurs de services de paiement est une tactique précieuse dans la protection en ligne. Les intermédiaires responsables et réactifs peuvent aider les détenteurs de droits à résoudre des problèmes tels que les annonces trompeuses, les enregistrements de noms de domaines trompeurs, les campagnes de phishing, les contrefaçons, les importations parallèles, le piratage et le vol d’identité.
Mettre en place une surveillance de la marque parmi les noms de domaine afin de détecter au plus vite les atteintes
Afin d’avoir connaissance d’une atteinte à la marque dans les noms de domaine, il est recommandé de mettre en place une surveillance parmi les noms de domaine gTLD et ccTLD. Si un nom de domaine apparait problématique, il est aussi possible de réaliser une surveillance spécifique. Il existe tout une palette de surveillances et nous pouvons vous conseillons sur les plus adaptées à votre situation.
Le monde en ligne évolue rapidement. Les équipes de protection en ligne doivent se tenir au courant des développements technologiques et des nouvelles plateformes pour garantir que leur stratégie évolue avec le marché. Des examens réguliers sont essentiels pour éviter que les titulaires de droits ne jouent constamment à rattraper les acteurs malveillants.
L’adoption d’une approche proactive et stratégique de la protection des marques en ligne permet aux entreprises de se prémunir contre les cybersquatteurs tout en renforçant leur réputation et en assurant la fidélité de leurs clients. Chez Dreyfus, nous sommes engagés à fournir des solutions sur mesure pour répondre à ces défis et protéger vos marques dans le paysage numérique en constante évolution.
Alors que le cadre juridique continue d’évoluer, il est indispensable de se tenir informé et d’adapter sa stratégie de marque.
Le cabinet Dreyfus et associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.
Donnez votre avis : Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !










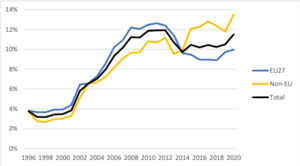

 L’effervescence autour de l’imminence des Jeux Olympiques de Paris démontre les liens entre les marques et les sportifs. Dans un environnement médiatique où l’authenticité et la visibilité sont cruciales pour le succès commercial, les partenariats avec des athlètes olympiques et paralympiques représentent des opportunités exceptionnelles de visibilité pour les marques. Cependant, ces collaborations doivent être méticuleusement gérées dans le cadre d’une législation précise, pour prévenir toute transgression comme le marketing d’embuscade ou la violation des droits de
L’effervescence autour de l’imminence des Jeux Olympiques de Paris démontre les liens entre les marques et les sportifs. Dans un environnement médiatique où l’authenticité et la visibilité sont cruciales pour le succès commercial, les partenariats avec des athlètes olympiques et paralympiques représentent des opportunités exceptionnelles de visibilité pour les marques. Cependant, ces collaborations doivent être méticuleusement gérées dans le cadre d’une législation précise, pour prévenir toute transgression comme le marketing d’embuscade ou la violation des droits de 

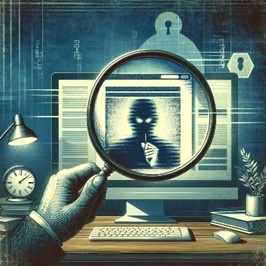

 Image générée par DALL E 3e version Microsoft
Image générée par DALL E 3e version Microsoft

