Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.
De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.
Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.
Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).
Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle
L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.
Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.
Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…
Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.
Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.
Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique
La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?
Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.
Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.
Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.
En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.
Le rôle du « compliance officer »
Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.
De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.
Selon une étude Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.
Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.
Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.







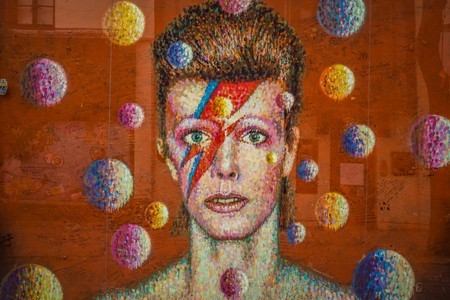


 Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.
Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.